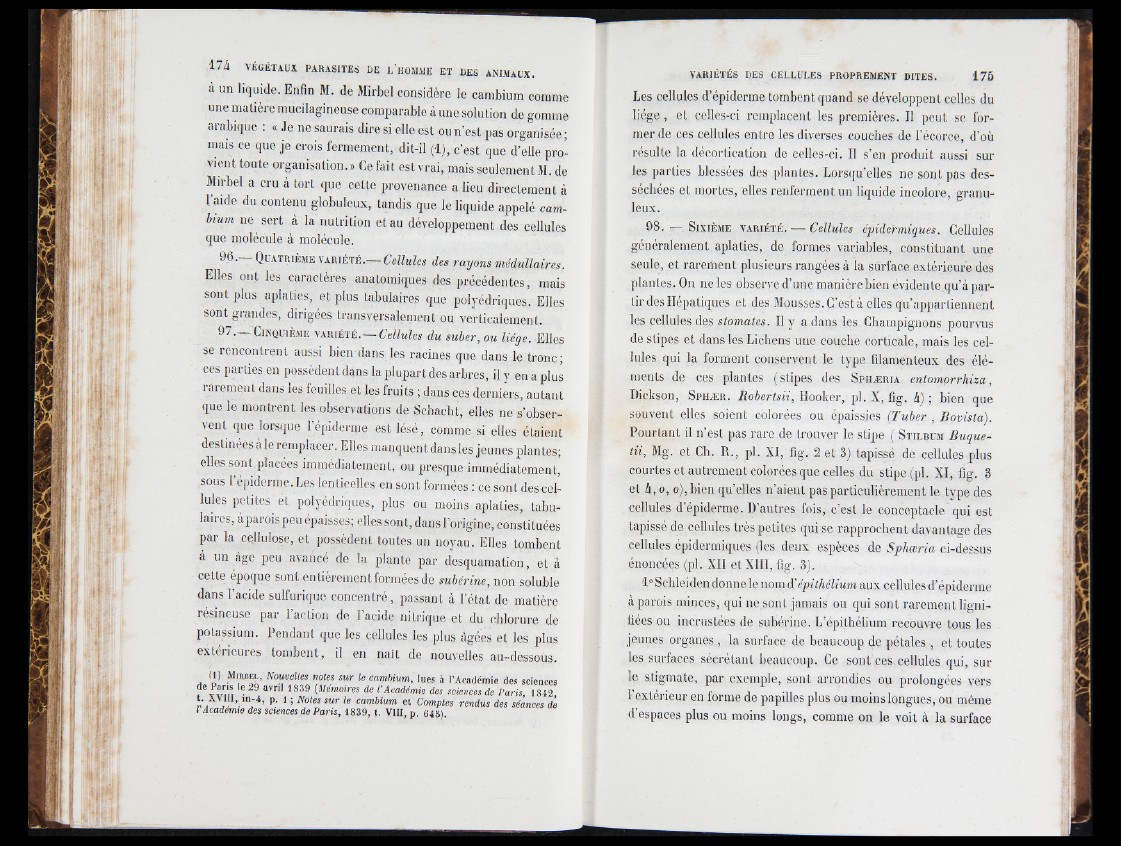
nm
à un liquide. Enfin M. de Mirbel considère le cambium comme
une matière nmcilagineuse comparable à une solution de gomme
arabique : « Je ne saurais dire si elle est ou n ’est pas organisée ;
mais ce que je crois fermement, dit-il (1), c’est que d’elle provient
toute organisation. » Ge fait est vrai, mais seulement M. de
Mirbel a cru à tort que celte provenance a lieu directement à
l’aide du contenu globuleux, tandis que le liquide appelé cambium
ne sert à la nutrition et au développement des cellules
que molécule à molécule.
9 6 . - Q u a t r i è m e v a r i é t é .— Cellules des rayons médullaires.
Elles ont les caractères anatomiques des précédentes, mais
sont plus aplaties, et plus tabulaires que polyédriques. Elles
sont grandes, dirigées transversalement ou verticalement.
9 7 .— C i n q u i è m e v a r i é t é .— CeZ/w/ey du suber, ou liège. Elles
se rencontrent aussi bien dans les racines que dans le tronc;
ces parties eu possèdent dans la plupart des arbres, il y en a piu¡
rarement dans les feuilles et les fruits ; dans ces derniers, autant
que le montrent les observations de Schacht, elles ne s’observent
que lorsque l’épiderme est lé sé, comme si elles étaient
destinées à le remplacer. Elles manquent dans les jeunes plantes;
elles sont placées immédiatement, ou presque immédiatement,’
sous l’épiderme.Les lenlicelles en sont formées ; ce sont des cellules
petites et polyédriques, plus ou moins aplaties, tabulaires,
àparois peu épaisses; elles sont, dans l ’origine, constituées
par la cellulose, et possèdent toutes un noyau. Elles tombent
à un âge peu avancé de la plante par desquamation, et à
cette époque sont entièrement formées de subérine, non soluble
dans l’acide sulfurique concentré, passant à l’état de matière
résineuse par l’action de l ’acide nitrique et du cbiorure de
potassium. Pendant que les cellules les plus âgées et les plus
extérieures tombent, il en naît de nouvelles au-dessous.
(1) M i r b e l , Nouve lle s noies s u r le c am b ium , l u e s à l’Académie de s sc ienc e s
1 Y v m ® M ém o ir e s de l'A c a d ém ie des sciences de P a r is 1 8 4 2
t . XVIII, i n - 4 , p. 1 ; Notes s u r le c am b ium e t Comptes r e n d u s des séances ¿s
l Académie des sciences de P a r is , 1 8 3 9 , t . Vl l l , p. 64S).
Les cellules d’épiderme tombent quand se développent celles du
liège , et celles-ci remplacent les premières. Il peut se former
de ces cellules entre les diverses couches de l’écorce, d’où
résulte la décortication de celles-ci. Il s’en produit aussi sur
les parties blessées des piaules. Lorsqu’elles ne sont pas desséchées
et mortes, elles renferment un liquide incolore, granuleux.
98.^— S ix i èm e v a r i é t é . — Cellules épidermiques. Cellules
généralement aplaties, de formes variables, constituant une
seule, et rarement plusieurs rangées à la surface extérieure des
plantes. On neles observe d’une manière bien évidente qu’àp a r-
lir des Hépatiques et des iMousses.C’e s tà elles qu’appartiennent
les cellules des stomates. H y a dans les Champignons pourvus
de stipes et dans les Lichens une couche corticale, mais les cellules
qui la forment conservent le type filamenteux des éléments
de ces plantes (stipes des S p h æ r i a entomorrhiza,
Dickson, S p h æ r . lîobertsii, Hooker, pl. X, f ig . 4) ; bien que
souvent elles soient colorées ou épaissies (Tuber , Bovista).
Pourtant il n ’est pas rare de trouver le stipe ( S t i l b u m Buque-
tii, Mg. et Cb. R., pl. XI, fig. 2 et 3) tapissé de cellules plus
courtes et autrement colorées que celles du stipe (pl. XI, fig. 3
et 4 , 0, o), bien qu’elles n ’aient pasparLiculièrement le type des
cellules d’épiderme. D’autres fois, c’est le conceptacle qui est
tapissé de cellules très petites qui se rapprochent davantage des
cellules épidermiques (les deux espèces de Sphæria ci-dessus
énoncées (pl. XII et XIII, fig. 3).
1° Scbleiden donne le nom à'épiihclium aux cellules d’épiderrae
à parois minces, qui ne sont jamais ou qui sont rarement lignifiées
ou incrustées de subérine. L’épitbélium recouvre tous les
jeunes organes , ia surface de beaucoup de pétales , et toutes
les surfaces sécrétant beaucoup. Ce sont ces cellules qui, sur
le stigmate, par exemple, sont arrondies ou prolongées vers
l’exlérieur en forme de papilles plus ou moins longues, ou même
d’espaces plus ou moins longs, comme on le voit à la surface
i