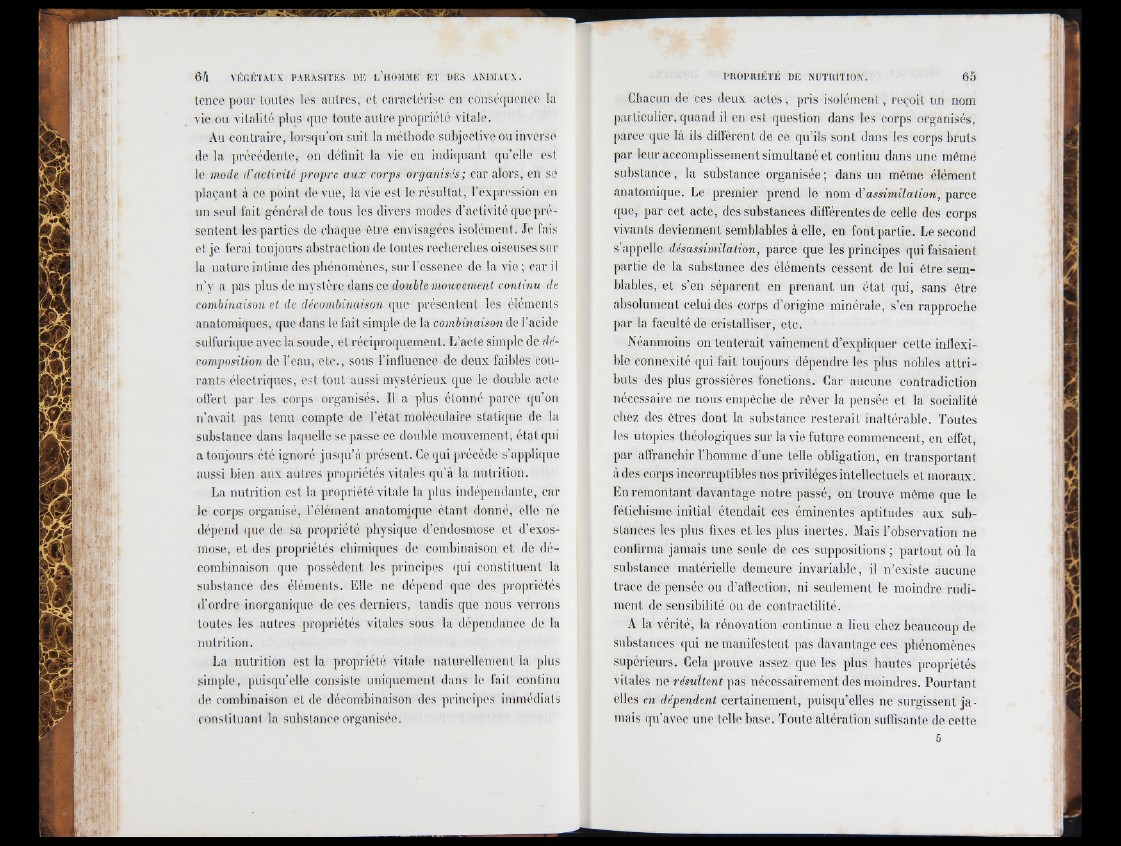
r
teiiee pour toutes les au 1res, et caractérise en conséquence la
vie ou vitalité plus (¡ue toute autre propriété vitale.
Au contraire, lorsqu’on suit la méthode subjective ou inverse
de la précédente, on définit la vie en indiijiunit qu’elle est
le mode d’activité propre a u x corps organisés; car alors, en se
plaçant à ce point de vue, la vie est le résultat, roxprossion eu
un seul fait général de tous les divers modes d’activité que p ré sentent
les parties de cbaque être envisagées isolément. Je fais
et je ferai toujours abstraction de toutes recherches oiseuses sur
la nature intime des phénomènes, sur l’essencc de la vie; car il
n ’y a pas plus de mystère dans ce doubie mouvement continu de
combinaison et do décombinaison que présentent les éléments
anatomiques, que dans ie fait simple de la combinaison de l’acide
sulfurique avec la soude, et réciproquement. L’acte simple de décomposition
de l’eau, etc., sous i’iniluence de deux faibles courants
électriques, est tout aussi mystérieux que le doidde acte
offert ])ar les corps organisés. Il a plus étonné parce qu’on
n ’avait pas tenu compte de l’état moléculaire statique de la
substance dans laquelle se passe ce double mouvement, étal qui
a toujours été ignoré jusqu’à présent. Ce qui précède s’applique
aussi bien aux autres propriétés vitales qu’à la nvilrilion.
La nutrition est la propriété vitale la plus indépendante, car
le corps organisé, l’élément anatomique étant donné, elle ne
dépend que de sa propriété physique d’endosmose et d’exosmose,
et des propriétés chimiques de combinaison et de décombinaison
que possèdent les principes qui constituent la
substance des éléments. Elle ne dépend que des propriétés
d’ordre inorganique de ces derniers, tandis que nous verrons
toutes les autres propriétés vitales sous la dépendance de la
nutrition.
La nutrition est la propriété vitale nalurellemcnt la ¡tins
simple, puisqu’elle consiste uniquement dans le fait continu
de combinaison et de décombinaison des priucipi'S immédials
constituant la substance organisée.
Chacun de ces doux a c te s, pris isolément, reçoit un nom
particulier, quand il en est question dans les corps organisés,
parce que là iis dillèrent de ce qu’ils sont dans les corps bruts
par leur accomplissement simultané et continu dans une même
substance, la substance organisée; dans un même élément
anatomique. Le premier prend le nom A’assimilation, parce
([ue, par cet acte, des substances différentes de celle des corps
vivants deviennent semblables à elle, en font partie. Le second
s’appelle désassimilation, parce que les principes qui faisaient
partie de la substance des éléments cessent de lui être semblables,
et s’en séparent en prenant un é ta t qui, sans être
absolument celui des corps d ’origine minérale, s’en rapproche
par la faculté de cristalliser, etc.
Néanmoins on tenterait vainement d’expliquer cette inflexible
connexité qui fait toujours dépendre les plus nobles a ttr ibuts
des plus grossières fonctions. Car aucune contradiction
nécessaire ne nous emjiêcbe de rêver la pensée et la socialité
chez des êtres dont la substance reste rait inaltérable. Toutes
les utopies tbéologiques sur la vie future commencent, en effet,
par affranchir l’homme d’une telle obligation, en transportant
à des corps Incorrnplibles nos privilèges intellectuels et moraux.
Eu remontant davantage notre passé, on trouve môme que le
fétichisme initial étendait ces éminentes aptitudes aux substances
les plus fixes et les plus inertes. Biais l’observation ne
confirma jamais une seule de ces suppositions ; partout où la
substance matérielle demeure invariable, il n ’existe aucune
trace de pensée ou d’affection, ni seulement le moindre rudiment
de sensibilité ou de contractilité.
A la vérité, la rénovation continue a lieu chez beaucoup de
subslaiices qui ne maiiifesteiit pas davantage ces phénomènes
supérieurs. Cela prouve assez que les plus hautes propriétés
vitales ne résultent pas nécessairement des moindres. Pourtant
elles en dépendent certainement, puisqu’elles ne surgissent j a mais
qu’avec une telle base. Toute altération suffisante de cette
5
I
i