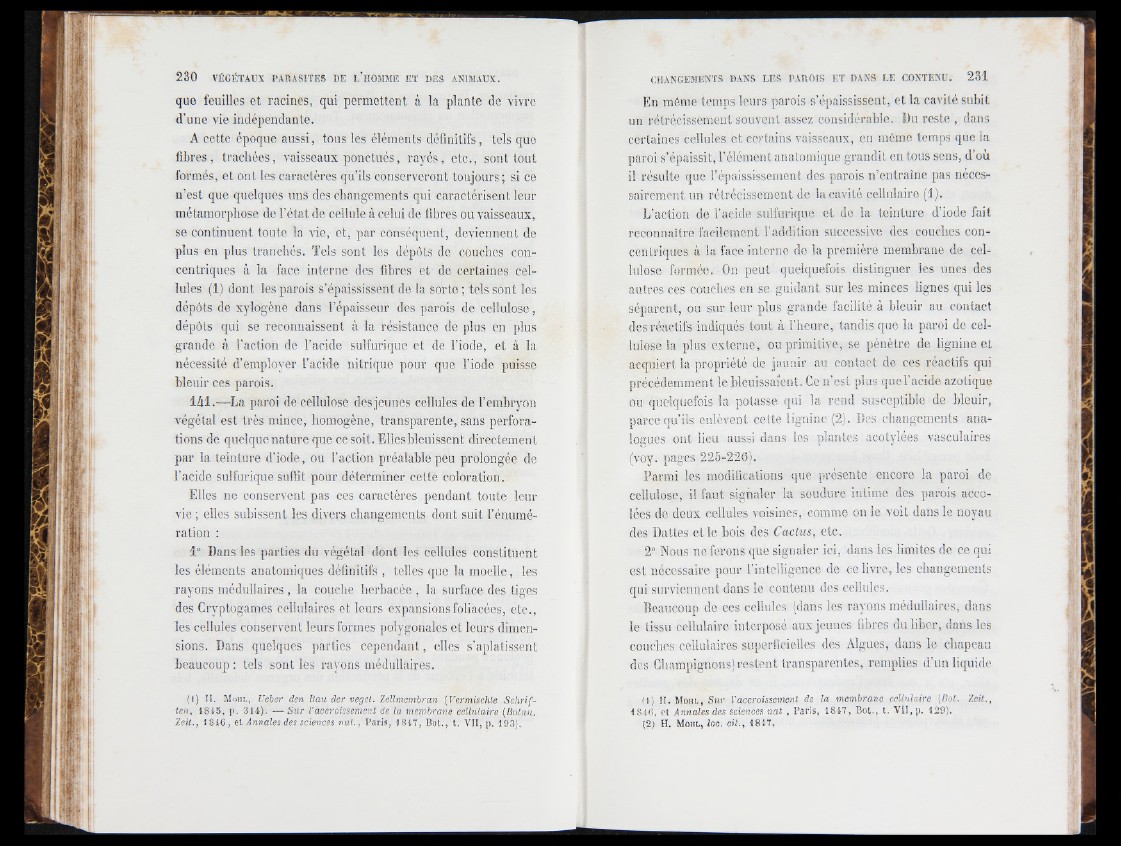
i
■f
;ï
I l
que feuilles et racines, qui permettent à la plante de vivre
d’une vie indépendante.
A cette époque aussi, tons les éléments définitifs, tels que
fibres, trachées, vaisseaux p onctués, ray é s, etc., sont tout
formés, et ont les caractères qu’ils conserveront toujours; si ce
n ’est que quelques mis des changements qui caractérisent leur
métamorphose de l'é ta t de cellule à celui de libres ou vaisseaux,
se continuent toute la vie, ct, par conséquent, deviennent de
plus en pins trancbés. Tels sont les dépôts de couches concentriques
à la face interne des fibres et de certaines cellules
(1) dont les parois s’épaississent de la sorte ; tels sont les
dépôts de xylogène dans l’épaisseur des parois de cellulose,
dépôts qui se reconnaissent à la résistance de plus en plus
grande à l’action de l’acide sulfurique et de l’iode, et à la
nécessité d’employer fac ide nitrique pour que l’iode puisse
bleuir ces parois.
141.'—La paroi de cellulose des jeunes cellules de l ’embryon
végétal est très mince, homogène, transparente, sans perforations
de quelque nature que ce soit. Ellesbleuissent directement
par la teinture d’iode, ou l’action préalable peu prolongée de
l ’acide sulfurique suffit pour déterminer cette coloration.
Elles ne conservent pas ces caractères pendant toute leur
vie ; elles subissent les divers changements dont suit fénumé-
ration :
1° Dans les parties du végétal dont les cellules constituent
les éléments anatomiques définitifs , telles que la moelle, les
rayons médullaires , la couclie herbacée , la surface des Liges
des Cryptogames cellulaires et leurs expansions foliacées, etc.,
les cellules conservent leurs formes polygonales ct leurs dimensions.
Dans quelques parties cependant, elles s’aplatissent
beaucoup : tels sont les rayons médullaires.
(1) II. îiIüHi,, Uebar den Ba u dor vegcl. Z o llm em b ra n {V e rm isch te S c h r ifte
n , 1 8 4 3 , ¡1. 314) . — S u r l'a c c ro k s em e n l de la m em b ra n e c e llu la ire (B o ta n .
Z e it., 4 8 4 6 , cl A n n a le s des sciences n a t ., Par is , 1 847, Bot . , t. VU, p. 193).
En môme temps leurs parois s’épaississent, et la cavité subit
un rctrécissemcut souvent assez considérable. Du reste , dans
certaines cellules et certains vaisseaux, en môme temps que ia
paroi s’épaissit, l’élément anatomique grandit en tous sens, d’où
il résulte que i’épaississement des parois n ’entraîne pas nécessairement
un rétrécissement de la cavité cellulaire (1).
L’action de l’acide sulfurique et de la teinture d’iode fait
reconnaître facilement l’addition successive des couches concentriques
à la face interne de la première membrane de cellulose
formée. On peut quelquefois distinguer ies unes des
autres ces couches en se guidant sur les minces lignes qui les
séparent, ou sur leur plus grande facilité à bleuir au contact
des réactifs indiqués tout à l’heure, tandis que la paroi de cellulose
la plus externe, ou primitive, se pénètre de lignine et
acquiert la propriété de jaunir au contact de ces réactifs qui
précédemment le bleuissaient. Ce n ’est plus q u e l’acide azotique
ou quelquefois la potasse qui la rend susceptible de bleuir,
parce qu’ils enlèvent cette lignine (2). Des changements analogues
ont lieu aussi dans les plantes acotylées vasculaires
(voy. pages 225-226).
Parmi les modilications que présente encore la paroi de
cellulose, il faut signaler la soudure intime des parois accolées
do deux cellules voisines, comme on le voit d an s le noyau
des Dattes e t le bois des Cactus, etc.
2“ Nous ne ferons que signaler ici, dans les limites de ce qui
est nécessaire pour fintelligenee de ce livre, les changements
qui surviennent dans le contenu des cellules.
Beaucoup de ces cellules (dans les rayons médullaires, dans
le tissu cellulaire interposé aux jeunes libres du liber, dans les
coucbos ceilülaires superficielles des Algues, dans le chapeau
des Cliampignons) restent transparentes, rempilies d’un liquide
H
(!) H. Moiil, S u r Vaccroissement de la m em b ra n e c e llu la ire (Bot. Z e it.,
I S i ü , ct A n n a le s des sciences n a t , Par is , 1 8 4 7 , Bot . , t. V I Î , p . 129).
(2) H. Mohl, loc. c i t., 1 8 ¡7 .