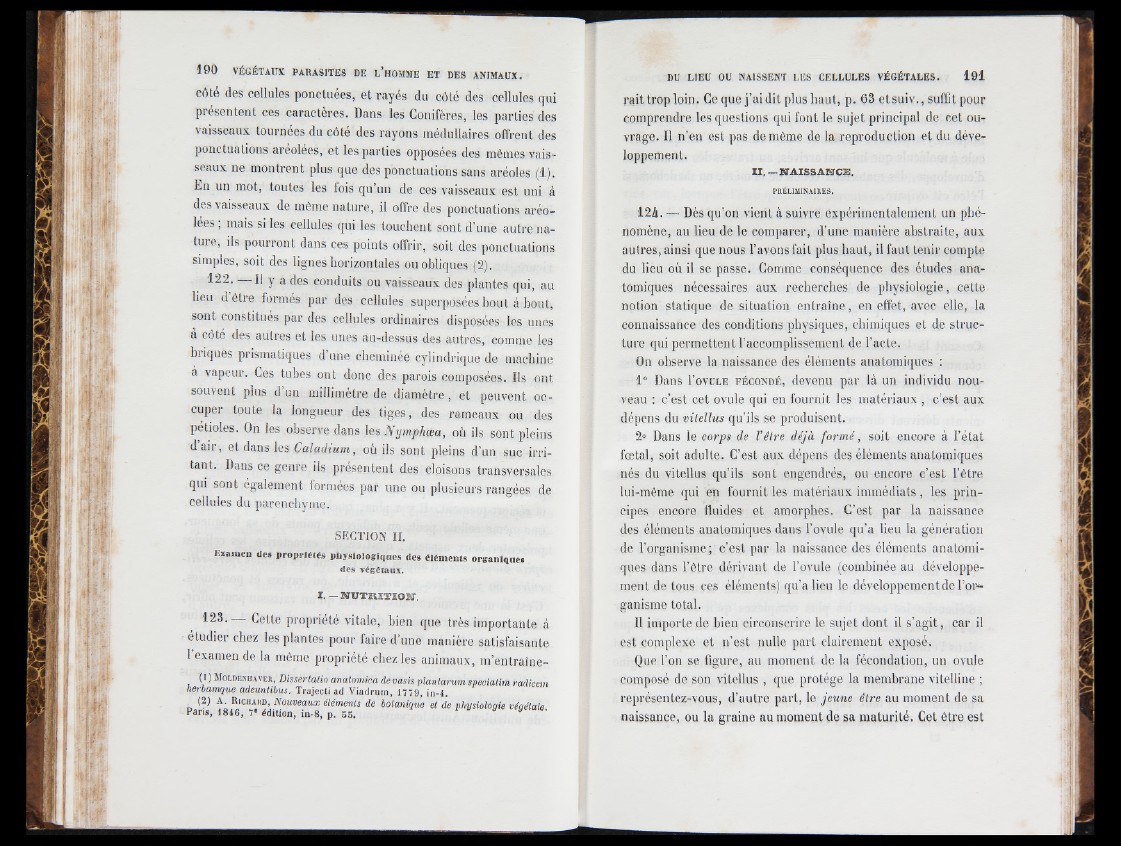
côté des cellules ponctuées, et rayés du côté des cellules qui
présentent ces caractères. Dans les Conifères, les parties des
vaisseaux tournées du côté des rayons médullaires offrent des
ponctuations aréolées, et les parties opposées des mêmes vaisseaux
ne montrent plus que des ponctuations sans aréoles (1).
En un mot, toutes les fois qu’un de ces vaisseaux est uni à
des vaisseaux de même nature, il offre des ponctuations aréolées
; mais si les cellules qui les touchent sont d’une autre na-
tuie, ils pourront dans ces points offrir, soit des ponctuations
simples, soit des lignes horizontales ou obliques (2).
y <l6s conduits ou vaisseaux des plantes qui, au
lieu d è tr e formés par des cellules superposées bout à bout,
sont constitués par des celiules ordinaires disposées les unes
à côté des autres et les uiies au-dessus des autres, comme les
biiques prismatiques d une cheminée cylindrique de machine
à vapeur. Ces tubes ont donc des parois composées. Ils ont
souvent plus d’un millimètre de diamètre , et peuvent o c cuper
toute la longueur des tige s, des rameaux ou des
pétioles. On les observe dans les A'i/mpAoea, où ils sont pleins
d’a ir, et dans les Caladium, où ils sont pleins d’un suc irritant.
Dans ce genre ils présentent des cloisons transversales
qui sont également formées par une ou plusieurs rangées de
cellules du parenchyme.
SECTION II.
Examen ües propriétés pliysiologiqucs des éléments o r s a n l q u c »
des végétaux.
I. — 3 SU T Î1 ÏT ÎO S Î.
123. Cette propriété vitale, bien que très importante à
étudier chez les plantes pour laire d’une manière satisfaisante
1 examen de la môme propriété cbez les animaux, m’entraîne-
( I ) M o l d e n i ia v e r , D is se rla lio a n a lom ic a d e v a s is p la n la r um sp e c ia t im ra d ic em
h e rb am q u e a d eu n tib u s . TrajecU ad Via d rum, 1779, in -4.
( 2 ) A R i c h a r d , N o u v e a u x élémen is de b o ta n iq u e et de p h y s io lo g ie végétale
P a n s , 18 4 6 , 7 ' édi tion, in-8, p. 03, a » »
rait trop loin. Ce que j ’ai dit plus haut, p. 63 et suiv., suffit pour
comprendre les questions qui font le sujet principal de cet ouvrage.
Il n ’en est pas de même de la reproduction et du développement.
II, — KTAISSAErCÜ.
PRÉLIMINAIRES.
124. — Dès qu’on vient à suivre expérimentalement un phénomène,
an lieu de le comparer, d’une manière abstraite, aux
autres, ainsi que nous l’avons fait plus haut, il faut tenir compte
du lieu où il se passe. Comme conséquence des études anatomiques
nécessaires aux recherches de physiologie, cette
notion statique de situation en tra în e , en effet, avec elle, la
connaissance des conditions physiques, chimiques et de stru cture
qui permettent raccomplissement de l’acte.
On observe la naissance des éléments anatomiques :
1° Dans l’ovuLE f é co n d é , devenu par là un individu nouveau
: c’est cet ovule qui en fournit les matériaux , c ’est aux
dépens du vitellus qu’ils se produisent.
2° Dans le corps de Vêtre déjà fo rmé , soit encore à l’état
foetal, soit adulte. C’est aux dépens des éléments anatomiques
nés du vitellus qu’ils sont engendrés, ou encore c’est l’être
lui-même qui en fournit les matériaux immédiats , les principes
encore fluides et amorphes. C’est par la naissance
des éléments anatomiques dans l’ovule qu’a lieu la génération
de l’organisme; c’est par la naissance des éléments anatomiques
dans l’être dérivant de l’ovule (combinée au développement
de tous ces éléments) qu’a lieu le développement de Tor-^
ganisme total.
Il importe de bien circonscrire le sujet dont il s’a g it, car il
est complexe et n ’est nulle p a rt clairement exposé.
Que l’on se figure, au moment de la fécondation, un ovule
composé de son vitellus , que protège la membrane vitelline ;
représentez-vous, d’autre part, le jeune être au moment de sa
naissance, ou la graine au moment de sa maturité. Cet être est
I