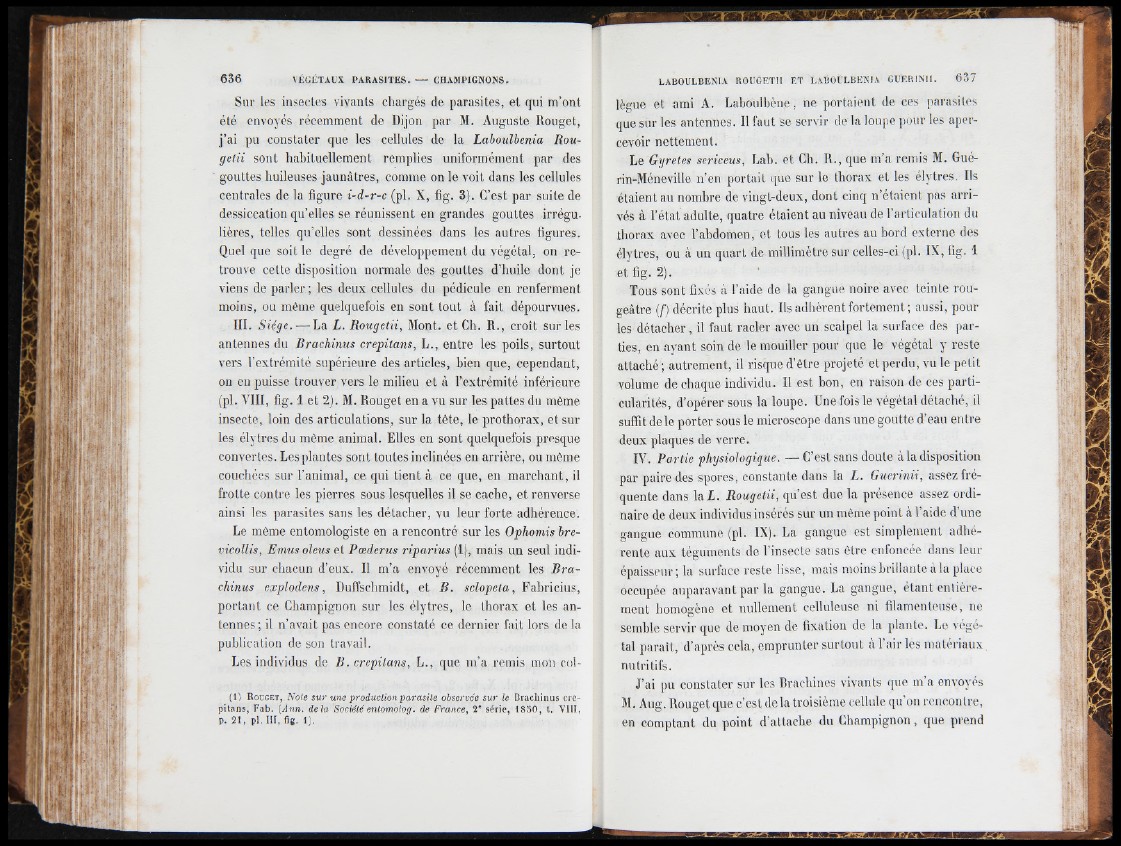
m
«M
!"
r i ' r i 'i
» H
. ...i : k
t-k.M
A S i-ï:
Süi' les insectes vivants chargés de parasites, et qui m’ont
été envoyés récemment de Dijon par M. Auguste Rouget,
j ’ai pu constater que les cellules de la Laboulbenia Rougetii
sont habituellement remplies uniformément par des
gouttes huileuses jaunâtres, comme on le voit dans les cellules
centrales de la figure i-d-r-c (pl. X, fig. 3). C’est par suite de
dessiccation qu’elles se réunissent en grandes gouttes irrégulières,
telles qu’elles sont dessinées dans les autres figures.
Quelque soit le degré de développement du végétal, on retrouve
cette disposition normale des gouttes d’huile dont je
viens de parler ; les deux cellules du pédicule en renferment
moins, ou même quelquefois en sont tout à fait dépourvues.
III. Siège. — La L. Rougetii, Mont, et Ch. R., croît su rle s
antennes du Rrachinus crepitans, L., entre les poils, surtout
vers l’extrémité supérieure des articles, bien que, cependant,
on en puisse trouver vers le milieu et à fex trém ité inférieure
(pl. VIII, flg. 1 et 2). M. Rouget en a vu sur les pattes du même
insecte, loin des articulations, sur la tête, le prothorax, et suites
élytres du même animal. Elles en sont quelquefois presque
convertes. Les plantes sont toutes inclinées en arrière, ou même
couchées sur l’animal, ce qui tient à ce que, en ma rch an t, il
frotte contre les pierres sous lesquelles il se cache, et renverse
ainsi les parasites sans les détacher, vu leur forte adhérence.
Le même entomologiste en a rencontré sur les Ophomis bre-
vicollis, Emus oleus et Poederus riparius (1), mais un seul individu
sur chacun d’eux. Il m’a envoyé récemment les R r a chinus
explodens, Duffscbmidt, et S . sclopeta, Pabricius,
portant ce Champignon sur les élytres, le thorax et les antennes;
il n ’avait pas encore constaté ce dernier fait lors de la
publication de son travail.
Les individus de R. crepitans, L., que m’a remis mon col-
(!') R ouget, No ie s u r u n e p ro d u c lio n p a r a s ite observée s u r lo Rrachinus c repi
tan s , F ab , (A n n . d e là S o c ié té e n lom o lo g . de F ra n c e , 2 ' série , 18 3 0 , t. Vl l l .
p. 21, pl. Ill , fig. 1;.
lègue et ami A. Laboulbène, ne portaient de ces parasites
que sur les antennes. Il faut se servir de la loupe pour les apercevoir
nettement.
Le Gyretes sericeus. Lab. et Ch. R., que m’a remis M. Guérin
Méneville n ’en portait tjue sur le thorax et les élytres, Ils
étaient au nombre de vingt-deux, dont cinq n ’étaient pas arrivés
à f é ta t adulte, quatre étaient au niveau de l’articulation du
thorax avec l’abdomen, et tous les autres au bord externe des
élytres, ou à un quart de millimètre sur celles-ci (pl. IX, tig. 1
et flg. 2).
Tous sont fixés à l’aide de la gangue noire avec teinte rougeâtre
(/■) décrite plus haut. Ils adhèrent fortement; aussi, pour
les d é ta c b e r, il faut racler avec un scalpel la surface des p a rties,
en ayant soin de le mouiller pour que le végétal y reste
attaché; autrement, il risque d’être projeté et perdu, vu le petit
volume de chaque individu. Il est bon, en raison de ces p a rticularités,
d’opérer sous la loupe. Une fois le végétal détaché, il
suffit dele porter sous le microscope dans une goutte d’eau entre
deux plaques de verre.
IV. Parlie physiologique. — C’est sans doute à la disposition
par paire des spores, constante dans la L. Guerinii, assez fréquente
dans l a i . Rougetii, qu’est due la présence assez ordinaire
de deux individus insérés sur un même point à l’aide d’une
gangue commune (pl. IX). La gangue est simplement adhérente
aux téguments de fiusec te sans être enfoncée dans leur
épaisseur; la surface reste lisse, mais moins brillante à la place
occupée auparavant par la gangue. La gangue, étan t entièrement
bomogène et nullement celluleuse ni filamenteuse, ne
semble servir que de moyen de fixation de la plante. Le végétal
paraît, d’après cela, emprunter surtout à l’air les matériaux
nutritifs.
J ’ai pu constater sur les Bracbines vivants que m’a envoyés
M. Aug. Rouget que c’est de la troisième cellule qu’ou rencontre,
en comptant du point d’attache du Champignon, que prend
UL t
' ■; '
f t '
’■'.V
'.- i l
'■‘b
i- ■!
; ' ri?
i s i s r