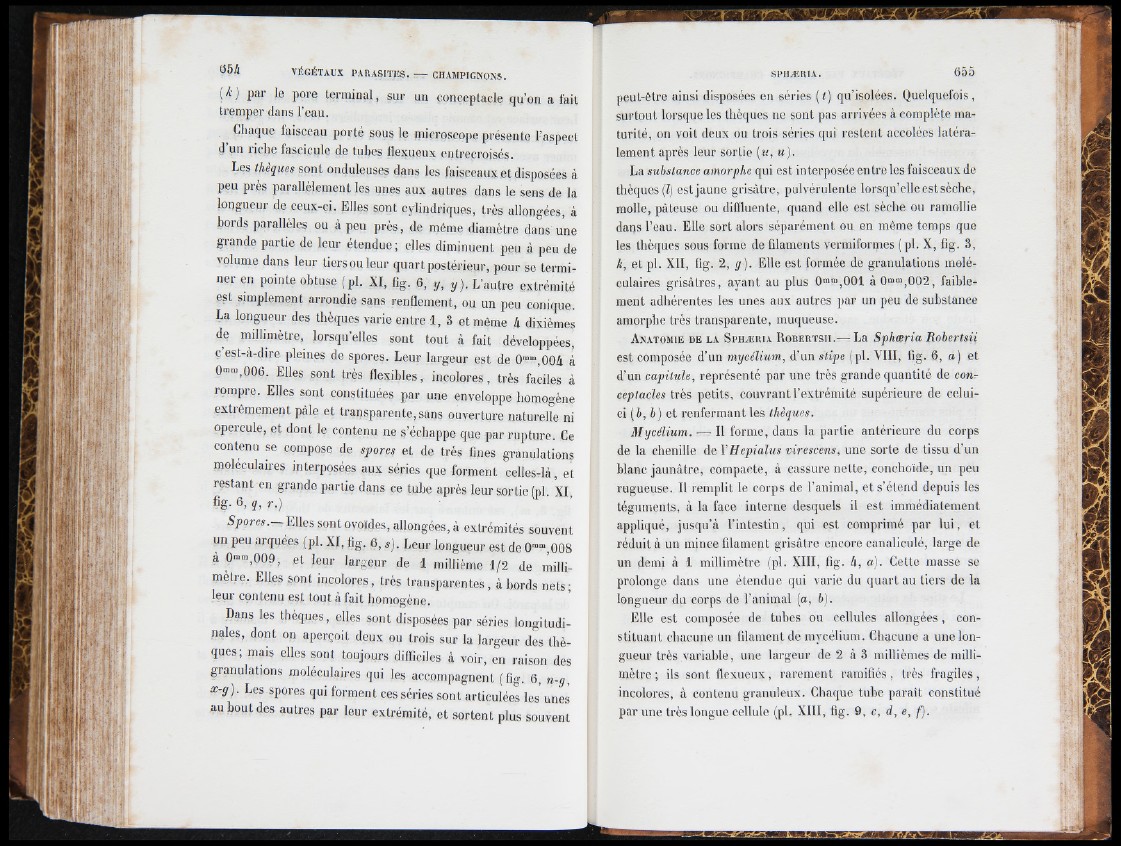
J, jt'L'T !'! ;'
H y i - ' i
' û m u
6 M l VÉGÉTAUX PARASITES. — CHAMPIGNONS.
(A) par le pore terminal, sur un conceptacle qu’on a fait
tremper dans l’eau.
^ Chaque faisceau porté sous le microscope présente l’aspect
d’un riche fascicule de tubes llexueux entrecroisés.
Les theques sont onduleuses dans les faisceaux et disposées à
peu près parallèlement les unes aux autres dans le sens de la
longueur de ceux-ci. Elles sont cylindriques, très allongées, à
bords parallèles ou à peu près, de môme diamètre dans une
grande partie de leur étendue; elles diminuent peu à peu de
■volume dans leur tie rso u leu r q uart postérieur, pour se terminer
en pointe obtuse (pl. XI, fig. 6, y, y) . L’autre extrémité
est simplement arrondie sans renflement, ou un peu conique.
La longueur des thèques varie entre 1, 3 et même 4 dixièmes
de millimètre, lorsqu’elles sont tout à fait développées,
c est-à-dire pleines de spores. Leur largeur est de 0™“ ,004 à
0” n>,006. Elles sont très flexibles, incolores, très faciles à
rompre. Elles sont constituées par une enveloppe bomogène
extrêmement pàle et transparente,sans ouverture naturelle ni
opercule, et dont le contenu ne s’échappe que par rupture. Ce
contenu se compose de spores et de très fines granulations
moléculaires interposées aux séries que forment celles-là, et
restant en grande parlie dans ce tube après leur sortie (pl. XI,
% • 6, q, r.)
X p o r« .— Elles sont ovoïdes, allongées, à extrémités souvent
un peu arquées (pl. XI, fig. 6, a). Leur longueur est de 0 - ,0 0 8
a 0” <n,009, et leur largeur de 1 millième 1/2 de millimèlre.
Elles sont incolores, très tran sp a ren te s, à bords nets •
leur contenu est tout à fait bomogène.
Dans les thèques, elles sont disposées par séries longitudinales,
dont on aperçoit deux ou trois sur la largeur des Ibè-
ques; mais elles sont toujours difficiles à voir, en raison des
granulations moléculaires qui les accompagnent (fig. G, n-g,
x-g). Les spores qui forment ces séries sont articulées les unes
au bout des autres par leur extrémité, et sortent pins souvent
SPHÆRIA.
peut-être ainsi disposées en séries (i) qu’isolées. Quelquefois,
surtout lorsque les thèques ue sonl pas arrivées à complète maturité,
on voit deux ou trois séries qui restent accolées latéralement
après leur sortie [u, u).
La substance amorphe qui est interposée entre les faisceaux de
thèques (Z) est jaune grisâtre, pulvérulente lorsqu’elle est sèche,
molle, pâteuse ou diflluente, quand elle est sèche ou ramollie
dans l’eau. Elle sort alors séparément ou en même temps que
les thèques sous forme de filaments vermiformes (pl. X, tig. 3,
k, et pl. XII, fig. 2, g). Elle est formée de granulations moléculaires
grisâtres, ayant au plus 0™'",001 à 0 “ '»,002, faiblement
adhérentes les unes aux aulres par un peu de substance
amorphe très transparente, muqueuse.
A n a t o m i e d e l a S p h æ r i a R o b e r t s i i .— La Sphæria Robertsii
est composée d’un mycélium, d’un stipe (pl. VIII, fig. 6, a ) et
d’un capitule, représenté par une très grande quantité de con-
ceptacles très petits, couvrant l’extrémité supérieure de celui-
ci [b, b) et renfermant les thèques.
Mycélium. — Il forme, dans la partie antérieure du corps
de la chenille de VHepialus virescens, une sorte de tissu d’un
blanc jaunâtre, compacte, à cassure nette, conchoïde, un peu
rugueuse. Il remplit le corps de l’animal, et s’étend depuis les
téguments, à la face interne desquels il est immédiatement
appliqué, jusqu’à l’in te stin , qui est comprimé par lu i, el
réduit à un mince filament grisâtre encore canalicnlé, large de
un demi à 1 millimètre (pl. XIII, lîg. 4, a). Cette masse se
prolonge dans une étendue qui varie du q u a rt au tiers de la
longueur du corps de l’animal [a, b).
Elle est composée de tubes ou cellules allongées, constituant
cbacime un filament de mycélium. Chacune a une longueur
très variable, une largeur de 2 à 3 millièmes de millimètre
; ils sont llexueux, rarement ramifiés, très fragiles,
incolores, à contenu granuleux. Cbaque tube paraît constitué
par une très longue cellule (pl. XIII, fig. 9, c, d, e, f).
m