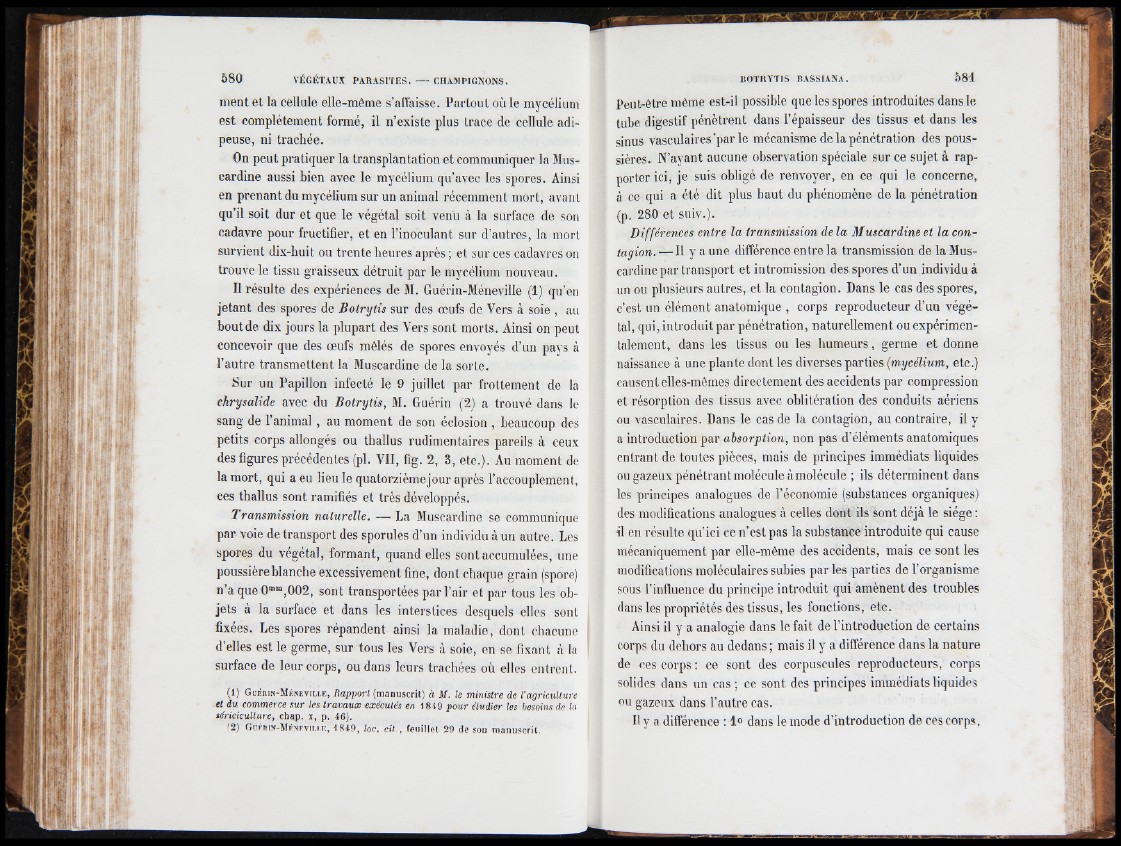
1
:i. '"Ai-,
ment et la cellule elle-même s’affaisse. Parloul où le mycélium
est complètement formé, il n ’existe plus Irace de cellule adipeuse,
ni trachée.
On peut pratiquer la transplantation et communiquer la Muscardine
aussi hien avec le mycélium qu’avec les spores. Ainsi
en prenant du mycélium sur un animal récemment mort, avant
qu’il soit dur et que le végétal soit venu à la surface de son
cadavre pour fructifier, et en l’inoculant sur d’autres, la mort
survient dix-huit ou trente heures après ; et sur ces cadavres on
trouve le tissu graisseux détruit par le mycélium nouveau.
Il résulte des expériences de M. Guérin-Méneville (1) qu’en
je tan t des spores de Botrytis sur des oeufs de Vers cà soie , au
bout de dix jours la plupart des Vers sont morts. Ainsi on peut
concevoir que des oeufs mêlés de spores envoyés d’nn pays k
l ’autre transmettent la Jluscardine de la sorte.
Sur un Papillon infecté le 9 juillet par frottement de la
chrysalide avec du Botrytis, M. Guérin (2) a trouvé dans le
sang de l’animal , au moment de son éclosion , beaucoup des
petits corps allongés ou tballus rudimentaires pareils à ceux
des figures précédentes (pl. VII, fig. 2, 3, etc.). Au moment de
la mort, qui a eu lieu le quatorzièmejour après l’accouplement,
ces tballus sont ramifiés et très développés.
l'ransmission naturelle. ■—• La Muscardine se communique
par voie de transport des sporules d’un individu à un autre. Les
spores du végétal, formant, quand elles sont accumulées, une
poussière blanche excessivement fine, dont cbaque grain (spore)
n ’a que 0"'“ ,002, sont transportées par l’air et par tous les obje
ts à la surface et dans les interstices desquels elles sont
fixées. Les spores répandent ainsi la maladie, dont cbacime
d’elles est le germe, sur tous les Vers à soie, cn se fixant à lu
surface de leur corps, ou dans leurs trachées où elles entrent.
(1) Gt]Énm-MiîNEviLi.E, R a p p o r t (manuscri t) à M . le m in is tr e de l’a g r ic u ltu r e
et d u com m e rc e s u r les t r a v a u x execute's en 184 9 p o u r e'iudier les besoins de la
s é r ic icu ltu re , chap, x, p. 46).
'2) Guér in-Ménevime, 1849, loc. cil , rciiillat 29 de sou inamiscr i l .
Peut-être même est-il possible que les spores introduites dans le
tube digestif pénètrent dans fépaisseur des tissus et dans les
sinus vasculaires'par le mécanisme de la pénétration des poussières.
N’ayant aucune observation spéciale sur ce sujet à rapporter
ici, je suis obligé de renvoyer, en ce qui le concerne,
à ce qui a été dit plus haut du phénomène de la pénétration
(p. 280 et suiv.).
Différences entre la transmission de la Muscardine et la contagion.
— Il y a une différence entre la transmission de la Muscardine
par transport et intromission des spores d’un individu à
un ou plusieurs autres, et la contagion. Dans le cas des spores,
c’est un élément anatomique , corps reproducteur d ’un végétal,
qui, introduit par pénétration, naturellement ou expérimentalement,
dans les tissus ou les bumeu rs, germe et donne
naissance à une plante dont les diverses parties {mycélium, etc.)
causent elles-mêmes directement des accidents par compression
et résorption des tissus avec oblitération des conduits aériens
ou vasculaires. Dans le cas de la contagion, au contraire, il y
a introduction par absorption, non pas d’éléments anatomiques
entrant de toutes pièces, mais de principes immédiats liquides
ou gazeux pénétrant molécule à molécule ; ils déterminent dans
les principes analogues de l’économie (substances organiques)
des modifications analogues à celles dont ils sont déjà le siège :
il en résulte qu’ici ce n ’est pas la substance introduite qui cause
mécaniquement par elle-même des accidents, mais ce sont les
modificalions moléculaires subies par les parties de l’organisme
sous finfluence du principe introduit qui amènent des troubles
dans les propriétés des tissus, les fonctions, etc.
Ainsi il y a analogie dans le fait de l’introduction de certains
corps du dehors au dedans ; mais il y a différence dans la nature
de ces corps: ce sont des corpuscules reproducteurs, corps
solides daus un cas ; ce sont des principes immédiats liquides
ou gazeux dans l’autre cas.
Il y a différence : 1« dans le mode d’introduction de ces corps.