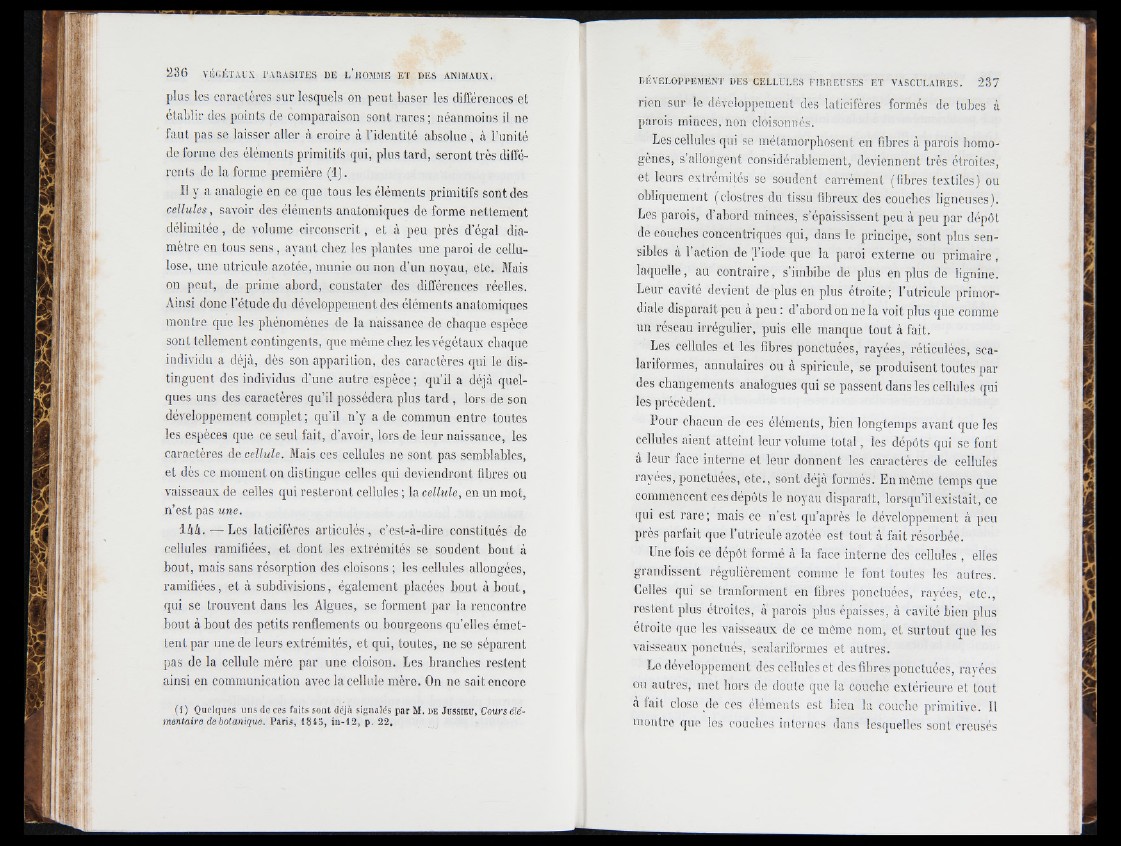
r .; '
ir
4M
•ip.
î4 M'i”lsr. •1
'kSs
I :■■
è .u~ '1;'
* ?rè: ’
I ■
Il5; i
Asti '
plus les caraclères sur lesquels on peut baser les différcuces et
établir des points de comparaison sont ra re s; néanmoins il ne
faut pas se laisser aller à croire à l’identité absolue , à l’imité
de forme des élémenis primitifs qui, plus tard, seront très diifé-
rcnls de la forme première (1).
Il y a analogie en ce que tous les éléments primitifs sont des
cellules, savoir des éléments anatomiques de forme nettement
délimitée, de volume circonscrit, et à peu près d’égal diamètre
en tous s e n s , ayant cbez les plantes une paroi de cellulose,
une utricule azotée, munie ou non d’im noyau, etc. Mais
on peut, de prime abord, constater des différences réelles.
Ainsi donc l’étude du développement des éiéments anatomiques
montre que les pbénomènes de la naissance de cbaque espèce
sont tellement contingents, que même cbez lesvégétaux cbaque
individu a déjà, dès son apparition, des caraclères qui le distinguent
des individus d’une autre espèce; qu’il a déjà quelques
uns des caractères qu’il possédera plus ta rd , lors de son
développement complet; qu’il n ’y a de commun entre toutes
les espèces que ce seul fait, d’avoir, lors de leur naissance, les
caractères de cellule, àlais ces celiules ne sont pas semblables,
et dès ce moment on distingue celles qui deviendront fibres ou
vaisseaux de celles qui resteront cellules ; la cellule, en un mot,
n ’est pas une.
144. — Les laticifères articulé s, c’est-à-dire constitués de
cellules ramifiées, et dont les extrémités se soudent bout à
bout, mais sans résorption des cloisons ; les cellules allongées,
ramifiées, et à subdivisions, également placées bout à b o u t,
qui se trouvent dans les Algues, se forment par la rencontre
bout à bout des petits renflements ou bourgeons qu’elles émettent
par une de leurs extrémités, et qui, toutes, ne se séparent
pas de la cellule mère par une cloison. Les branches restent
ainsi en communication avec la cellule mère. On ne sait encore
( i ) QucU|ucs u n s de ces faits sont déjà signalés pa r M. d e J u s s ie u , Cours élém
e n ta ire de b o ta n iq u e . P ar is , 18 4 3 , iu - 1 2 , p. 22.
rien sur le développement des laticifères formés de tubes à
parois minces, non cloisonnés.
Les cellules qui se métamorphosent en fibres à parois homogènes,
s’allongent considérablement, deviennent très étroites,
ct leurs extrémités se soudent carrément (fibres textiles) ou
obliquement (clostres du tissu fibreux des couches ligneuses).
Les parois, d’abord minces, s’épaississent peu à peu par dépôt
de couches concentriques qui, dans le principe, sont plus sensibles
à l’action de Tiode que la paroi externe ou p rim a ire ,
laquelle, au contra ire, s’imbibe de plus en plus de lignine.
Leur cavité devient de plus en plus étroite; fu tricu le primordiale
disparaît peu à peu : d’abord on ne la voit plus que comme
un réseau irrégulier, puis elle manque tout à fait.
Les cellules et les fibres ponctuées, rayées, réticulées, scalariformes,
annulaires ou à spiricule, se produisent toutes par
des changements analogues qui se passent dans les cellules qui
les précèdent.
Pour cbacim de ces éléments, bien longtemps avant que les
cellules aient atteint leur volume to ta l, les dépôts qui se font
à leur face interne et leur donnent les caractères de cellules
rayées, ponctuées, etc., sont déjà formés. En môme temps que
commeucent ces dépôts le noyau disparaît, lorsqu’il existait, ce
qui est ra re ; mais ce n ’est qu’après le développement à peu
près parfait que fu tricu le azotée est tout à fait résorbée.
Une lois ce dépôt formé à la face interne des cellules , elles
grandissent régulièrement comme le font toutes les autres.
Celles qui se tranforment en fibres ponctuées, rayées, etc.,
restent pins étroites, à parois plus épaisses, à cavité bien plus
étroite que les vaisseaux de ce mémo nom, et surtout que les
vaisseaux ponctués, scalariformes et autres.
Le développement des cellules et des fibres ponctuées, rayées
ou autres, met hors de doute que la concbc extérieure et tout
à but close de ces éléments est bien la couche primitive. Il
montre que ies couches inlerues dans lesquelles sont creusés
!f i 'i
\ : ‘ h