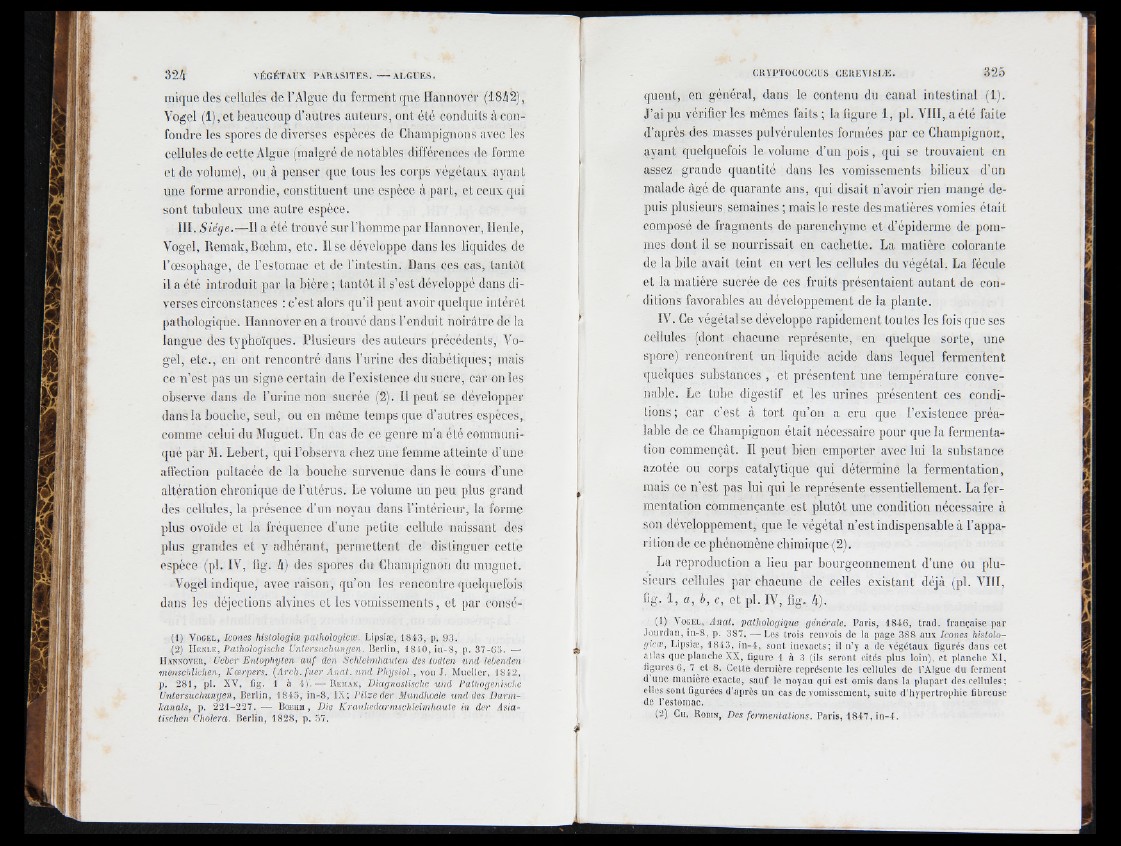
inique des cellules de l’Algue du femient (¡ne Hannover (1842),
Vogel (1), et Leauconp d’autres auteurs, ont été conduits à confondre
les spores de diverses espèces de Champignons avec les
cellules de cette Algue (malgré de notahles différences de forme
et de volume), ou à penser que tons les corps végétaux ayant
une forme arrondie, constituent une espèce à part, et ceux qui
sont tuhuleux une antre espèce.
III. Siège.—I! a été trouvé sur l’homme par Hannover, Heule,
Vogel, llemak,Boehm, etc. Ils e développe dans les liquides de
l’oesophage, de l’estoinac et de l’intestin. Dans ces cas, tantôt
il a été introduit par la hière ; tantôt i! s’est développé dans diverses
circonstances : c’est alors qu’il peut avoir quelque intériM,
pathologique. Hannover en a trouvé dans ren d u it noirâtre de la
langue des typhoïques. Plusieurs des auteurs précédents, Vogel,
etc., en ont rencontré dans l’urine des diabétiques; mais
ce n 'est pas un signe certain de l ’existence du sucre, car on les
observe dans de l’urine non sucrée (2). 11 peut se développer
dans la bouche, seul, ou en même temps que d’autres espèces,
comme celui du Muguet, ü n cas de ce genre m’a été communiqué
par M. Lebert, cjui l’observa chez une femme atteinte d’une
affection pultacée de la bouche survenue dans le cours d ’une
altération chronique de l’utérus. Le volume un peu plus grand
des cellules, la présence d’un noyau dans l’intérieur, ia forme
plus ovoïde et la fréquence d’une petite cellule naissant des
plus grandes et y adhérant, permettent de distinguer cette
espèce (pl. IV, fig. 4) des spores du Champignon du muguet.
Vogel indique, avec raison, qu’on les rencontre quelquefois
dans les déjections alvines et les vomissements, et par consé-
(1) VoGEL, Icônes h isto lo g iæ p a lh o lo g icoe . Lipsiæ, 1843, p. 93.
(2) U iis u i, P a th o lo g isch e U n te r su ch u n g en . Berlin , 1840, i n -8, p. 37-C:>. —
H.4NX0VER, Ueber E n lo p h y te n a u f den S ch le im h a u len des lodlen u n d lebenden
m en sch lich en , K oe r p e r s . [A rch , fu e r A n a l, u n d P h y s io l., you i . Mnellcr, 1812,
p. 2 8 1 , pi. XAy fig. 1 à 4). — Rem.ik , D ia g n o stisch e u n d I’a thogenischc
U n le r su ch u n ijen , Ber l in, 1843, in -8 , IX; I ’il z e d e r Mundhoele u n d des D a n n k
a n a ls , p. 2 2 1 - 2 2 7 .— BaîiiM , D ie K ra n h e d a rm s c h le u n h a u ie in d e r Asia -
lischen Cholera. Berlin , 48 2 8 , p. 37.
quent, en général, dans le contenu du canal iuteslinal (1).
J ’ai pu vériüer les mêmes faits ; la ligure 1, pl. VIII, a été faite
d’après des masses pulvérulentes formées par ce Champignon,
ayant quelquefois le volume d’un pois, qui se trouvaient en
assez grande quantité dans les vomissements bilieux d’un
malade âgé de quarante ans, qui disait n ’avoir rien mangé depuis
plusieurs semaines ; mais le reste des m atières vomies était
composé de fragments de parenchyme et d’épiderme de pommes
dont il se nourrissait en cachette. La matière colorante
de la bile avait teint en vert les cellules du végétal. La fécule
et la matière sucrée de ces fruits présentaient autant de conditions
favorables au développement de la plante.
IV. Ce végétal se développe rapidement toutes les fois que ses
cellules (dont chacune représente, en quelque sorte, une
spore) rencontrent un liquide acide dans lequel fermentent
quelques substances , et présentent une température convenable.
Le tube digestif et les urines présentent ces condilions
; car c’est à tort qu’on a cru que l’existence préalable
de ce Champignon était nécessaire pour que la fermentation
commençât. Il peut bien emporter avec lui la substance
azotée on corps catalytique qui détermine la fermentation,
mais ce n ’est pas lui qui le représente essentiellement. La fermentation
commençante est plutôt une condition nécessaire à
son développement, que le végétal n ’est indispensable à l’appa-
ri tion de ce phénomène chimique (2).
]ja reproduction a lieu par hourgeonnement d’une ou plusieurs
cellules par chacune de celles existant déjà (pl. VIII,
flg. 1, a, b, c, et pl. IV, fig. 4).
; i ) Y o g e l , A n a l, p a th o lo g iq u e g én é ra le . Par is , 18-46, t r a d . f rançaise par
J o u rd a n , iu-8 , p. 387. — Les trois renvois de la page 388 aux Icônes h is to lo -
gira>, Lipsia', 4 8 43, iii-4, sont inexacts ; il n’y a de vcgctanx figurés dans cet
at las que pla n ch e XX, figure 1 à 3 (ils seront cités plus loin), e t planche XI,
l ignresG, 7 e t 8 . Cel te de rniè re représente les cellules de l’Algue du f e rmen t
d ’iiue ma n iè r e exacte, s auf le n oyau qui es t omis dams la p lu p a r t des cellules ;
elles sont figurées d ’après u n cas de vomi s sement , sui te d 'h y p e r t ro p h ie f ibreuse
de l’estomac.
(2) Cn. Robin, Des fe rm e n ta tio n s . Par is , 4 8 4 7 , in -4 .