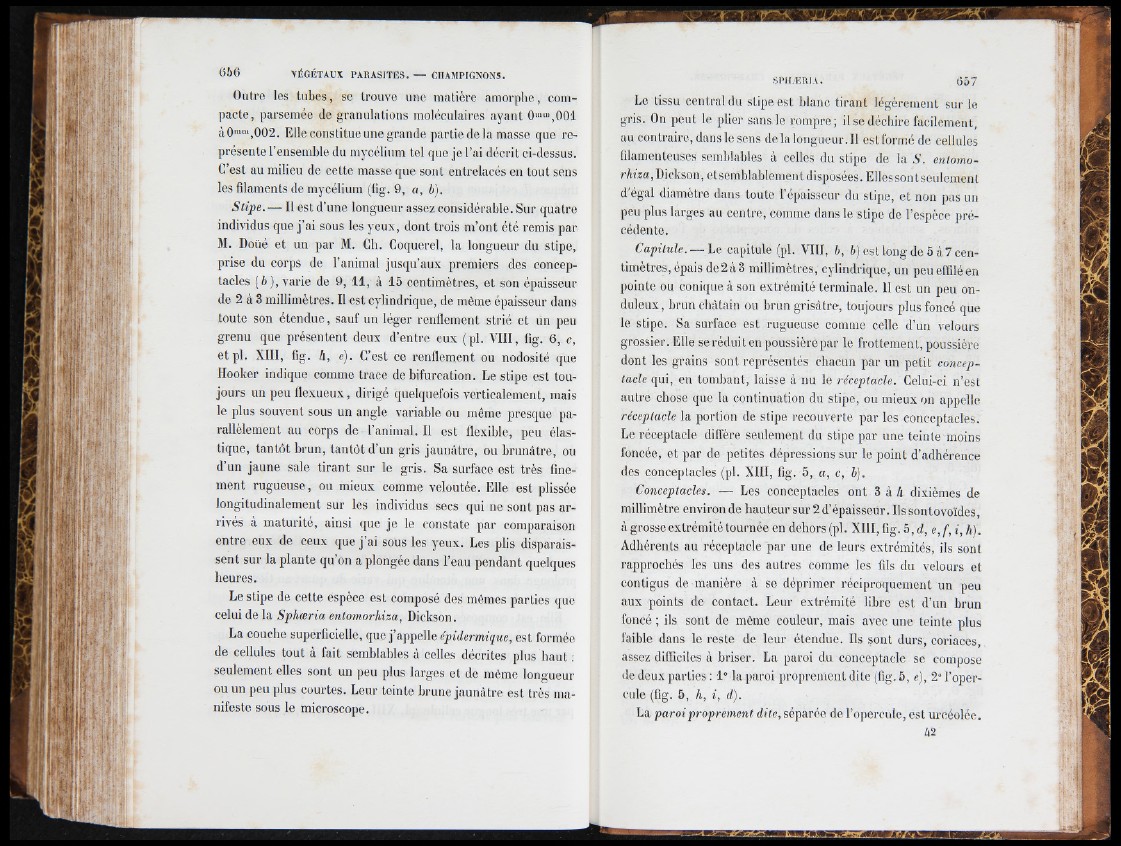
fY' 7 ’
(
!.ü -1
f,
■ l iU ■if? i ;/'' ê ''» ■ k t ■ i
| r , : k
vJS ii-.
i î - ?
H
Outre les tubes, se trouve une matière amorphe, compacte,
parsemée de granulations moléculaires ayant 0 “‘“',001
à0 ''“” ,002. Elle constitue une grande partie de la masse que représente
l’ensemble du mycélium tel que je l’ai décrit ci-dessus.
C’est au milieu de cette masse que sont entrelacés en tout sens
les filaments de mycélium (iig. 9, a, b).
Stipe.— Il est d’une longueur assez considérable. Sur quatre
individus que j ’ai sous les yeux, dont trois m’ont été remis par
M. Doüé et un par M. Ch. Coquerel, la longueur du stipe,
prise du corps de l’animal jusqu’aux premiers des conceptacles
[b], varie de 9, 11, à 15 centimètres, et son épaisseur
de 2 à 3 millimètres. Il est cylindrique, de même épaisseur dans
toute son é ten d u e , sauf un léger renflement strié et un peu
grenu que présentent deux d’entre eux (pl. VIII, üg. 6, c,
e t pl. XIII, flg. h, e). C’est ce renflement ou nodosité que
Hooker indique comme trace de bifurcation. Le stipe est toujours
un peu flexueux, dirigé quelquefois verticalement, mais
le plus souvent sous un angle variable ou même presque parallèlement
au corps de fanimal. H est flexible, peu élastique,
tanlôt brun, tantôt d’un gris jaunâtre, ou brunâtre, ou
d’un jaune sale tiran t sur le gris. Sa surface est très finement
rugueuse, ou mieux comme veloutée. Elle est plissée
longitudinalement sur les individus secs qui ne sont pas arrivés
a maturité, ainsi que je le constate par comparaison
entre eux de ceux que j ’ai sous les yeux. Les plis disparaissent
sur la plante qu’on a plongée dans l’eau pendant quelques
heures.
Le stipe de cette espèce est composé des mômes parties que
celui de la Sphæria entomorhiza, Dickson.
La couche superficielle, que j ’appelle (tpidermif/Me, est formée
de cellules tout à fait semblables à celles décrites plus baut ;
seulement elles sont un peu plus larges et de môme longueur
ou un peu plus courtes. Leur teinte brune jaunâtre est très manifeste
sous le microscope.
S PHÆ R IA . 0 5 /
Le tissu central du stipe est blanc tirant légèrement sur le
gris. Ou peut le plier sans le rompre; il se déchire facilement,
au contraire, dansleseiis d e la lo n g u e u r.il estformé de cellules
filamenteuses semblables à celles du stipe de la S . entomorhiza,
Dickson, et sembiablemeiit disposées. Elles sont seulement
d’égal diamètre dans toute l’épaisseur du stipe, et non pas im
peu plus larges au centre, comme dans le stipe de l’espèce précédente.
Capitule. — Le capitule (pl. VHI, b, 4) est long de 5 à 7 centimètres,
épais d e 2 à 3 millimètres, cylindrique, un peu efliléen
pointe ou conique à son extrémité terminale. 11 est un peu onduleux,
brun châtain ou brun grisâtre, toujours plus foncé que
le stipe. Sa surface est rugueuse comme celle d’un velours
grossier. Elle se réduit en poussière par le frottement, poussière
dont les grains sont représentés chacun par un petit conceptacle
qui, en tombant, laisse à nu le réceptacle. Celui-ci n ’est
autre cbose que la continuation du stipe, ou mieux on appelle
réceptacle la portion de stipe recouverte par les conceptacles.
Le réceptacle diffère seulement du slipe par une teinte moins
foncée, et par de petites dépressions sur le point d’adhérence
des conceptacles (pl. XIII, fig. 5, a, c, b).
Conceptacles. — Les conceptacles ont 3 à A dixièmes de
millimètre environ de hauteur sur 2 d’épaisseur. Ils sontovoides,
à grosse extrémité tournée en dehors (pl. XIH, fig. 5, d, e,f, i, h).
Adhérents au réceptacle par une de leurs extrémités, ils sont
rapprochés les uns des autres comme les fils du velours et
contigus de manière à se déprimer réciproquement un peu
aux points de contact. Leur extrémité libre est d’un brun
foncé ; ils sont de même couleur, mais avec une teinte plus
faible dans le reste de leur étendue. Ils sont durs, coriaces,
assez difficiles â briser. La paroi du conceptacle se compose
de deux parties : 1° la paroi proprement dite (fig, 5, e), 2° l’opercule
(flg. 5, h, i, d).
La paroi proprement dite, séparée de l ’opercule, est urcéolée.
42
i