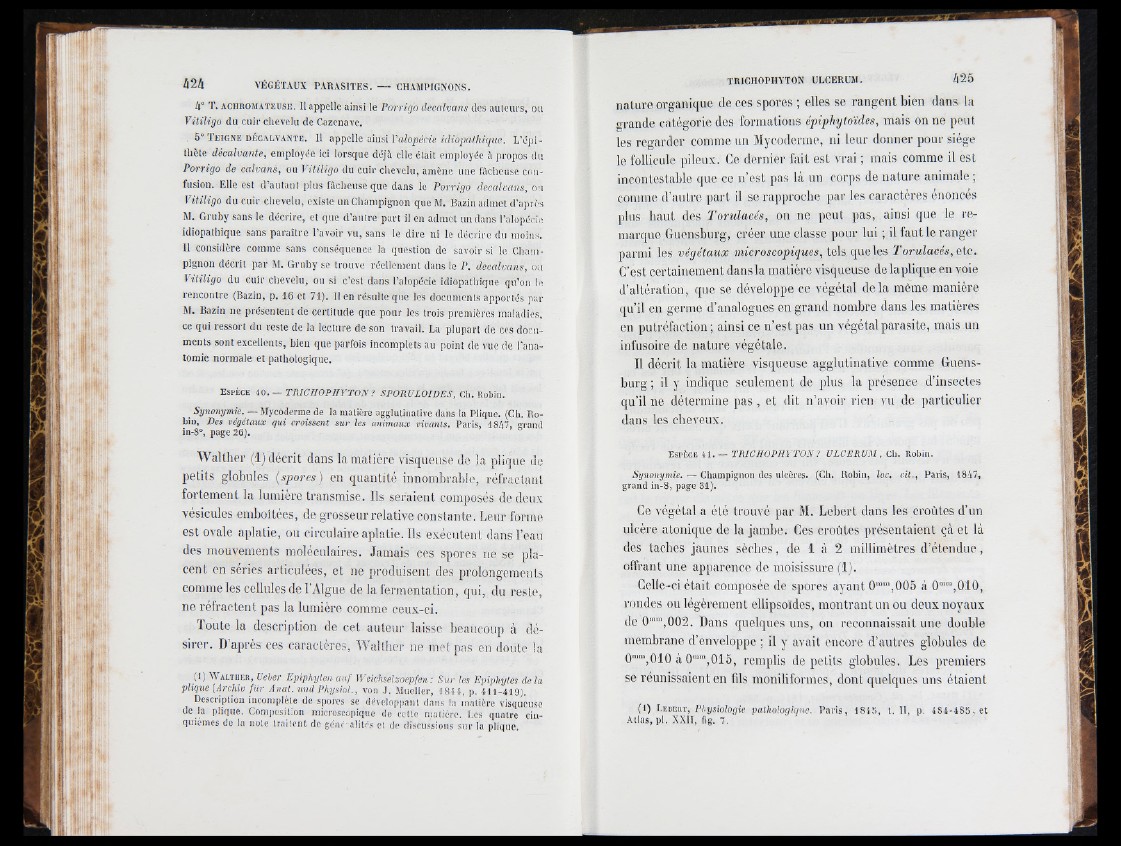
11M
à° T. ACHROJiATEUSE. 11 appe l le ains i le P o r r ig o d e c a lv a n s des a i l le u r s , on
V i t i l ig o dll c u i r cl ieveUi d e Cazenave.
5 ° T e i g n e DÉCALVANTE. 11 a p p o lla a in si V a lo p é n e id i o p a th iq u e . L ’é p i -
tl iète d é c a lv a n te , emp lo y é e ici lo r s q u e d é j à elle élai t emp lo y é e à p ro p o s d u
P o r r ig o d e c a l v a n s , ou V i t i l ig o d u c u i r c h e v e lu , am è n e u n e lâ ch eu s e c o n fu
s ion. Elle es t d ’a u t a n t p lus fàcl ieuse q u e d a n s le P o r r ig o d e c a lv a n s , on
V i t i l ig o d u c u i r c h e v e lu , exi s te u n Cl iamp ig n o n q u e M. Bazin a dm e t d ’a p r è s
M. G r u b y s an s le d é c r i r e , e t q n e d ’a n t r e p a r t il en a dm e t im d a n s l’alopécie
id io p a lh iq u c s an s p a r a î t r e l ’av o i r v u , s an s le d i r e n i le d é c r i r e d u mo in s .
11 c o n s id è r e c om m e s an s c o n s é q u e n c e la q u e s t io n d e savoi r si le Cl iam-
p ig n o n d é c r i t p a r M. G r n b y se t r o u v e r é e l lem e n t d a n s le P . d e c a lv a n s , on
M t i l ig o d u c u i r c h e v e lu , on si c ’es t d a n s l’alopécie id io p a tb iq n e q u ’on li'
r e n c o n t r e (Bazin, p. 1 6 et 71) . 11 e n r é su l te q n e les d o c um e n t s a p p o r t é s p a r
M. Baz in n e p r é s e n t e n t d e c e r t i tu d e q u e p o u r les t roi s p r em i è r e s ma lad ie s ,
ce q u i r e s so r t d u r e s te d e la le c tu r e d e son t r a v a i l . La p lu p a r t d e ces d o c u m
e n t s so n t e xc e l le nts , bien q u e p a r fo i s in c omp le t s au poin t d e vue d e l 'ana -
tomie n o rm a l e e t p a th o lo g iq u e .
EsrÈCE iO. — T R IC H O P H Y TO N ? SPO RU LO ID E S , Cb. R o b in .
Synonymie . — Mycoderme de la matière agglutinative dans la Plique. (Ch. Robin,
Des végétaux qui croissent sur les animaux vivants . Paris , 1847, s r a n d
in-8», page 2G).
Wa lthe r (1) décrit dans la matière visqueuse de la plique de
petits globules (spores) en quantité innombrable, réfraclant
forlement la lumière transmise. Us seraient composés de deux
vésicules emboîtées, de grosseur relative constante. Leur forme
esl ovale aplatie, ou circulaire aplatie. Ils exécutenl dans l’eau
des mouvements moléculaires. Jamais ces spores ne se placent
en séries articulées, et ne produisent des prolongements
comme les cellules de l’Algue de la fermentation, qui, du reste,
ne réfractent pas la lumière comme ceux-ci.
Jo u te la description de cet auteur laisse beaucoup à désirer.
D’après ces caractères, AValÜicr ne met pas en doute la
(I) W a l i u e b , Veher E p ip h y le n a u f iV eich selzo ep fen : S u r les E p ip h y te s de la
p h q u e {Archiv fi ir A n a t. u n d P h y s io l., von ,1. Mnolicr, 1844, p. 41 1 - 4 1 9 ).
Descrip tiou incomplète de spores se développant dans la ma t iè re visqueuse
de la plique. Conijiosit.on microscopique de ccUc niatièrc. Les q u a t r e cinquièmes
de la note Ir.aüent de g ènr alités et de discussions su r la plique.
nature organique de ces spores ; elles se rangent bien dans la
grande catégorie des formations épiphyloïdes, mais on ne peut
les regarder comme im Mycoderme, ni leur donner pour siège
le follicule pileux. Ce dentier fait est vrai ; mais comme il est
incoiiteslable que ce n ’est pas là un corps de nature animale ;
comme d’antre part il se rapproche par les caractères énoncés
plus haut des Torulacés, ou ne peut pas, ainsi que le remarque
Cucnshurg, créer une classe pour lui ; il faut le ranger
parmi les végétaux microscopiques, tels queles Torulacés, etc.
C’est certainement dansla matière visqueuse delaplique en voie
d’altération, que se développe ce végétal d e là même manière
qu’il en germe d’analogues en grand nomhre dans les matières
en putréfaction; ainsi ce n ’est pas un végétal parasite, mais un
infusoire de nature végétale.
Il décrit la matière visqueuse agglutinative comme Gueus-
h u rg ; il y indique seulement de plus la présence d’insectes
qu’il ne détermine pas , et dit n ’avoir rien vu de particulier
dans les cheveux.
ESPÈCE 4 1 . — T R IC H O P H Y TO N ? Ü LCE RUM , Cb. Robin.
S yn o n ym ie . — Champignon ties ulcères. (Gh. Robin , loc, c it., Paris , 1847,
g rand in-8, page 31).
Ce végétal a été trouvé par M. Lehert dans les croûtes d’un
ulcère alonique de la jambe. Ces croûtes présentaient çà et là
des taches jaunes sèches, de 1 à 2 millimètres d’é tendue ,
offrant une apparence de moisissure li).
Celle-ci était composée de spores ayant 0"’"',005 à 0'”"’,0.10,
rondes ou légèrement ellipsoïdes, montrant un ou deux noyaux
de 0'""',002. Dans quelques uns, on reconnaissait une double
membrane d’enveloppe ; il y avait encore d’autres globules de
0""",010 à O”“",015, remplis de petits globules. Les premiers
se réunissaient en fils moniliformes, dont quelques uns étaient
(1) Ir.BERi, P h y sio lo g ie p a lh o lo g iq u e . l’.i r i s , t8 t r>, t. Il, p. 4 8 4 - 4 8 5 , et
Allas, pl. XXII, fig. 7.
I