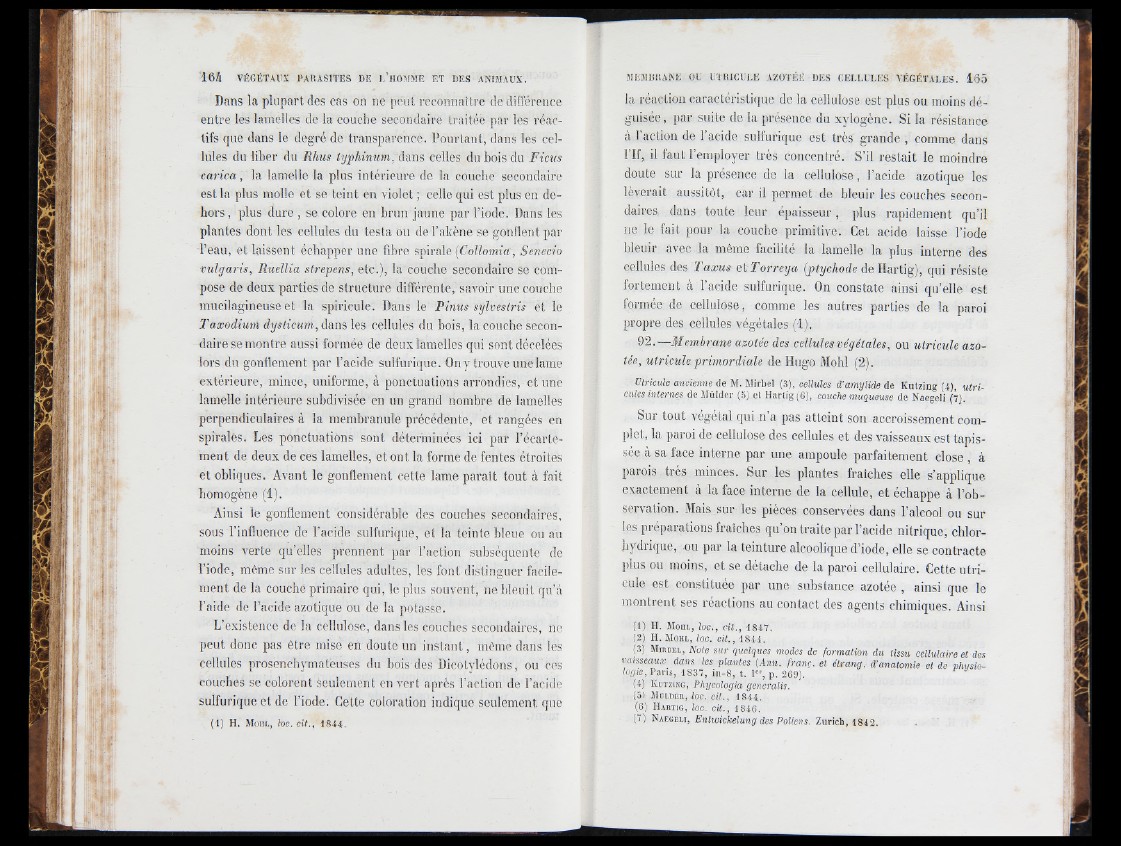
J A i ' ‘i. |ï-'. : ■)." t
Sj' F ' ■!
■/'
(■j
Dans la plupart des cas on ne peut reconnaître dediflérence
entre les lamelles de ia couche secondaire li'aitée par les réactifs
que dans le degré de transparence. PourUint, dans les cellules
du liber du Ràus tijphinum, dans celles du bois du Ficus
carica, la lamelle la plus intérieure de la couche secondaire
est la plus molle et se teint en violet ; celle qni est plus en dehors
, plus dure , se colore en brun jaune par l’iode. Dans les
plantes dont les cellules du testa ou de l’akène se gonflent par
Peau, et laissent échapper une fd)re spirale [Collomia, Senecio
vidgaris, Ruellia strepcns, etc.), la couche secondaire se compose
de deux parties de structure différente, savoir une couche
nmcilagineuse et la spiricule. Dans le Pinus sglvesiris et le
Taxodium dysticum, dans les cellules du bois, la couche secondaire
se montre aussi formée de deux lamelles qui sont décelées
lors du gonilement par l’acide sulfurique. On y trouve une lame
extérieure, mince, uniforme, à ponctuations arrondies, et une
lamelle intérieure subdivisée en un grand nombre de lamelles
perpendiculaires à la membranule précédente, et rangées en
spirales. Les ponctuations sont déterminées ici par l’écarte-
ment de deux de ces lamelles, et ont la forme de fentes étroites
et obliques. Avant le gonflement cette lame paraît tout à fait
homogène (1).
Ainsi le gonilement considérable des couches secondaires,
sous l’influence de l’acide sulfurique, et la teinte bleue ou au
moins verte qu’elles prennent par l’action subséquente de
l’iode, môme sur les cellules adultes, les font distinguer facilement
de la couche primaire qui, le plus souvent, ne Ideiiit qu’à
l’aide de l’acide azotique ou de la potasse.
L’existence de la cellulose, dans les couches secondaires, ne
peut donc pas être mise en doute un in s ta n t, môme dans les
cellules prosenchyrnateuses du bois des Dicotvlcdons, ou ces
couches se colorent seulement en vert après l’action de l’acide
sulfurique et de l’iode. Cette coloration indique seulement que
(1) H, Mohl , loc. ci t . , 1844.
.VEMDliAKE ü i ETliiCUEE AZOTÉE DES CELLLLES VÉGÉTALES. 165
la réaction caractéristi(|ue de la cellulose est plus ou moins déguisée,
par suite de la présence du xylogène. Si la résistance
à l’action de l’acide sulfurique est très grande , comme dans
r if , il faut l’employer très concentré. S’il resta it le moindre
doute sur la présence de la cellulose, l’acide azotique les
lèverait aussitôt, car il permet de bleuir les couches secondaires
dans toute leur épaisseur , plus rapidement qu’il
ne le fait pour la couche primitive. Cet acide laisse l ’iode
bleuir avec la même facilité la lamelle la plus interne des
cellules des Ta xu s e tTo r r e ya (ptychode de Hartig), qui résiste
fortement à l’acide sulfurique. On constate ainsi qu’elle est
formée de cellulose, comme les autres parties de la paroi
propre des cellules végétales (i).
9 2 .—Membrane azotée des cellules végétales, ou utricule azotée,
utricule primordiale de Hugo Mold (2).
Vlricule ancienne de M. Mirb el (3), cellules d'amylide de Kützing (4), ut r i -
atles internes de Mülder (3) e t Har t ig (6), couche muqueuse de Naegeli (7).
Sur tout végétal qui n ’a pas atteint son accroissement complet,
la paroi de cellulose des cellules et des vaisseaux est tapissée
à sa face interne par une ampoule parfaitement close , à
parois très minces. Sur les plantes fraîches elle s’applique
exactement à la face interne de la cellule, et échappe à l’observation.
Mais sur les pièces conservées dans l’alcool ou sur
les préparations fraîches qu on traite par l’acide nitrique, chlor-
îiydrique, ou par la teinture alcoolique d ’iode, elle se contracte
plus ou moins, et se détacbe de la paroi cellulaire. Cette u tricule
est constituée par une substance azotée , ainsi que le
montrent ses réactions au contact des agents chimiques. Ainsi
(1) H. Mo h l , loc., ci t . , 1847,
(2) H. Mo u l , loc. ci t., ¡ 8 4 4 .
(3) Mi rb e l , Noie sur quelques modes de format ion du tissu cellu laire et des
vatsseoMx^ dans les plantes {.inn. f ranc, et él rang. d ’anatomie el de phys iologie,
P a n s , 18 3 7 , in -8 , t . l ' q p. 269).
(4) Ku t z in g , Phycologia gencralis.
(31 M u l d e r , loc. ci t . , 1 8 4 4 .
(6) H a r t i g , loc. ci t., 1846.
( 0 Na eg e l i , Entwickelung des Pollens. Zur ich, 1842.
I
ÏI..A i