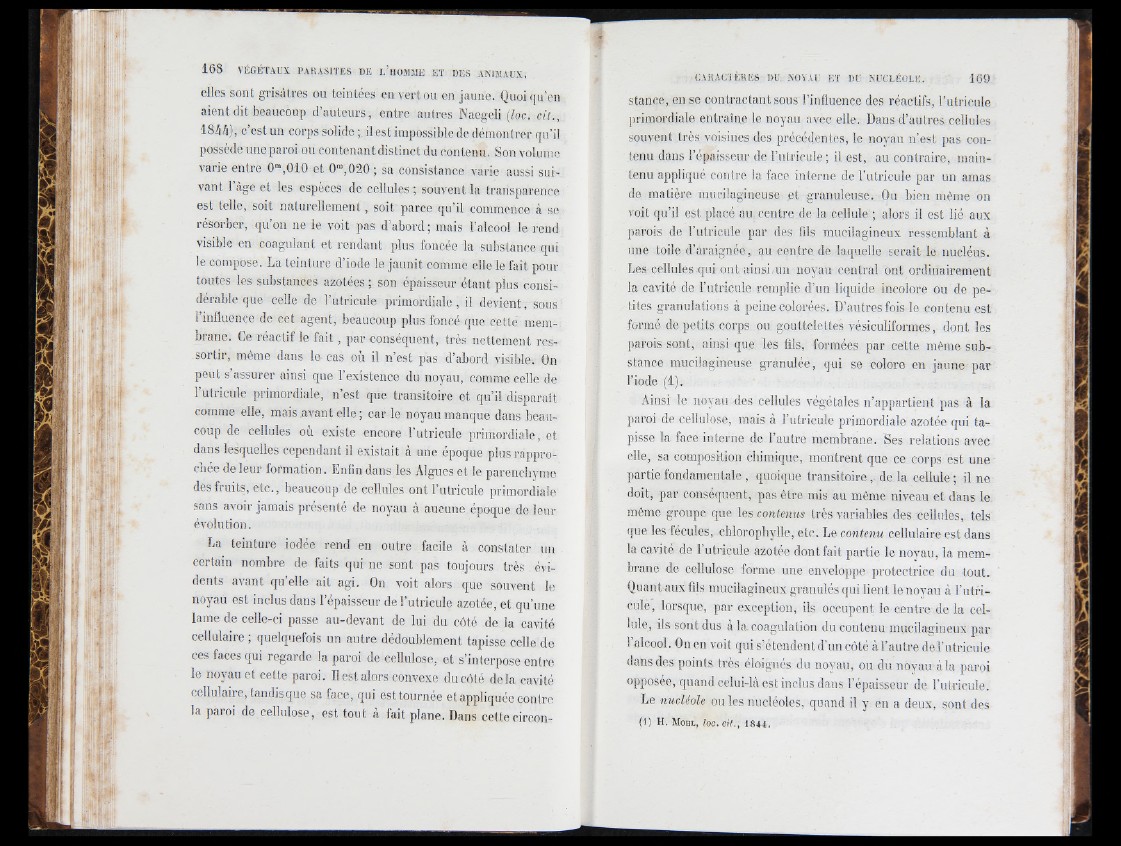
elles sont grisâtres ou teintées en vert ou en jaune. Quoiiju’en
aient dit beaucoup d ’au teu rs, entre autres Naegeli (7oc. cit.,
1844), c’est un corps solide; il est impossible de démonlrer qu’il
possède une paroi ou contenantdistinct du contenu, Son volume
varie entre 0” ,010 et 0™,020 ; sa consistance varie aussi suivant
Fàge et les espèces de cellules; souvent la transparence
est telle, soit n a tu re llem en t, soit parce qu’il commence à se
résorber, qu’on ne ie voit pas d’abord; mais l ’alcool le rend
visible en coagulant et rendant plus foncée la substance qui
le compose. La teinture d’iode le jau n it comme elle le fait pour
toutes les substances azotées ; son épaisseur étant plus considérable
que celle de l’utricule primordiale, il devient, sous
l’inikience de cet agent, beaucoup plus foncé que cette membrane.
Ce réactif le fait , par conséquent, très nettement ressortir,
même dans le cas où il n ’est pas d’abord visible. On
peut s’assurer ainsi que l’existence du noyau, comme celle de
1 utricule primordiale, n ’est que transitoire et qu’il disparaît
comme elle, mais avant elle ; car le noyau manque dans beaucoup
de cellules où existe encore Futricule primordiale, et
dans lesquelles cependant il existait cà une époque plus rapprochée
de leur formation. Enfin dans les Algues et le parenchyme
des fruits, etc., beaucoup de cellules ont l’ulricule primordiale
sans avoir jamais présenté de noyau à cTucune époque de leur
évolution.
La teinture iodée rend en outre facile à constater uu
certain nombre de faits qui ne sont pas toujours très évidents
avant qu’elle ait agi. On voit iilors que souvent le
noyau est inclus dans rép£iisseur de Futricule azotée, et qu’une
lame de celle-ci passe au-devant de lui du côté de la CcTvité
cellulaire ; quelquefois un autre dédoublement tapisse celle de
ces faces qui regarde la paroi de cellulose, et s’interpose entre
le noyau et cette pcTroi. Il est alors convexe du côté d elà cavité
cellulaire, tandis que sa face, qui esttournée etappliquée contre
la paroi de cellulose, est tout à fait plane. Dans cette circonstance,
en se contractant sous riniluence des réactifs, l’utricule
primordiale entraîne le noyau avec elle. Dans d’autres cellules
souvent très voisines des précédentes, le noyau n ’est pas contenu
dans l’épaisseur de Futricule ; il est, au contraire, maintenu
appliqué contre la face interne de Futricule par un amas
de matière nmcilagineuse et granuleuse. Ou bien même on
voit qu’il est placé au centre de la cellule ; alors il est lié aux
parois de ru tricu le par des fils mucilagineux ressemblant à
une toile d’araignée, au centre de laquelle serait le nucléus.
Les cellules qui ont ainsi un noyau central ont ordinairement
la cavité de Futricule remplie d’un liquide incolore ou de petites
granulations à peine colorées. D’autres fois le contenu est
formé de petits corps ou gouttelettes vésiculifonnes, dont les
parois sont, ainsi que les fils, formées par cette même substance
mucüagineuse granulée, qui se colore en jaune par
l’iode (1).
Ainsi le noyau des cellules végétales n ’appartient pas à la
paroi de cellulose, mais à Futricule primordiale azotée qui tapisse
la face interne de l’autre membrane. Ses relations avec
elle, sa composition cbimique, montrent que ce corps est une
partie fondamentale , quoique transitoire , de la cellule ; il ne
doit, par conséquent, pas être mis au même niveau et dans le
même groupe que les contenus très varialyles des cellules, tels
que les fécules, cldoropbylle, etc. Le contenu cellulaire est dans
la cavité de Futricule azotée dont fait partie le novau, la membrane
de cellulose forme une enveloppe protectrice du tout.
Quant aux fils mucilagineux granulés qui lient le noyau à l’u tri-
cule, lorsque, par exception, ils occupent le centre de la cellule,
ils sont dus à la coagulation du contenu mucilagineux par
l’alcool. On en voit qui s'étendent d’un côté à l ’autre de Futricule
dans des points très éloignés du noyau, ou du noyau àia paroi
opposée, quand celui-là est inclus dans l ’épaisseur de Futricule.
Le nucléole ou les nucléoles, quand il y en a deux, sont des
(1) H. Mohl, loc. cit. , 1844.
I