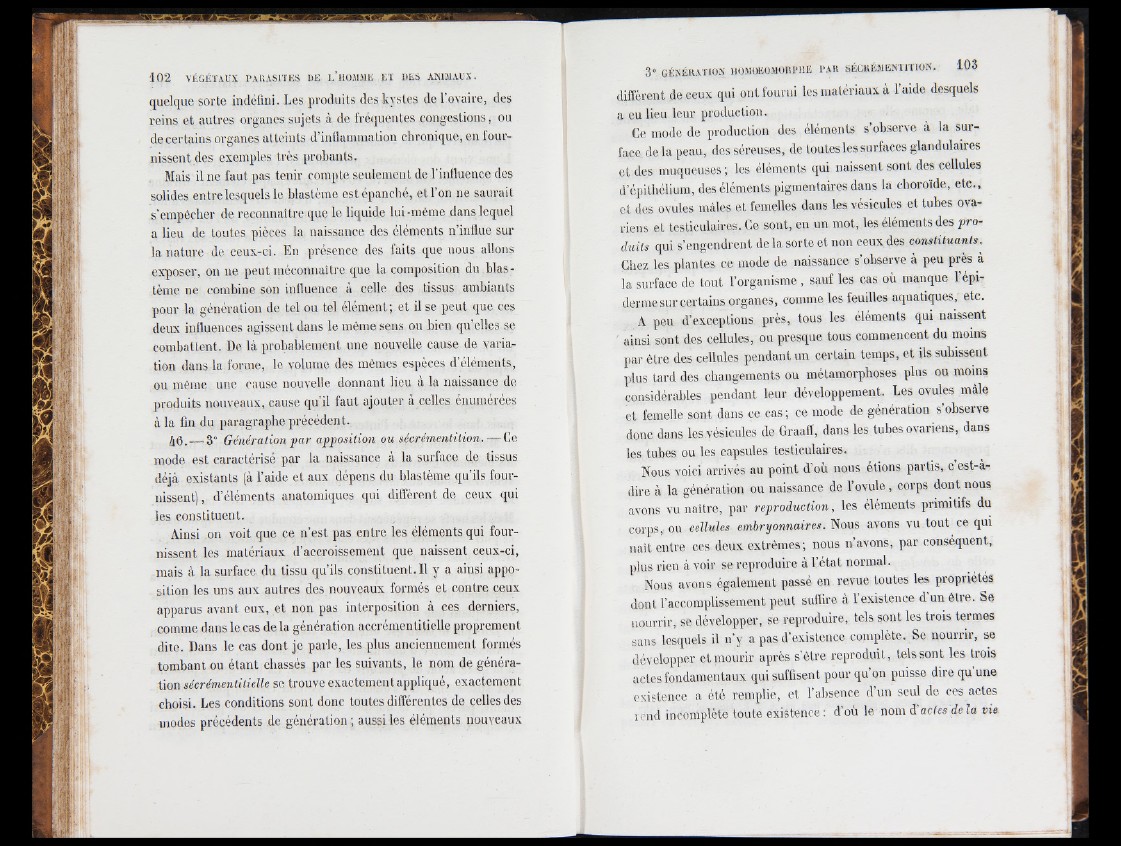
u-■ü fit
i«iL I
*■’¡3
AM'.
/|3
1 0 2 VÉGÉTAUX l'AUASlTTiS DE l . ’üOMJlE ET DES ANIJIAÜX.
quelque sorte iiKlélini. Les produits des kystes de l’ovaire, des
reins et autres organes sujets à de fréquentes congestions, ou
de certains organes atteints d’inllainination clironique, en fournissent
des exemples très probants.
Mais il ne faut pas tenir compte seulement de l’intluence des
solides entre lesquels le blastème est épanché, et l’on ne saurait
s’empêcher de reconnaître que le liquide lui-môme dans lequel
a lieu de toutes pièces la naissance des éléments n ’iullue sur
la nature de ceux-ci. En présence des faits que nous allons
exposer, on ne peut méconnaître que la composition du bla stème
ne combine son influence à celle des tissus ambiants
pour la génération de tel ou tel élément; et il se peut que ces
deux influences agissent dans le môme sens on bien qu’elles se
combattent. De là probablement une nouvelle cause de variation
dans la forme, le volume des mômes espèces d’éléments,
ou même une cause nouvelle donnant lieu à la naissance de
produits nouveaux, cause qu’il faut ajouter à celles énumérées
à la fin du paragraphe précédent.
/,6..— 3“ Génération p a r apposition ou sécrémentition.— Ce
mode est caractérisé par la naissance à la surface de tissus
déjà existants (à l’aide et aux dépens du blastème qu’ils fournissent),
d’éléments anatomiques qui diffèrent de ceux qui
les constituent.
Ainsi on voit que ce n ’est pas entre les éléments qui fournissent
les matériaux d’accroissement que naissent ceux-ci,
mais à la surface du tissu qu’ils co n s litu en t.il y a ainsi apposition
les uns aux autres des nouveaux formés et contre ceux
apparus avant eux, e t non pas interposition à ces derniers,
comme dans le cas de la génération accrémentitielle proprement
dite. Dans le cas dont je parle, les plus anciennement formés
tombant ou étan t chassés par les suivants, le nom de génération
se trouve exactement appliqué, exactement
choisi. Les conditions sont donc toutes différentes de celles des
modes précédents de génération ; aussi les éléments nouveaux
3 “ GÉNÉH.VnOiN )10.MüE0 .>miîl>iiE l’AH SÉCHÉ-MEN'llTTON. 1 0 3
diffèrent de ceux qui ont fourni les matériaux à la id e desquels
a eu lieu leur production.
Ce mode de production des éléments s’observe à la surface
d e là peau, des séreuses, de toutes les surfaces glandulaires
e t des muqueuses; les éléments qui naissent sont des cellules
d’épithélium, des éléments pigmentaires dans la choroïde, etc.,
cl des ovules mâles et femelles dans les vésicules et tubes ovariens
et testiculaires. Ce sont, en un mot, les éléments des produits
qui s’engendrent d e là sorte et non ceux des constituants.
Chez les plantes ce mode de naissance s’observe à peu près à
la surface de tout l’o rg an ism e, sauf les cas où manque l’épi-
dermesur certains organes, comme les feuilles aquatiques, etc.
A peu d’exceptions près, tous les éléments qui naissent
ainsi sont des cellules, ou presque tous commencent du moins
par être des cellules pendant un certain temps, et ils subissent
plus tard des changements ou métamorphoses pins ou moins
considérables pendant leur développement. Les ovules mâle
ct femelle sont dans ce cas ; ce mode de génération s’observe
donc dans les vésicules de Graaff, dans les tubes ovariens, dans
les tubes ou les capsules testiculaires.
Nous voici arrivés au point d’où nous étions partis, c est-à-
dire à la génération ou naissance de l’o vule, corps dont nous
avons vu naître, par reproduction, les éléments primitifs du
corps, ou cellules embryonnaires. Nous avons vu to u t ce qui
naît entre ces deux extrêmes; nous n ’avons, par conséquent,
plus rien à voir se reproduire à l’é ta t normal.
Nous avons également passé en revue toutes les propriétés
dont raccomplisseinent peut suffire à l’existence d un être. Se
nourrir, se développer, se reproduire, tels sont les trois termes
sans lesquels il n ’y a pas d’existence complète. Se nourrir, se
développer et mourir après s’ètre reproduit, tels sont les trois
actes fondamentaux qui suffisent pour qu’on puisse dire qu’une
existence a été remplie, el l’absence d’nn seul de ces actes
icnd incomplète toute existence : d’où le nom d actes de la vie
i