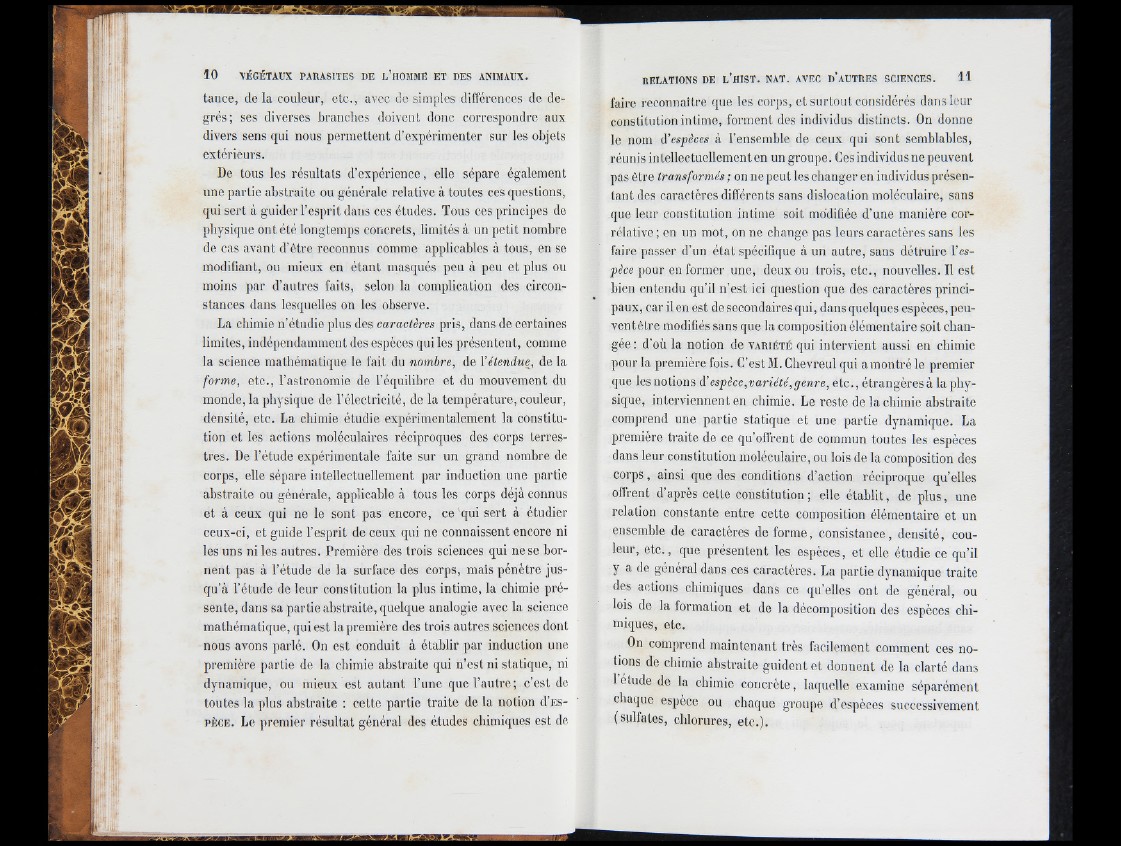
m
10 VÉGÉTAUX p a r a s i t e s DE l ’hOMME ET DES ANIMAUX,
tance, d e là couleur, etc., avec do simples différences do degrés;
ses diverses branches doivent donc correspondre aux
divers sens qui nous permettent d’expérimenter sur les objets
extérieurs.
De tous les résultats d’expérience, elle sépare également
une partie abstraite ou générale relative à toutes ces questions,
qui sert à guider l’esprit dans ces études. Tous ces principes de
physique ont été longtemps concrets, limités à un petit nombre
de cas avant d’être reconnus comme applicables à tous, en se
modifiant, ou mieux en étan t masqués peu à peu et plus ou
moins par d’autres faits, selon la complication des circonstances
dans lesquelles on les observe.
La chimie n ’étudie plus des caractères pris, dans de certaines
limites, indépendamment des espèces qui les présentent, comme
la science mathématique le fait du nombre, de Xétendiie, de la
forme, etc., f astronomie de f équilibre et du mouvement du
monde, la physique de l’électricité, de la température, couleur,
densité, etc. La chimie étudie expérimentalement la constitution
et les actions moléculaires réciproques des corps terrestres.
De fé tu d e expérimentale faite sur un grand nombre de
corps, elle sépare intellectuellement par induction une partie
abstraite ou générale, applicable à tous les corps déjà connus
et à ceux qui ne le sont pas encore, ce 'qui sert à étudier
ceux-ci, et guide l’esprit de ceux qui ne connaissent encore ni
les uns ni les autres. Première des trois sciences qui ne se born
en t pas à fé tu d e de la surface des corps, mais pénètre jusqu’à
fé tu d e de leur constitution la plus intime, la chimie présente,
dans sa partie abstraite, quelque analogie avec la science
mathématique, qui est la première des trois autres sciences dont
nous avons parlé. On est conduit à établir par induction une
première partie de la chimie abstraite qui n ’est ni statique, ni
dynamique, ou mieux est au tan t l’une que f au tre ; c’est de
toutes la plus abstraite : cette partie traite de la notion d ’E S -
PÈC E . Le premier résultat général des études chimiques est de
r e l a t io n s d e l ’h i s t . n a t . a v e c d ’a u t r e s s c i e n c e s . 1 1
faire reconnaître que les corps, et surtout considérés dans leur
constitution intime, forment des individus distincts. On donne
le nom d'espèces à l’ensemble de ceux qui sont semblables,
réunis intellectuellement en un groupe. Ces individus ne peuvent
pas être transformés ; on ne peut les changer en individus présentant
des caractères différents sans dislocation moléculaire, sans
que leur constitution intime soit modifiée d’une manière corrélative
; en un mot, on ne change pas leurs caractèi'es sans les
faire passer d’un é ta t spécifique à un autre, sans détruire f espèce
pour en former une, deux ou trois, etc., nouvelles.il est
bien entendu qu’il n ’est ici question que des caractères principaux,
car ilen est de secondaires qui, dans quelques espèces, peu-
ventôlre modifiés sans que la composition élémentaire soit changée;
d’où la notion de v a r i é t é qui intervient aussi en chimie
pour la première fois. C’est 31. Chevreul qui am o n tré le premier
que les notions d’espèce,variété, genre, etc., étrangères à la physique,
interviennent en chimie. Le reste de la chimie abstraite
comprend une partie statique et une partie dynamique. La
première traite de ce qu’offrent de comnnin toutes les espèces
dans leur constitution moléculaire, ou lois de la composition des
co rp s , ainsi que des conditions d’action réciproque qu’elles
offrent d’après cette constitution ; elle étab lit, de plus, une
relation constante entre cette composition élémentaire et un
ensemble de caractères de forme, consistance, densité, couleur,
e tc ., que présentent les espèces, et elle étudie ce qu’il
y a de général dans ces caractères. La partie dynamique traite
des actions chimiques dans ce qu’elles ont de général, ou
lois de la formation et de la décomposition des espèces chi-
niiques, etc.
On comprend maintenant très facilement comment ces notions
de chimie abstraite guident et donnent de la clarté dans
1 étude de la chimie concrète, laquelle examine séparément
chaque espèce ou chaque groupe d’espèces successivement
(sulfates, chlorures, etc.).