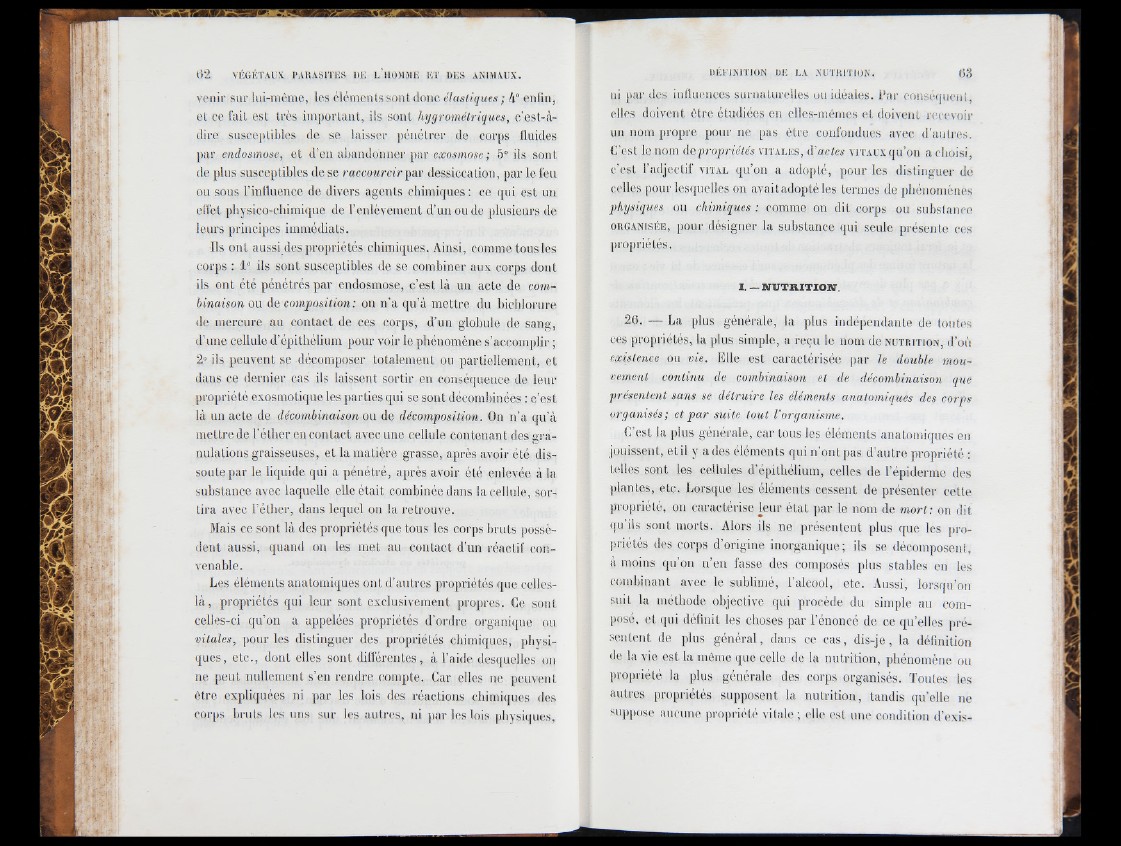
h
t)-2 VIiGKT.VUX l'AüASlTTiS DE L HOMME ET DES ANIMAUX.
voiiii' sur lui-môme, les éiéments sont doue élastiques ; h“ oiilin,
et ce fait est très important, ils sont hygrométriques, c’est-à-
ilire susceptibles de se laisser pénétrer de corps Iluides
par endosmose, ct d ’en abandomier par OEos'moie; 5“ ils sont
de plus susceptibles de se raccourcir par dessiccation, par le l'eu
ou sous l’iulluence de divers agents chimiques: ce qui est im
elTet physico-chimique de l’enlèvCment d’un ou de plusieurs de
leurs principes immédiats.
Ils ont aussi des propriétés chimiques. Ainsi, comme tousles
corps : 'i" ils sont susceptibles de se combiner aux corps dont
ils ont été pénétrés par endosmose, c’est là uii acte de combinaison
ou de composition : on n ’a qu’à mettre du bicblorure
de mercure au contact de ces corps, d’un globule de sang,
d’une cellule d’épitbélium pour voir le phénomène s’accomplir ;
2“ ils peuvent se décomposer totalement ou partieüeraent, et
dans ce dernier cas ils laissent sortir eu conséquence de leur
propriété exosmotique les parties qui se sont décondjinées : c’est
là un acte de décombinaison ou de décomposition. On n ’a qu’à
mettre de l’étber en contact avec une cellule contenant des granulations
graisseuses, et la matière grasse, après avoir été dissoute
par le liquide qui a pénétré, après avoir été enlevée à la
substance avec laquelle elle était combinée dans la cellule, sortira
avec i’étber, dans lequel on la retrouve.
Biais ce sont là des propriétés que tous les corps liruts possèdent
aussi, quand on les met an contact d’un réactif convenable.
Les éléments anatomiques ont d’antres propriétés que celles-
là , propriétés qui leur sont exclusivement propres. Ce sont
celles-ci qu’on a appelées propriétés d’ordre organique ou
vitales, pour les distinguer des propriétés chimiques, |)bysi-
ques, etc., dont elles sont dilférentes, à l’aide desquelles on
ne peut nullement s’en rendre compte. Car elles ne peuvent
être expliquées ni par les lois des réactions chimiques des
corps bruts les uns sur les autres, ui ¡lar les lois pbysiipics,
DÉi-TiMTION DE LA N i :T ! t r r (O N . (Lt
ui [)ar des ¡uilmmces sunialurelles ou idéales. Par coiiséipH'ui,
elles doivent être étudiées eu elles-mêmes et doivent recevoii'
un nom propre pour ne pas être conloiidues avec d’autres.
C’est le nom Ac propriétés vitales, A’actes vitaux qu’oa a choisi,
c’est l’adjcctif vital qu’on a adopté, pour les distinguer de
celles pour lesquelles on avait adopté les termes de ])bénomènes
physiques ou chimiques : comme on dit corps ou subslaiice
OKGANISKE, poui’ désiguer la substance qui seule présente ces
[ii’opriélés.
I. — HrUTRITIOBI.
26. — La plus générale, la plus indépendante de toutes
ces propi’iétés, la plus simple, a reçu lo nom de nutrition, d’oii
existence ou vie. Elle est caractérisée par h double mouvement
continu de combinaison et de décombinaison que
présentent sans se détruire les éléments anatomiques des corps
organisés; et p a r suite tout l’organisme.
C est la plus générale, car tous les éléments anatomiques en
jouissent, e lil y a des éléments qui n ’ont pas d'autre propriété :
telles sont les cellules d’épitbélium, celles de l’épiderme des
plantes, etc. Lorsque les éléments cessent de présenter cette
propriété, on caractérise leur état par le nom de mort: on dit
qu ils soul morts. Alors ils ne présentent plus que les jiro-
pi'iétés des corps d ’origiue inorganique; ils se décomposent,
à moins qu’ou n ’eu fasse des composés plus stables en les
combiiumt avec le sublimé, l’alcool, etc. Aussi, lorsqu’on
suit la méthode objective qui procède du simple au compose,
et qui définit les choses par l’énoncé de ce qu’elles présentent
de plus géné ral, dans ce cas, dis-je , la définition
de la vie est la môme que celle de la nutrition, phénomène ou
propriété la plus générale des corps organisés. Toutes les
autres propriétés supposent la n utrition, tandis qu’elle ne
suppose aucune jiropriélé vilale; elle esl une condition d’oxisf
î