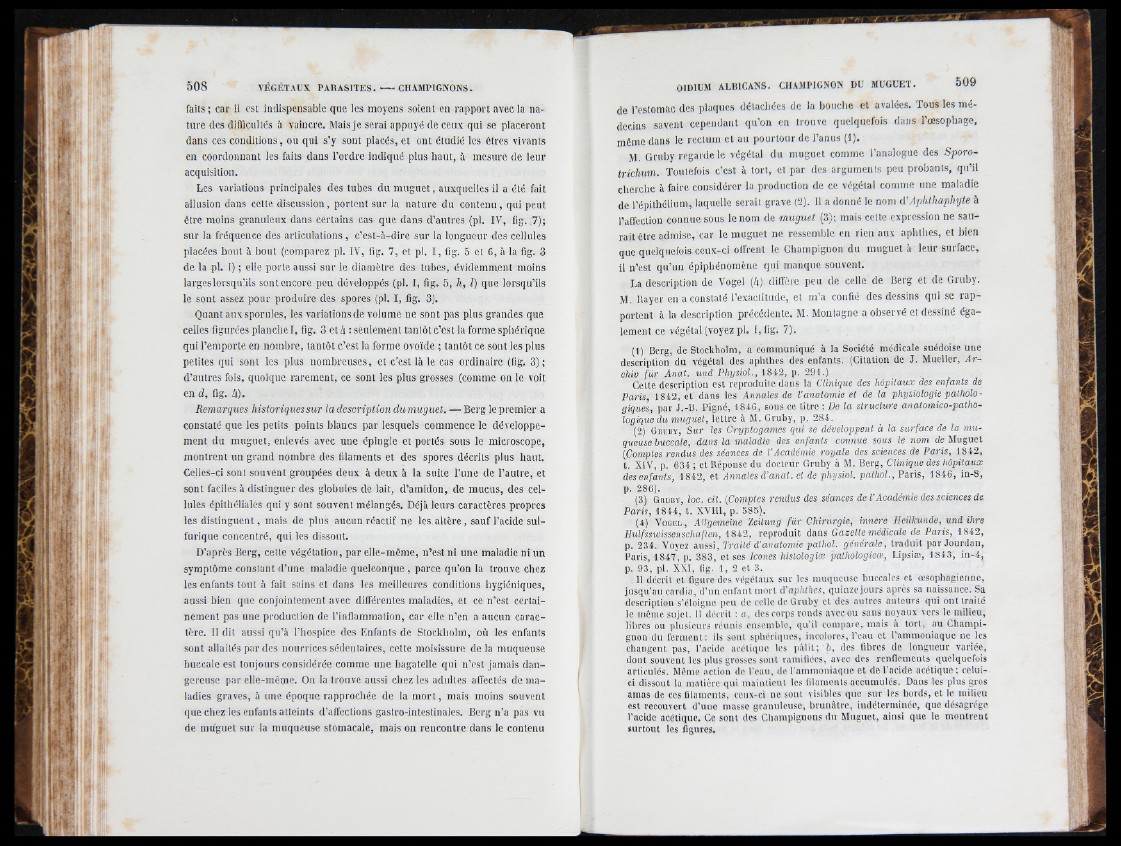
faits; car il est indispensable que les moyens soient en rapport avec la nature
des difficultés ù vaincre. Mais je serai appuyé de ceux qui se placeront
dans ces conditions, ou qui s’y sont placés, et ont étudié les êtres vivants
cn coordonnant les faits dans l’ordre indiqué plus haut, à mesure de leur
acquisition.
Les variations principales des tubes du m u g u e t, auxquelles il a été fait
allusion dans cette discussion, portent sur la nature du contenu, qui peut
être moins granuleux dans certains cas que dans d’autres (pl. IV, lig. 7);
sur la fréquence des articulations, c’est-à-dire sur la longueur des cellules
placées bout à bout (comparez pl. IV, fig. 7, et pl. I , lig. 5 el 6, à la fig. 3
de la pl. I) ; elle porte aussi sur le diamètre des tubes, évidemment moins
larges lorsqu’ils sont encore peu développés (pl. I, fig. 5, h , l) que lorsqu’ils
le sont assez pour produire des spores (pl. I, fig. 3).
Qu a n t a u x sp o ru le s , les var iat ions d e v o lume n e s o n t p a s p lu s g r a n d e s qu e
celles f iguré e s p la n c h e I, fig. 3 e t à ; s e u l em e n t ta n lô t c ’c s t la fo rme s p h é r i q u e
q u i l ’em p o r t e en n om b r e , t a n tô t c ’e s t la fo rme o v o ïd e ; t a n lô t ce so n t le s plu s
p e t i te s q u i so n t les p lu s n om b r e u s e s , e t c’e s t là le cas o rd in a i r e (fig. 3 );
d ’a u t r e s fois , q u o iq u e r a r em e n t , ce so n l le s p lu s gros se s ( c omme o n le voit
e n d , fig. k ) .
R e m a r q u e s h i s to r iq u e s s u r la d e s c r ip t io n d u m u g u e t . — Berg le premier a
constaté que les petits points blancs par lesquels commence le développement
du muguet, enlevés avec une épingle et portés sons le microscope,
montrent un grand nombre des filaments et des spores décrits plus haut.
Celles-ci sonl souvent groupées deux à deux à la suite l’une de l’autre, et
sont faciles à distinguer des globules de lait, d ’amidon, de mucus, des cellules
épithéliales qui y sont souvent mélangés. Déjà leurs caractères propres
les distin g u en t, mais de plus aucun réactif ne les a ltè re , sauf l’acide sulfurique
concentré, qui les dissout.
D’après Berg, celle végétation, par elle-même, n’est ni une maladie ni un
symptôme constant d’une maladie quelconque , parce qu’on la trouve chez
les enfants tout à fait sains et dans les meilleures condilions hygiéniques,
aussi bien que conjointement avec différentes maladies, et ce n ’est certainement
pas une production de l’inflammation, car elle n’en a aucun caractère.
Il dit aussi qu’à l’hospice des Enfants de Stockholm, où les enfants
sont allaités par des nourrices sédentaires, cette moisissure de la muqueuse
buccale est toujours considérée comme une bagatelle qui n’est jamais dangereuse
par elle-même. On la trouve aussi cbez les adultes affectés de maladies
graves, à une époque rapprochée de la m o r t, mais moins souvent
que chez les enfants atteints d ’affections gastro-intestinales. Berg n ’a pas vu
de muguet sur la muqueuse stomacale, mais on rencontre dans le contenu
de l’estomac des plaques déladiée.s de la boiicbe cl avalées. Tous les médecins
savent cependant q u ’on en irouve quelquefois dans l’oesophage,
même dans le rectum c t au pourtour de l’anus (1).
M. ürtiby regarde le végélal du muguet comme l’analogue des S p o r o -
tr i c h u m . Toulcfoi.s c’est à tort, el par des arguments peu probants, qu’il
cherche à faire considérer la production de cc végélal comme une maladie
de l’épilbélium, laquelle serait grave (2). 11 a donné le nom d 'A p h lh a p h y t e à
I’uffection connue sous le nom de m u g u e t (3); mais celte expression ne saurait
être admise, car le muguet ne ressemble cn rien aux apbibes, ct bien
que quelquefois ceux-ci offrent le Champignon du muguet à leur surface,
il n’est qu’un épiphénomène qui manque souvent.
La description de Vogel (ù) diffère peu de celle de Berg el de Gruby.
M. Bayer en a conslalé l’exactitude, et m’a confié des dessins qui se ra p portent
à la descriplion précédente. M. Montagne a observé et dessiné également
ce végélal (voyez pl. I,fig. 7).
(1) Berg, de Stockholm, a c ommu n iq u é à la Société médicale suédoise u n e
description d u végétal des aphthes des enfant s . (Citation de J . Mueller , A r -
chiv fü r A n a t. u n d P h y s io l., 18 4 2 , p. 29 1 . )
Cette description es t r eprodui te dan s la Clinique des h ô p ila u x des en fa n ts de
P a r is , 18-42, e t dan s les A n n a le s de l’a n a lom ie e t de la p h ysio lo g ie p a th o lo g
iq u e s, p a r J . - l i . Pigné, 18 4 6 , sous ce l i t re : De la s tr u c tu r e a n a tom ic o -p a lh o -
lo g iq u e d u m u g u e t, le t t re à M. Gruby, p. 28-4.
(2) G r u b y , S u r les C r y p lo g am c s q u i se d é v e lo p p en t à la su r fa c e de la m u queuse
buccale, d a n s la m a la d ie des en fa n ts co n n u e sous le n om de Muguet
[Comptes ren d u s des séances de l’A ca d émie r o y a le des sciences de P a r is , 1 8 4 2 ,
t , XIV, p. 63-4 ; et Réponse du docteur Gruby à M. Berg, Clin iq u e des h ô p ila u x
des e n fa n ts , 1842, et A n n a le s d 'a n a t. et de p h y s io l. p a th o l , P a r i s , 1 8 4 6 , in-8,
p. 286) .
(3) Gruey, loc. c il. [Comptes r e n d u s des séances de l'A c a d ém ie des sciences de
P a r is , 18 4 4 , t. XVl l l , p. 585).
(4) V ogel, A tlg em e in e Z e ilu n g fü r C h iru rg ie , in n e re H e ilku n d e , u n d ih re
Ih ilfs sw is s e n s c h a fle n , 18 4 2 , r eprodui t dan s G a ze lle médicale de P a r is , 1 8 4 2 ,
p. 234. Voyez aus s i. T ra ité d ’a n a tom ie p a lh o l. g é n é ra le , t r a d u i t pa r J o u rd a n ,
Paris , 1 8 4 7 , p. 383, e t ses Icônes hislologioe- patliologicm, Lipsiæ, 1 8 4 3 , in -4 ,
p. 93, pl. XXI, fig. 1, 2 c t 3.
11 décri t et figure des végétaux sur les mu q u e u se buccales e t oesophagienne,
ju s q u ’au cardia, d 'u n cnl'aiU mo r t d ’a p h th c s, quinze jour s après sa naissance. Sa
descriptiou s’éloigne peu de colle de Gruby et des aut res au teu r s qu i o n t t ra i lé
le même suje t. Il diH'rit : a , dos corps ronds avec ou sans noyaux vers le inilieii,
libres ou plus ieurs ri'uuis ensombio-, qu'il eompare, nia is a tor t , au C h amp i gnon
du rerinoiit ; ifs sont sptieriques, incolores, t'oau e t l’ammo n ia q u e n e les
changent pas, l'acide ac ét ique les p â l i t ; 6, des libres de lon g u e u r varice,
dont souvent les plus grosses sont ramif iées, avec des r e n n omc u l s quelquefois
ar t iculés. Même action de l 'eau, do l 'ammo n ia q u e et de l'acide ac é t iq u e ; celui-
ci dis sout la ma l iè re q ui ma in t i e n t les l i laments accuimi lés . Dans les plu s gros
amas de ces f ilaments , conx-ri ne sont visibles qu e sur les bords , et le mi lieu
es t recouver t d 'u n e masse granuleus e , b ru n â t r e , ind é te rmin é e , que désagrège
l’acid e acétique. Cc sont de.s Cliampignons du Mugue t , ainsi qu e le m o n t r e n t
sur tout les figures.
i