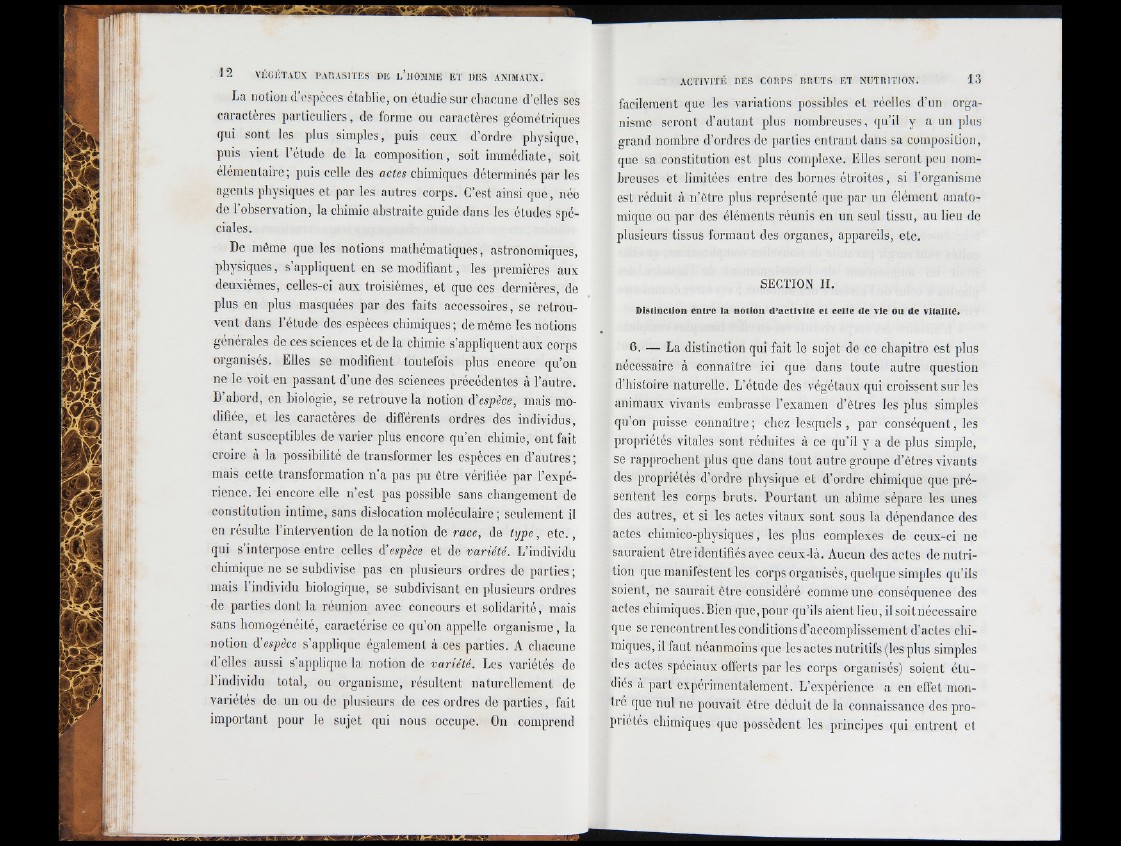
IH'
■12 VÉGÉTAUX PARAS ITE S 1)E u ’siOMME ET DES ANIMAUX.
La iiolioli d’espèces établie, on étudie sur cbacnne d’elles ses
caractères particuliers, de forme ou caractères géométriques
qui sont les plus simples, puis ceux d’ordre physique,
puis vient l’étude de la composition, soit immédiate, soit
élémentaire; puis celle des actes chimiques déterminés par les
agents physiques et par les autres corps. C’est ainsi que, née
de l’observation, la chimie abstraite guide dans les études spéciales.
De même que les notions mathématiques, astronomiques,
physiques, s’appliquent en se m o difiant, les premières aux
deuxièmes, celles-ci aux troisièmes, et que ces dernières, de
plus en plus masquées par des faits accessoires, se retrouvent
dans l’étude des espèces chimiques; de même les notions
générales de ces sciences et de la chimie s’appliquent aux corps
organisés. Elles se modifient toutefois plus encore qu’on
ne le voit en passant d’une des sciences précédentes cà f autre.
D’abord, en biologie, se retrouve la notion d’espèce, mais modifiée,
et les caractères de différents ordres des individus,
é tan t susceptibles de varier plus encore qu’en chimie, ont fait
croire à la possibilité de transformer les espèces en d’autres;
lUcais cette transformation n ’a pas pu être vérifiée par l’expérience.
Ici encore elle n ’est pas possible sans changement de
constitution intime, sans dislocation moléculaire ; seulement il
en résulte l’intervention de la notion de race, de ty p e , e t c . ,
qui s’interpose entre celles d’espèce et de variété. L’individu
chimique ne se subdivise pas en plusieurs ordres de parties ;
mais l’individu biologique, se subdivisant en plusieurs ordres
de parties dont la réunion avec concours et solidarité, mais
sans homogénéité, caractérise ce qu’on appelle organisme, la
notion d’espèce s’applique également à ces pcarties. A chacune
d ’elles aussi s’applique la notion de variété. Les variétés de
findividü total, ou organisme, résultent naturellement de
variétés de un ou de plusieurs de ces ordres de p a rtie s, fait
important pour le sujet i[ui nous occupe. On comprend
AC T IVITE DE S CO UP S B l iU T S E T N U T R IT IO N . 13
facilement que les variations possibles et réelles d’un organisme
seront d’autant plus nombreuses, qu’il y a uii plus
grand nombre d’ordres de parties en tran t dans sa composition,
que sa constitution est plus complexe. Elles seront peu nombreuses
et limitées entre des bornes é tro ite s , si l’organisme
est réduit à n ’être plus représenté que par un élément anatomique
ou par des éléments réunis en un seul tissu, au lieu de
plusieurs tissus formant des organes, appareils, etc.
SECTION II.
Distincllon entre la notion «UactivltC et celle de vie ou de vitalité.
6. — La distinction qui fait le sujet de ce chapitre est plus
nécessaire à connaître ici que dans toute autre question
d’histoire naturelle. L’étude des végétaux qui croissent sur les
animaux vivants embrasse l’examen d’êtres les plus simples
qu’on puisse connaître; chez le sq u els, par conséquent, les
propriétés vitales sont réduites à ce qu’il y a de plus simple,
se rapprochent plus que dans tout autre groupe d’êtres vivants
des propriétés d’ordre physique et d’ordre chimique que présentent
les corps bruts. P o u rtan t un abîme sépare les unes
des autres, et si les actes vitaux sont sous la dépendance des
actes clnmico-pbysiques, les plus complexes de ceux-ci ne
sauraient être identifiés avec ceux-là. Aucun des actes d é n u trition
que manifestent les corps organisés, quelque simples qu’ils
soient, ne saurait être considéré comme une conséquence des
actes chimiques. Bien que, pour qu’ils aient lieu, il soit nécessaire
que se ren eo n tren tle s co n d itio n sd ’accomplissement d’actes chimiques,
il faut néanmoins que les actes nutritifs (les plus simples
des actes spéciaux offerts par les corps organisés) soient étu diés
a part expérimentalement. L’expérience a en effet montré
que nul ne pouvait être déduit de la connaissance des propriétés
chimiques que possèdent les principes qui en tren t et