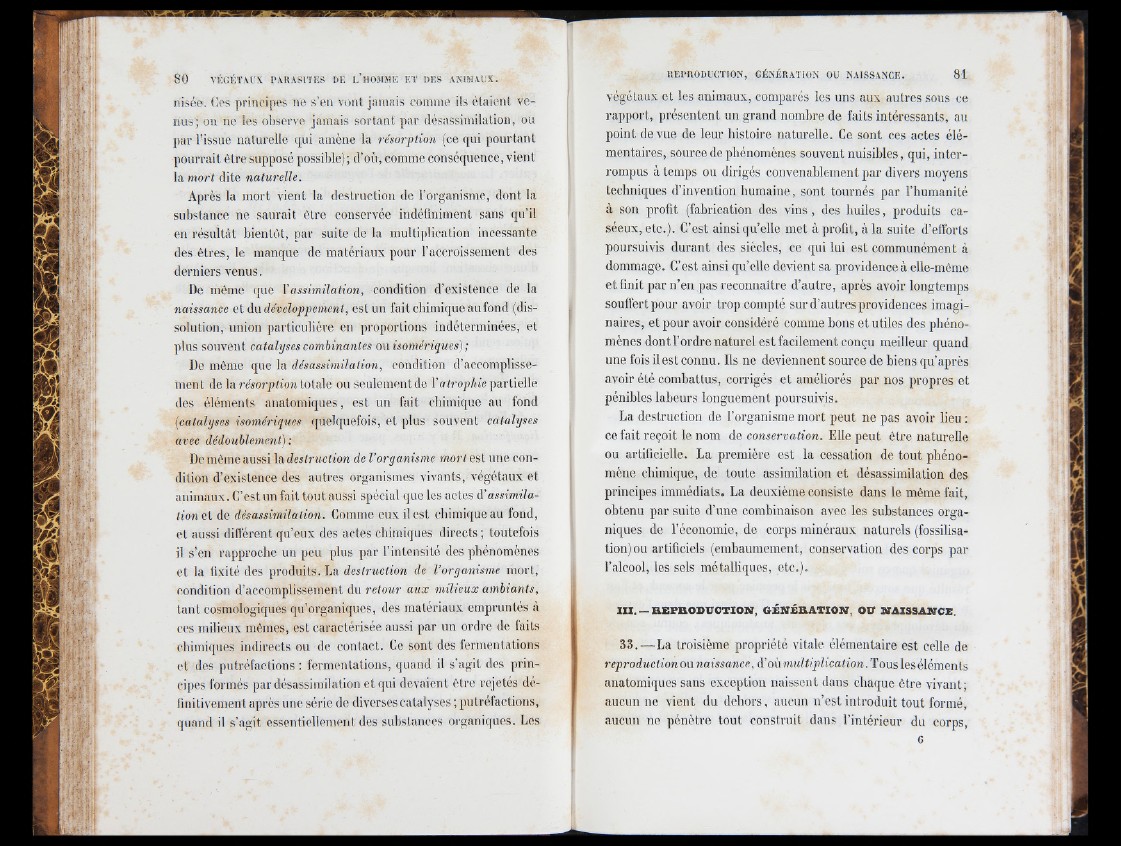
■I .
nisée. Ces principes ne s’en vont jamais comme ils étaient ven
us; ou ne les observe jamais sortant par désassimilation, ou
par l’issue naturelle qui amène la résorption (ce qui pourtant
pourrait être supposé possilde); d’où, comme conséciuence, vient
la mort dite naturelle.
Après la mort vient la destruction de l’organisme, dont la
substance ne saurait être conservée indéfiniment sans qu’il
en résultât bientôt, par suite de la multiplication incessante
des êtres, le manque de matériaux pour l’accroissement des
derniers venus.
De même que Y assimilation, condition d’existence de la
naissance et du développement, e s tu n fait cbimique au fond (dissolution,
union particulière en proportions indéterminées, et
plus souvent catalyses combinantes ovi isomériques) ;
De même que la désassimilation, condition d’accomplissement
de la totale ou seulement de fairo/i/u'e partielle
des éléments anatomiques, est un fait cliimique au fond
[catalyses isomériques quelquefois, et ¡dus souvent catalyses
avec dédoublement) :
De même aussi la destruct ion de l’organisme mort est une condition
d’existence des autres organismes vivants, végétaux et
animaux. C’est un fait tout aussi spécial que les actes d'assimilation
el de désassimilation. Comme eux il est cbimique au fond,
et aussi différent qu’eux des actes chimiques directs; toutefois
il s’en rapproche un peu plus par l’intensité des phénomènes
c t la fixité des produits. La destruction de l’orgamsme mort,
condition d’accomplissement du retour aux milieux ambiants,
tant cosmologiques qu’organiques, des matériaux empruntés à
ces milieux mômes, est caractérisée aussi par un ordre de faits
chimiques indirects ou de contact. Ce sont des fermentations
et des putréfactions : fermentations, quand il s’agit des principes
formés par désassimilation et qui devaient (dre rejetés définitivement
après une série de diverses catalyses ; putrélacLions,
quand il s’agit essentielleineni des substances oi'ganiqucs. Les
végétaux ct les animaux, comparés les uns aux autres sous ce
rapport, présentent un grand nombre de faits intéressants, au
point de vue de leur histoire naturelle. Ce sont ces actes élémentaires,
source de phénomènes souvent nuisibles, qui, in te rrompus
à temps ou dirigés convenablement par divers moyens
techniques d’invention huma in e, sont tournés par l’humanité
à son profit (fabrication des vins , des h u ile s, produits ca-
séeux, etc.). C’est ainsi qu’elle met à profit, à la suite d’efforts
poursuivis durant des siècles, ce qui lui est communément à
dommage. C’est ainsi qu’elle devient sa providence à elle-même
et finit par n ’en pas reconnaître d’autre, après avoir longtemps
souffert pour avoir trop compté sur d’autres providences imaginaires,
et pour avoir considéré comme bons et utiles des phénomènes
dont l’ordre naturel est facilement conçu meilleur quand
une fois il est connu. Ils ne deviennent source de biens qu’après
avoir été combattus, corrigés e t améliorés par nos propres et
pénibles labeurs longuement poursuivis.
La destruction de l’organisme mort peut ne pas avoir lieu ;
ce fait reçoit le nom de conservation. Elle peut être naturelle
ou artificielle. La première est la cessation de tout phénomène
chimique, de toute assimilation et désassimilation des
principes immédiats. La deuxième consiste dans le même fait,
obtenu par suite d’une combinaison avec les substances organiques
de l’économie, de corps minéraux naturels (fossilisation)
ou artificiels (embaumement, conservation des corps par
l’alcool, les sels métalliques, etc.).
II I. —REPRODUCTION, GÉNÉRATION, OU NAISSANCE.
3 3 .— La troisième propriété vitale élémentaire est celle de
reproduction ou naissance, d’oùmultiplication.Toui, leséléments
anatomiques sans exception naissent dans cbaque être vivant;
aucun ne vient du dehors, aucun n ’est introduit tout formé,
aucun ne pénètre tout construit dans rin té rie u r du corps,
G
IiS