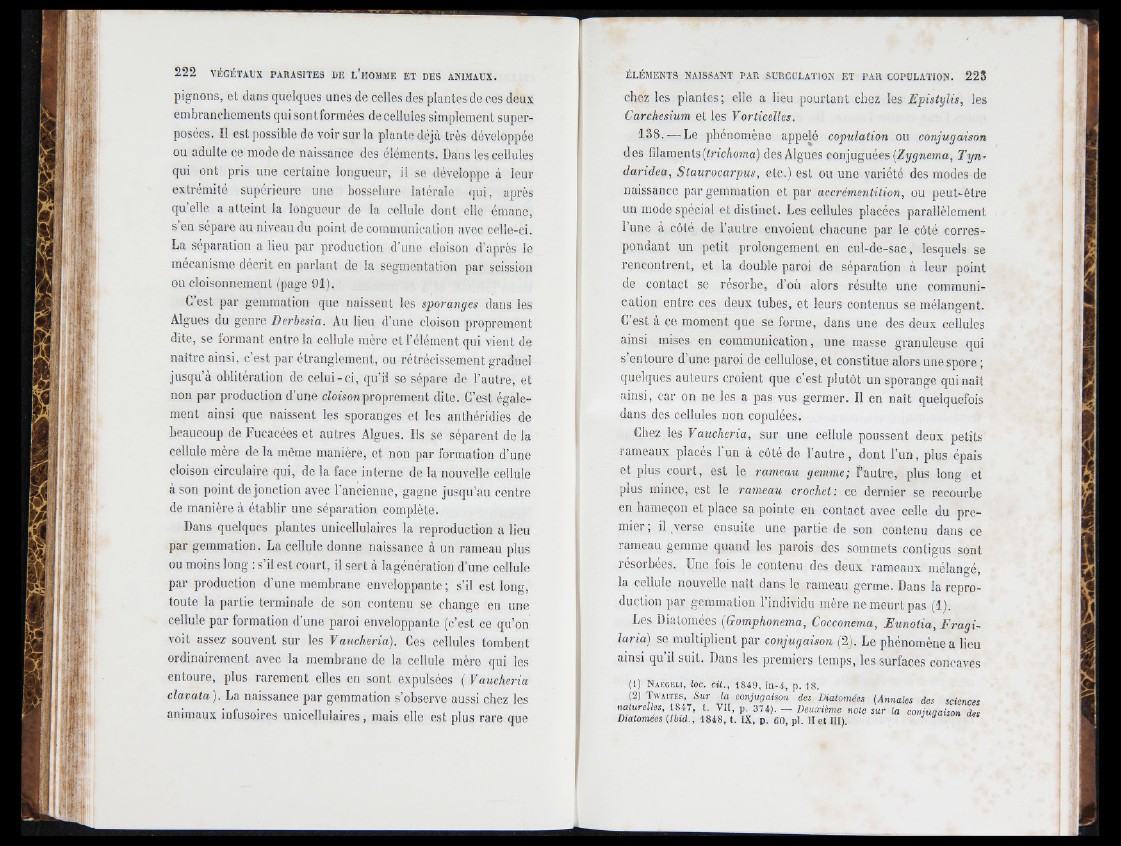
pignons, et dans quelques unes de celles des plantes de ces deux
enibraiichements quisontformées de cellules simplement superposées.
Il est possible de voir sur la plante déjà très développée
ou adulte ce mode de naissance des éléments. Dans les cellules
qui ont pris mie certaine longueur, i! se développe à leur
extrémité supérieure une bosselure latérale qui, après
q u elle a atteint ia longueur de la cellule dont elle émane,
s en sépare au niveau du point de communication avec celle-ci.
La séparation a lieu par production d’une cloison d’après le
mécanisme décrit en parlant de la segmentation par scission
ou cloisonnement (page 91).
C’est par gemmation que naissent les sporanges dans les
Algues du genre Derbesia. Au lieu d’une cloison proprement
dite, se formant entre la cellule mère et l’élément qui vient de
naître ainsi, c’est par étranglement, ou rétrécissement graduel
jusqu’à oblitération de c e lu i-c i, qu’il se sépare de l’autre, et
non par production d’une c?owonproprement dite. C’est également
ainsi que naissent les sporanges et les antbéridies de
beaucoup de Fucacées et autres Algues. Ils se séparent de la
cellule mère de la même manière, et non par formation d’une
cloison circulaire qui, de la face interne de la nouvelle cellule
à son point de jonction avec l’ancienne, gagne jusqu’au centre
de manière à établir une séparation complète.
Dans quelques plantes unicellulaires la reproduction a lieu
par gemmation. La cellule donne naissance à un rameau plus
ou moins long : s’il est court, il sert à lagénération d’une cellule
par production d’une membrane enveloppante ; s’il est long,
toute la partie terminale de son contenu se change en une
cellule par formation d’une paroi enveloppante (c’est ce qu’on
voit assez souvent sur les Vaucheria). Ces cellules tombent
ordinairement avec la membrane de la cellule mère qui les
entoure, plus rarement elles en sont expulsées ( Vaucheria
clavata). La naissance par gemmation s’observe aussi chez les
animaux infusoires unicellulaires, mais elle est plus rare que
chez les plantes; elle a lieu pourtant chez les Epistylis, les
Carchesium et les Vorticelles.
i-38. — Le phénomène appelé copulation ou conjugaison
des filaments (iric/ioma) des Algues conjuguées (Zÿÿnema, Tyn-
daridea, Staurocarpus, etc.) est ou une variété des modes de
naissance par gemmation et par accrémentition, ou peut-ê tre
un mode spécial et distinct. Les cellules placées parallèlement
l’une à côté de l’autre envoient chacune par le côté correspondant
un petit prolongement en cul-de-sac, lesquels se
rencontrent, et la double paroi de séparation à leur point
de contact se résorbe, d’où alors résulte une communication
entre ces deux tubes, et leurs contenus se mélangent.
C’est à ce moment que se forme, dans une des deux cellules
ainsi mises en communication, une masse granuleuse qui
s’entoure d’une paroi de cellulose, et constitue alors une spore ;
quelques auteurs croient que c’est plutôt un sporange qui naît
ainsi, car on ne les a pas vus germer. Il en naît quelquefois
dans des cellules non copulées.
Chez les Vaucheria, sur une cellule poussent deux petits
rameaux placés l'un à côté de l ’a u t r e , dont l’u n , plus épais
et plus court, est le rameau gemme; l’autre, plus long et
plus mince, est le rameau crochet: ce dernier se recourbe
en hameçon et place sa pointe en contact avec celle du premier;
il.v e rse ensuite une partie de son contenu dans ce
rameau gemme quand les parois des sommets contigus sont
résorbées. Une fois le contenu des deux rameaux mélangé,
la cellule nouvelle naît dans le rameau germe. Dans la reproduction
par gemmation l’individu mère ne meurt pas (1).
Les Diatomées {Gomphonema, Cocconema, Eunotia, Fragi-
laria) se multiplient par conjugaison (2). Le phénomène a lieu
ainsi qu’il suit. Dans les premiers temps, les surfaces concaves
( 1) N a k g e l i , loc. c i l ., 1S49, in -4 , p. 18.
( 2 ) T v v a i t e s , S u r la co n ju g a iso n des D ia tom é e s [A n n a le s des sciences
im tu r e llc s , i S a , t. VII, p. 3 7 4). — D e u x ièm e n o ie s u r la c o n ju g a iso n des
Diatomées (Ib id ., 184S, t. IX, p. 60, pl. I I et III).