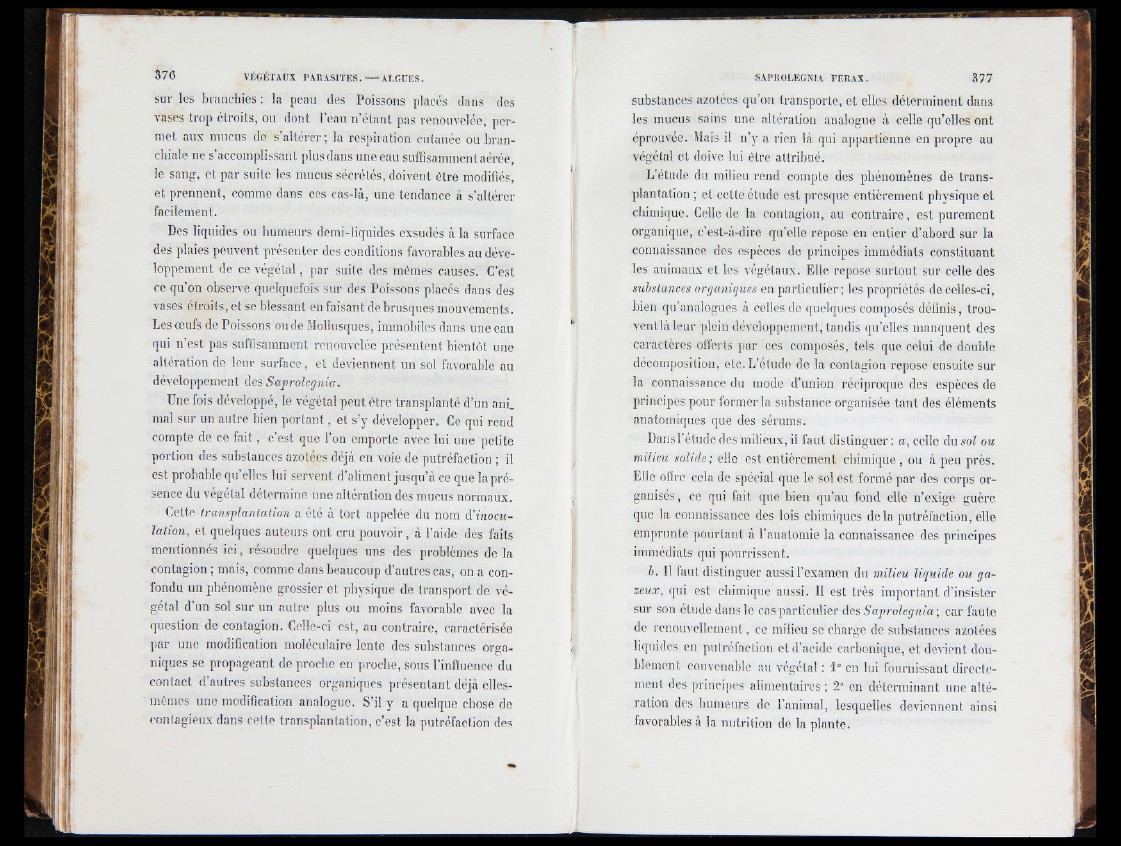
r!‘ f ii
1 ' î
' î
.'ÍM
ilM
I ' '1
î
il ’
P ■ 'i
sur les branchies : la peau des Poissons places daus des
vases trop étroits, ou dont l’eau n ’étant pas renouvelée, permet
aux mucus de s’a lté re r; la respiration cutanée ou branchiale
ne s’accomplissant plus dans une eau suffisamment aérée,
le sang, et par suite les mucus sécrétés, doivent être modifiés,
et prennent, comme dans ces cas-là, une tendance à s’altérer
facilement.
Des liquides ou humeurs demi-liquides exsudés à la surface
des plaies peuvent présenter des conditions favorables au développement
de ce v é g é ta l, par suite des mêmes causes. C’est
ce qu’on observe queiquefois sur des Poissons placés dans des
vases étroits, et se blessant en faisant de brusques mouvements.
Les oeufs de Poissons ou de Moliusques, immobiles dans une eau
qui n ’est pas suftisamment renouvelée présentent bientôt une
altération de leur surfa ce, cl deviennent un sol favorable au
développement des Saprolegnia.
Une fois développé, le végétal peut être transplanté d’uu ani.
mal sur un autre bien p o r ta n t, et s’y développer. Ce qui rend
compte de ce f a i t , c’est que l’on emporte avec lui une petite
portion des substances azotées déjà en voie de putréfaction ; il
est probable qu’elles lui servent d’aliment jusqu’à ce que la présence
du végétal détermine une altération des mucus normaux.
Cette transplantation a été à tort appelée du nom A'inocu-
lation, et quelques auteurs ont cru pouvoir, à l’aide des faits
mentionnés ic i , résoudre quelques uns des problèmes de la
contagion ; mais, comme dans heaucoup d’autres cas, on a confondu
un phénomène grossier et physique de transport de végétal
d’un sol sur un autre plus ou moins favorable avec la
question de contagion. Celle-ci est, au contraire, caractérisée
par une modification moléculaire lente des substances organiques
se propageant de proche en proche, sous rinfluencc du
contact d ’autres substances organiques présentant déjà elles-
mêmes une modification analogue. S’il y a quelque chose de
conlagieiix dans cette transplantation, c’est la putréfaction des
i]
i \ j
substances azotées qu’on transporte, et elles déterminent dans
les mucus sains une altération analogue à celle qu’elles ont
éprouvée. Mais i! u’y a rien là qui appartienne en propre au
végétal et doive lui être attribué.
L’étude du milieu rend compte des phénomènes de tran s plantation
; et cette étude est presque entièrement physique et
chimique. Celle de la contagion, au co n tra ire, est purement
organique, c’est-à-dire qu’elle repose en entier d’abord sur la
connaissance des espèces de principes immédiats constituant
les animaux et les végétaux. Elle repose surtout sur celle des
substances organiques en particulier; les propriétés de celles-ci,
bien qu’analogues à celles de quelques composés définis, trou-
v en tlà leu r plein développement, tandis qu’elles manquent des
caractères oiferts par ces composés, tels que celui de double
décomposition, etc. L’étude de la contagion repose ensuite sur
la connaissance du mode d’union réciproque des espèces de
principes pour former la substance organisée ta n t des éléments
anatomiques que des sérums.
Dans l’étude des milieux, il faut distinguer : a, celle du sol ou
milieu solide; elle est entièrement chimique , ou à peu près.
Elle ofire cela de spécial que le sol est formé par des corps organisés
, ce qui fait que bien qu’au fond elle n ’exige guère
que la coimaissance des lois chimiques d e là putréfaction, elle
emprunte pourtant à l’analomie la connaissance des principes
immédiats qui pourrissent.
b. D faut distinguer aussi l’examen du milieu liquide ou gazeux,
qui est chimique aussi. Il est très important d’insister
sur son étude d an sle cas particulier des Saprolegnia-, car faute
de renouvellement, ce milieu sc charge de substances azotées
liquides en putréfaction et d’acide carbonique, e t devient dou-
hleineiit conveuahle au Y'égélal : 1° en lui founiissant dirocle-
ineiit des principes alimentaires ; 2“ en déterminant une altération
des humeurs de l’animal, lesquelles deviennent ainsi
favorables à la nutrition de la plante.
I