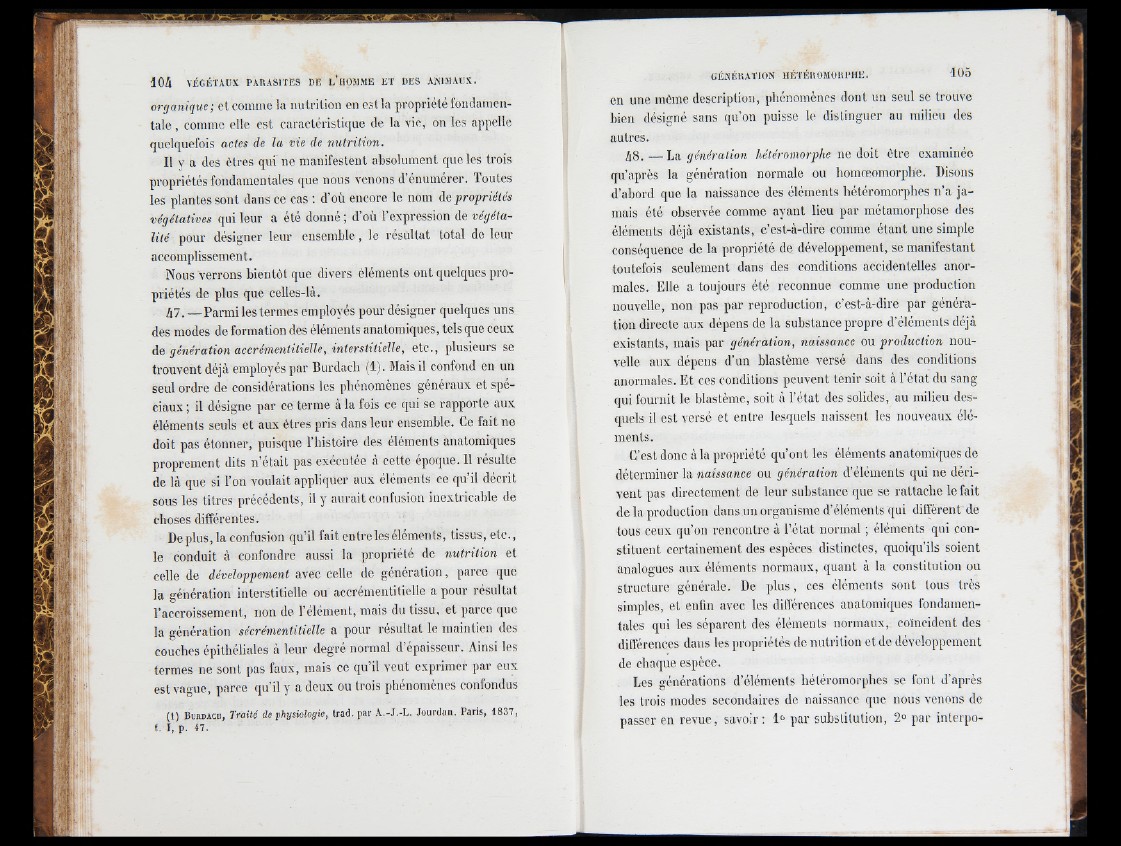
oryanique; etcoinnie la nuirilioii en est la propriété foiidamen-
talo , comme elle est caractéristiqae de la vie, ou les appelle
quelquefois actes de la vie de nutrition.
Il y a des ôlres qui ne manifestent absolument que les trois
propriétés fondamentales que nous venons d’émnnérer. Toutes
les plantes sont dans ce cas : d’où encore le nom de propriétés
végétatives qui leur a été donné ; d’où l’expression de véyéta-
lilé pour désigner leur ensemble , le résultat total de leur
accomplissement.
Nous verrons bientôt que divers éléments ont quelques propriétés
de plus que celles-là.
k l .— Parmi les termes employés pour désigner quelques uns
des modes de formation des éléments anatomiques, tels que ceux
de génération accrémentitielle, interstitielle, etc., plusieurs se
trouvent déjà employés par Burdacb (1). Biais il confond en un
seul ordre de considérations les pbénomènes généraux et spéciaux
; il désigne par ce terme à la fois ce qui se rapporte aux
éléments seuls et aux êtres pris dans leur ensemble. Ce fait ne
doit pas étonner, puisque Tbistoire des éléments anatomiques
proprement dits n ’était pas exécutée à cette époque. Il résulte
de là que si l’on voulait appliquer aux éléments ce qu’il décrit
sous les titres précédents, il y aurait confusion inextricable de
choses différentes.
Déplus, la confusion qu’il fait entre les éléments, tissus, etc.,
le conduit à confondre aussi la propriété de nutrition et
celle de développement avec celle de g én é ra tio n , parce que
la génération interstitielle ou accrémentitielle a pour résultat
l ’accroissement, non de l’élément, mais du tissu, et parce que
la génération sécrémentitielle a pour résultat le maintien des
couches épithéliales à leur degré normal d’épaisseur. Ainsi les
termes ne sont pas faux, mais ce qu’il veut exprimer par eux
est vague, parce qu’il y a deux ou trois pbénomènes confondus
(1) Bubdacii, T r a ité de p h y sio lo g ie , t rad. par A. - J . -L. J o u rd a n . P ar is , 18 3 7 ,
t , I , p. 47.
GÉiNÉUATTON n É T ÉU 0 .« 0K rH E . 105
en une môme description, pbénomènes dont un seul sc trouve
bien désigné sans qu’on puisse le distinguer au milieu des
autres.
¿ 8 .— La génération hétéromorphe ne doit être examinée
qu’après la génération normale ou homoeomorphe. Disons
d’abord que la naissance des éléments hétéromorphes n ’a ja mais
été observée comme ayant lieu par métamorphose des
éléments déjà existants, c’est-à-dire comme étan t une simple
conséquence de la propriété de développement, se manifestant
toutefois seulement dans des condilions accidentelles anormales.
Elle a toujours été reconnue comme une production
nouvelle, non pas par reproduction, c’est-à-dire par génération
directe aux dépens de la substance propre d’éléments déjà
existants, mais par génération, naissance ou production nouvelle
aux dépens d’un blastème versé dans des condilions
anormales. Et ces condilions peuvent tenir soit à l’é ta t du sang
qui fournit le blastème, soit à l’état des solides, au milieu desquels
il est versé et entre lesquels naissent les nouveaux éléments.
C’est donc à la propriété qu’ont les éléments anatomiques de
déterminer la naissance ou génération d’éléments qui ne dérivent
pas directement de leur substance que se rattache le fait
de la production dans un organisme d’éléments qui diffèrent de
tous ceux qu’on rencontre à l’é ta t normal ; éléments qui constituent
certainement des espèces distinctes, quoiqu’ils soient
analogues aux éléments normaux, quant à la constitution ou
structure générale. De p lu s , ces éléments sont tous très
simples, et enüii avec les différences anatomiques fondamentales
qui les séparent des éléments normaux, coïncident des
différences dans les propriétés de nutrition et de développement
de cbaque espèce.
Les générations d’éléments hétéromorphes se font d’après
les trois modes secondaires de naissance que nous venons de
passer en revue, savoir: 1'- par substitution, 2° par inlerpo-
1i