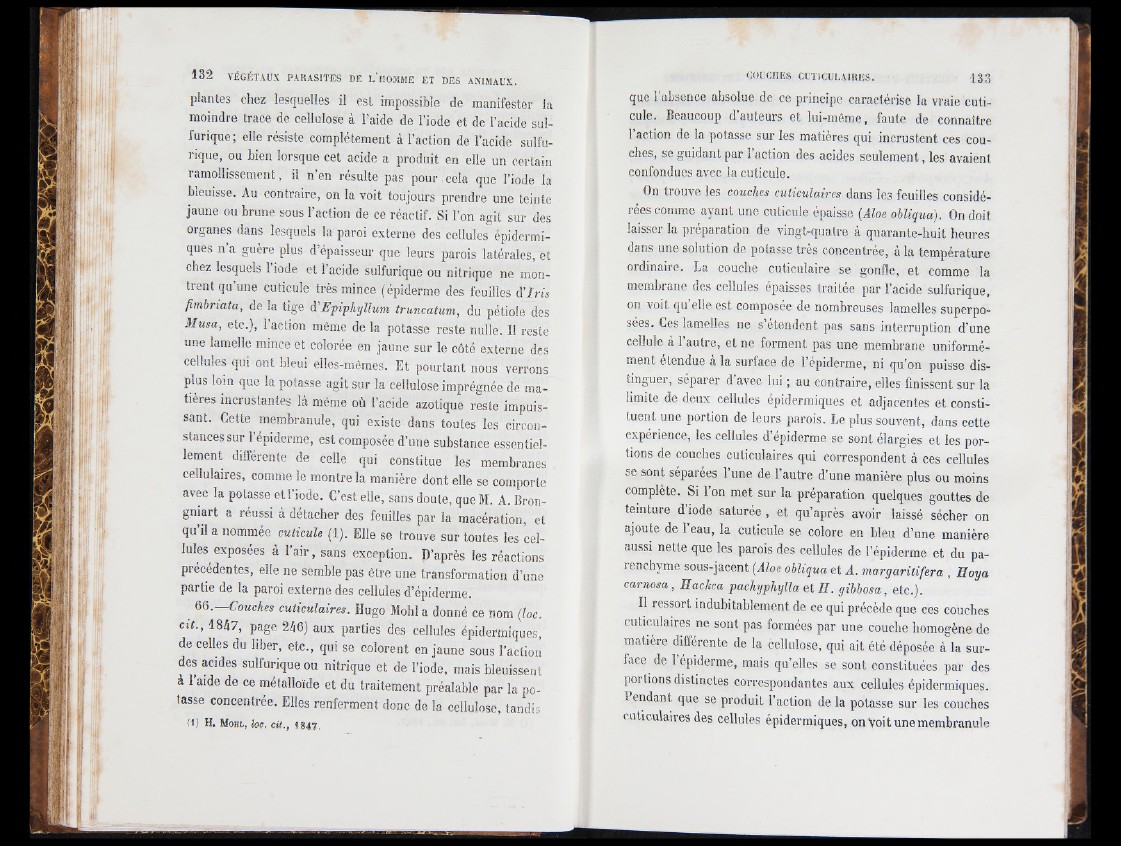
plantes chez lesquelles il est impossible de manifester ia
moindre trace de cellulose à l ’aide de l’iode et de l’acide sulfurique;
elle résiste complètement à l’action de l’acide sulfurique,
ou bien lorsque cet acide a produit en elle un cerlaiu
ramollissement, il n ’en résulte pas pour cela que l’iode la
bleuisse. Au contraire, on la voit toujours prendre une teinte
jaune ou brune sous l’action de ce réactif. Si l’on agit sur des
organes dans lesquels la paroi externe des cellules épidermiques
n a guère plus d’épaisseur que leurs parois latérales, et
chez lesquels l’iode et l’acide sulfurique ou nitrique ne montrent
qu’une cuticule très mince (épiderme des feuilles iYlris
fimhriata, de la tige d'Epiphyllum truncatum, du pétiole des
3Iusa, etc.), l’action même de la potasse reste nulle. II reste
une lamelle mince et colorée en jaune sur le côté externe des
cellules qui ont bleui elles-mêmes. Et pourtant nous verrons
plus loin que la potasse agit sur la cellulose imprégnée de matières
incrustantes là môme où l’acide azotique reste impuissant.
Cette inembranule, qui existe dans toutes les circonstances
sur l’épiderme, est composée d’une substance essentiellement
différente de celle qui constitue les membranes
cellulaires, comme le montre la manière dont elle se comporte
avec la potasse et l’iode. C’est elle, sans doute, que M. A. Bron-
gniart a réussi à détacher des feuilles par la macération, et
qu il a nommée cuticule (1). Elle se trouve sur toutes les cellules
exposées à l’a i r , sans exception. D’après les réactions
précédentes, elle ne semble pas être une transformation d’une
p artie de la paroi externe des cellules d’épiderme.
m .— Couches cuticulaires. Hugo Mohl a donné ce nom {hc.
cit., 1847, page 246) aux parties des cellules épidermiques,
de celles du liber, etc., qui se colorent en jaune sous l’action
des acides sulfurique ou nitrique et de l’iode, mais bleuissent
à l’aide de ce métalloïde et du traitement préalable par la potasse
concentrée. Elles renferment donc de la cellulose, tandis
(I) H. Mohl , toc, c i t., iS 4 7 .
que l’absence absolue de ce principe caractérise la vraie cuticule.
Beaucoup d’auteurs et lui-môme, faute de connaître
l’action de la potasse sur les matières qui incrustent ces couches,
se guidant par l’action des acides seu lem en t, les avaient
confondues avec la cuticule.
On trouve les couches cuticulaires dans les feuilles considérées
comme ayant une cuticule épaisse {Aloe obliqua). On doit
laisser la préparation de vingt-quatre à quarante-huit heures
dans une solution de potasse très concentrée, à la température
ordinaire. La couche cuticulaire se gonfle, et comme la
membrane des cellules épaisses traitée par l’acide sulfurique,
on voit qu’elle est composée de nombreuses lamelles superposées.
Ces lamelles ne s’étendent pas sans interruption d’une
cellule à l’autre, e tn e forment pas une membrane uniformément
étendue a la surface de l’épiderme, ni qu’on puisse distinguer,
séparer d avec lui ; au contraire, elles finissent sur la
¡mute de deux cellules épidermiques et adjacentes et constituent
une portion de leurs parois. Le plus souvent, dans cette
expérience, les cellules d’épiderme se sont élargies et les portions
de couches cuticulaires qui correspondent à ces cellules
se sont séparées 1 une de l’autre d’une manière plus ou moins
complète. Si l’on met sur la préparation quelques gouttes de
teinture d’iode s a tu ré e , e t qu’après avoir laissé sécher on
ajoute de l’eau, la cuticule se colore en bleu d ’une manière
aussi nette que les parois des cellules de l’épiderme et du parenchyme
sous-jacent {Aloe obliqua et A. margaritifera , Hoya
carnosa, lîackea pachyphylla et I I . gibbosa, etc.).
Il ressort indubitablement de ce qui précède que ces couches
cuticulaires ne sont pas formées par une couche homogène de
matière diûérente de la cellulose, qui ait été déposée à la sur-
iace de l’épiderme, mais qu’elles se sont constituées par des
portions distinctes correspondantes aux cellules épidermiques.
1 endant que se produit Faction de la potasse sur les couches
cuticulaires des cellules épidermiques, o n v o itu n em em b ran u le