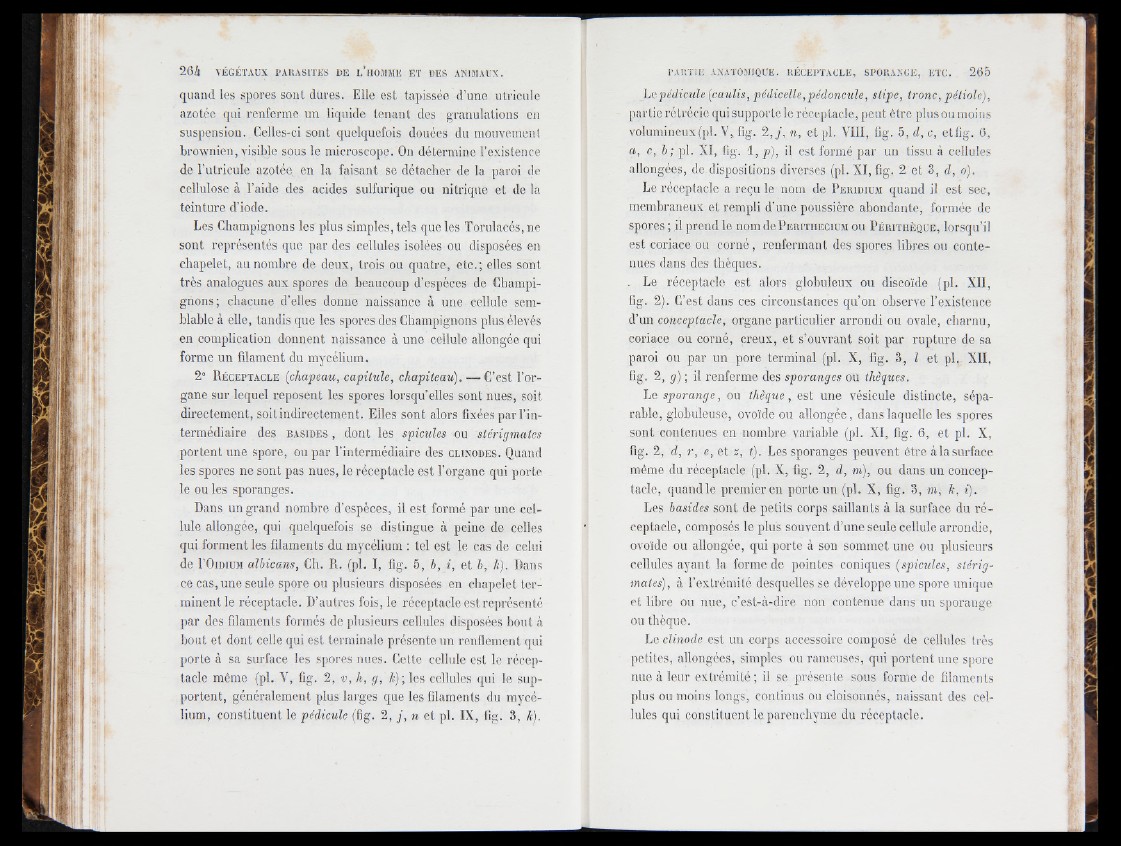
quand les spores sonl dures. Elle est tapissée d’une utricule
azotée qui renferme un liquide tenant des granulations eu
suspension. Celles-ci sont quelquefois douées dn mouvement
broYvnien, visible sous le microscope. On détermine l’cxistencc
de l’utricule azotée en la faisant se détacber de la paroi de
cellulose à l’aide des acides sulfurique ou nilrique et de la
teinture d’iode.
Les Champignons les plus simples,tels queles Torulacés,ne
sont représentés que par des cellules isolées ou disposées eu
chapelet, au nombre de deux, trois ou quatre, etc.; elles sonl
très analogues aux spores de beaucoup d’espèces de Champignons;
chacune d’elles donne naissance à une cellule semblable
à elle, tandis que les spores des Champignons plus élevés
en complication donnent naissance à une cellule allongée qui
forme un filament du mycélium.
2° R é c e p ta c le {chapeau, capitule, chapiteau). — C’est l’organe
sur lequel reposent les spores lorsqu’elles sont nues, soit
directement, soitindirectement. Elles sont alors fixées par l ’intermédiaire
des BASIDES, dont les spicules ou stéricjmaies
portent une spore, ou par l’intermédiaire des c lin o d e s . Quand
les spores ne sont pas nues, le réceptacle est l’organe qui porte
le ou les sporanges.
Dans un grand nombre d’espèces, il est formé par une cellule
allongée, qui quelquefois se distingue à peine de celles
qui forment les filaments du mycélium : tel est le cas de celui
de rOiDiUM albicans, Ch. R. (pl. I, fig. 5, b, i, et h, k). Dans
ce cas, une seule spore ou plusieurs disposées en chapelet te rminent
le réceptacle. D’autres fois, le réceptacle est représenté
par des filaments formés de plusieurs cellules disposées bout à
bout et dont celle qui est terminale présente un renflement qui
porte à sa surface les spores nues. Cette cellule est le réceptacle
même (pl. V, fig. 2, v, h, g, k) \ les cellules qui le supportent,
généralement plus larges que les filaments du mycélium,
conslituent le pédicule (fig. 2, /, n el pl. IX, lig. 3, k).
Lepédicule {caulis, pédiceTle,pédoncule, slipe, tronc, pétiole),
parlie rétrécie qui supporte le réceptacle, peut être pJ us ou moins
volumineux (pl. V, fig. 2, y, n, et pl. VIII, lig. 5, d, c, etfig. 6,
a, c, b; pl. XI, fig. 1, p), il est formé par un tissu <à cellules
allongées, de dispositions diverses (pl. XI, fig. 2 et 3, d, o).
Le r é c c p la c lc a r e ç u le n om d e Peiudium q u a n d il e s t se c ,
m em b r a n e u x et rem p li d ’u n e p o u s s iè re a b o n d a n te , fo rm é e de
sp o r e s ; il p r e n d le nomdePERiTiiECiuM ou P é r i th è q u e , lo r s q u ’il
e s t c o ria c e ou c o r n é , r e n f e rm a n t d e s sp o re s lib r e s ou c o n te n
u e s clans des Lbèques.
Le réceptacle est alors globuleux ou discoïde (pl. XII,
fig. 2). C’est dans ces circonstances qu’on observe l ’existence
d’un conceptacle, organe particulier arrondi ou ovale, charnu,
coriace ou corné, creux, et s’ouvrant soit par rupture de sa
paroi ou par un pore terminal (pl. X, fig. 3, l et pl. XII,
fig. 2, g) ; il renferme des sporanges ou thèques.
Le sporange, ou thèque, est une vésicule distincte, séparable,
globuleuse, ovoïde ou allongée, dans laquelle les spores
sont contenues en nombre variable (pl. XI, fig. 6, et pl. X,
fig. 2, d, r, e, et s, t). Les sporanges peuvent être à la surface
même du réceptacle (pl. X, fig. 2, d, m), ou dans un conceptacle,
quandle premier en porte un (pl. X, fig. 3, m, k, i).
Les basides sont de petits corps saillants à la surface du r é ceptacle,
composés le plus souvent d ’une seule cellule arrondie,
ovoïde ou allongée, qui porte à son sommet une ou plusieurs
cellules ayant la forme de pointes coniques (spicules, stérig-
mates), à l’extrémité desquelles se développe une spore unique
et libre ou nue, c’est-à-dire non contenue, dans un sporange
ou thèque.
Le clinode est un corps accessoire composé de cellules très
peliles, allongées, simples ou rameuses, qui po rten t une spore
nue à leur extrémité ; il se présente sous forme de filaments
plus ou moins longs, continus ou cloisonnés, naissant des cellules
qui constituent le parenchyme du réceptacle.