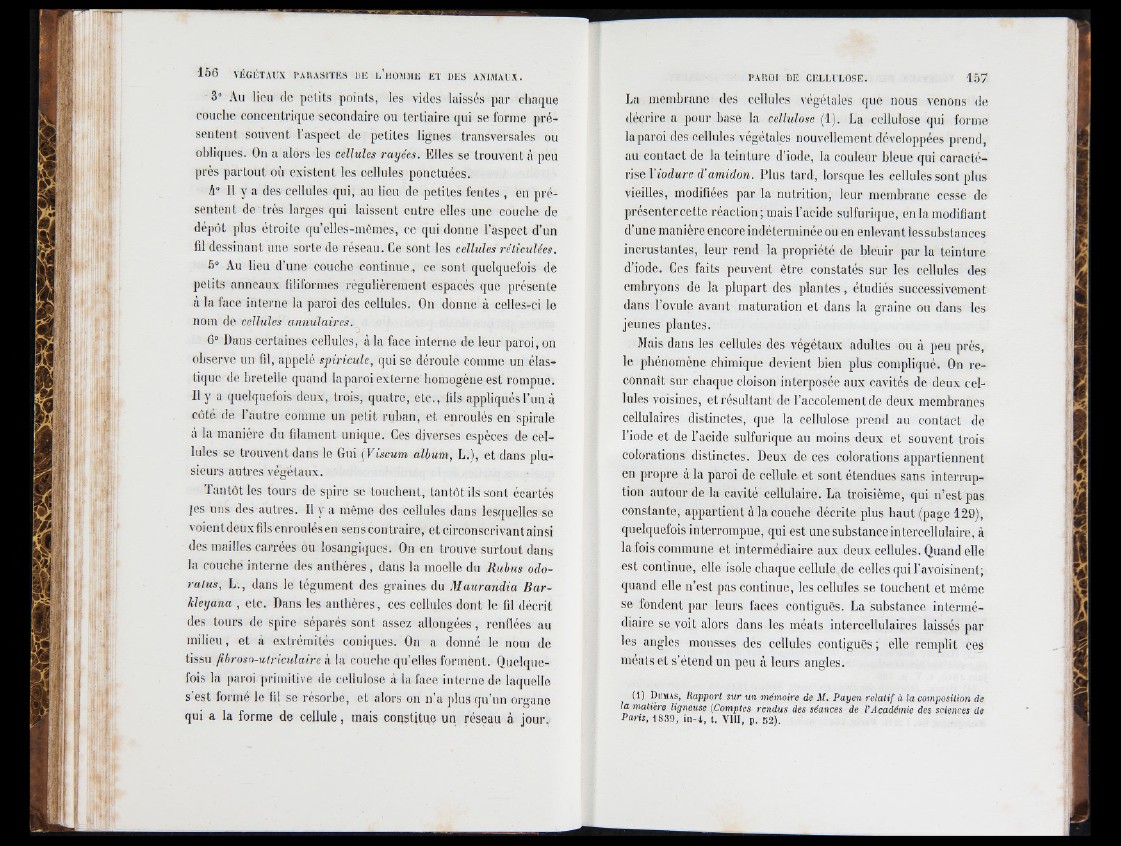
. f
¡•'.'.s'
3“ Au lieu tie petits points, les vides laissés par chaque
couche coiiceii trique secondaire ou tertiaire qui se forme p ré sentent
souvent l’aspect de petites lignes transversales ou
obliques. On a alors les cellules rayées. Elles se trouvent à peu
près partout où existent les cellules ponctuées.
h° Il y a des cellules qui, au lieu de petites fentes , en présentent
de très larges qui laissent entre elles une couche de
dépôt plus étroite qu’elles-méines, ce qui dorme l’aspect d’un
til dessinant une sorte de réseau. Ce sont les cellules réticulées.
5° Au lieu d’une couche continue, ce sont quelquefois de
petits anneaux fdiformes régulièrement espacés que présente
à la face intei-ne la paroi des cellules. Ou donne à celles-ci le
nom de cellules annulaires.
6° Dans certaines cellules, à la face interne de leur paroi, on
observe un fil, appelé spiricule, qui se déroule comme un élastique
de bretelle quand la paroi externe homogène est rompue.
Il y a quelquefois deux, trois, quatre, etc., fils appliqués l’un à
côté de l’autre comme un petit ruban, et enroulés en spirale
à la manière du filament unique. Ces diverses espèces de cellules
se trouvent dans le Gui (Viscum album, L.), et dans plusieurs
autres végétaux.
Tantôt les tours de spire se loucbenl, tantôt ils sont écartés
jes uns des autres. Il y a même des cellules dans lesquelles se
voientdeuxfils enroulésen sens contraire, et circonscrivant ainsi
des mailles carrées ou losangiques. Ou en trouve surtout dans
la couche interne des a n th è re s , dans la moelle du Rubus odo-
ralus, L., dans le tégument des graines du M aurandia B a r-
kleyana , etc. Dans les anthères, ces cellules dont le fil décrit
des tours de spire séparés sont assez allongées , renllées au
milieu, et à extrémités coniques. On a donné le nom de
tissu libroso-uiriculaire à la couche qu’elles forment. Que!({iie-
fois la paroi primitive de cellulose à la face interne de laquelle
s’est formé le fil sc résorbe, et alors on n ’a plus qu’un organe
qui a la forme de c e llu le , mais constitue un réseau à jour.
La membrane des cellules végétales que nous venons de
décrire a pour base la cellulose (1). La cellulose qui forme
la paroi des cellules végétales nouvellement développées prend,
au contact de la teinture d’iode, la couleur bleue qui caractérise
l’mdMre ¿ ’amîdow. Plus tard, lorsque les cellules sont plus
vieilles, modifiées par la nutrition, leur membrane cesse de
présenter cette réaction ; mais l’acide sulfurique, en la modifiant
d’une manière encore indéterminée ou en enlevant lessubstanccs
incrustantes, leur rend la propriété de bleuir par la teinture
d’iode. Ces faits peuvent être constatés sur les cellules des
embryons de la plupart des p la n te s , étudiés successivement
dans l’ovule avant maturation et dans la graine ou dans les
jeunes plantes.
Mais dans les cellules des végétaux adultes ou à peu près,
le phénomène chimique devient bien plus compliqué. On reconnaît
sur cbaque cloison interposée aux cavités de deux cellules
voisines, et résultant de l’accolementde deux membranes
cellulaires distinctes, que la cellulose prend au contact de
l’iode et de l’acide sulfurique au moins deux et souvent trois
colorations distinctes. Deux de ces colorations appartiennent
en propre à la paroi de cellule et sont étendues sans interruption
autour de la cavité cellulaire. La troisième, qui n ’est pas
constante, appartient à la couche décrite plus haut (page 129),
quelquefois interrompue, qui est unesubstanceintercellulaire, à
la fois commune et intermédiaire aux deux cellules. Quand elle
est continue, elle isole cbaque cellule de celles qui Tavoisinont;
quand elle n ’est pas continue, les cellules se touchent et même
se fondent par leurs faces contiguës. La subslance intermédiaire
se voit alors dans les méats intercellulaires laissés par
les angles mousses des cellules contiguës; elle remplit ces
méats et s’étend un peu à leurs angles.
(1) Dumas, R a p p o r t s u r u n m ém o ir e de M . P a y e n r e la t i f à la com p o s itio n de
la m a tiè re ligneuse (Comptes r e n d u s des séances de l’A c a d ém ie des sciences de
P a r is , 18.39, i t l - i , t. VIII, p. 52).
id
I