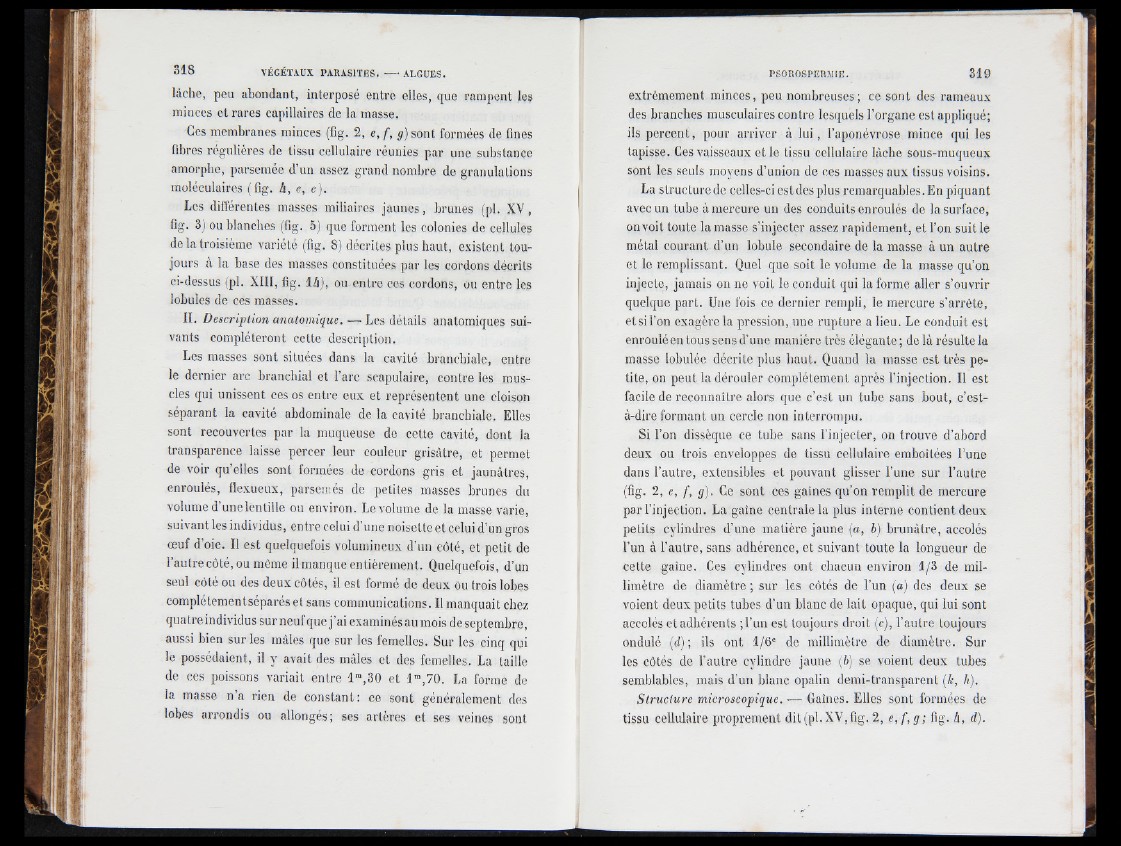
lâche, peu ahondant, interposé entre elles, que rampent les
minces et rares capillaires de la masse.
Ces memhranes minces (fig. 2, e, f, g) sont formées de fines
fibres régulières de tissu cellulaire réunies par une subslance
amorphe, parsemée d’un assez grand nombre de granulations
moléculaires (fig. h, e, e).
Les différentes masses miliaires ja u n e s , brunes (pl. XV,
fig. 3) ou blanches (fig. 5) que forment les colonies de cellules
de la troisième variété (fig. 8) décrites plus haut, existent toujours
à la hase des masses constituées par les cordons décrits
ci-dessus (pl. Xlll, fig. 14), ou entre ces cordons, ou entre les
lobules de ces masses.
II. Descriplion anatomique. — Les détails anatomiques suivants
compléteront cette description.
Les masses sont situées dans la cavité branchiale, entre
le dernier arc branchial et l’arc scapulaire, contre les muscles
qui unissent ces os entre eux et représentent une cloison
séparant la cavité abdominale de la cavité branchiale. Elles
sont recouvertes par la muqueuse de cette cavité, dont la
transparence laisse percer leur couleur grisâtre, et permet
de voir qu’elles sont formées de cordons gris et janucàtres,
enroulés, flexueux, parsemés de petites masses brunes dn
volume d une lentille ou environ. Le volume de la masse varie,
suivanties individus, entre celui d’une noisette et celui d’un gros
oeuf d’oie. Il est quelquefois volumineux d’un côté, et petit de
l’au lre cô té .o u môme il manque entièrement. Quelquefois, d’un
seul côté ou des deux côtés, il est formé de deux ou trois lobes
complétementséparéset sans communications. Il manquait chez
quatre individus sur neuf que j ’ai examinés au mois de septembre,
aussi bien su rle s mâles que sur les femelles. Sur les cinq qui
le possédaient, il y avait des mâles ct des femelles. La taille
de ces poissons variait entre 1 “ ,30 et 1” ,70. La forme de
la masse n ’a rien de co n stan t: cc sont généralement des
lobes arrondis ou allongés; ses artères et ses veines sont
extrômement minces, peu nombreuses; ce sont des rameaux
des branches musculaires contre lesquels l’organe est appliqué;
ils p erc en t, pour arriver à lu i, l’aponévrose mince qui les
tapisse. Ces vaisseaux et le tissu cellulaire lâche sous-muqueux
sont les seuls moyens d’union de ces masses aux tissus voisins.
La structure de celles-ci est des plus remarquables. En piquant
avec un tube à mercure un des conduits enroulés de la surface,
on voit toute la masse s’injecter assez rapidement, et l’on suit le
métal courant d’un lobule secondaire de la masse à un autre
et le remplissant. Quel que soit le volume de la masse qu’on
injecte, jamais on ne voit le conduit qui la forme aller s’ouvrir
quelque part. Une fois ce dernier rempli, le mercure s’arrête,
et si l’on exagère la pression, une rupture a lieu. Le conduit est
enroulé en tous sens d'une manière très élégante ; de là résulte la
masse lohulée décrite plus haut. Quand la masse est très petite,
on peut la dérouler complètement après l’injection. IL est
facile de reconnaître alors que c’est un tube sans bout, c’est-
à-dire formant un cercle non interrompu.
Si l’on dissèque ce tube sans l’injecter, on trouve d ’abord
deux ou trois enveloppes de tissu cellulaire emboîtées l’une
dans l’autre, extensibles et pouvant glisser l’une sur l’autre
(flg. 2, e, f, g). Ce sont ces gaines qu’on remplit de mercure
par l’injection. La gaine centrale la plus interne contient deux
petits cylindres d’une matière jaune (a, b) brunâtre, accolés
l’un à l’autre, sans adhérence, et suivant toute la longueur de
cette gaîne. Ces cylindres ont chacun environ 1/3 de millimètre
de diamètre ; sur les côtés de l’un (a) des deux se
voient deux petits tubes d’un blanc de lait opaque, qui lui sont
accolés et adhérents ;r u n est toujours droit (c), l ’autre toujours
ondulé (d) ; ils ont 1/6“ de millimètre de diamètre. Sur
les côtés de l’autre cylindre jaune [b) se voient deux tubes
semblables, mais d’un blanc opalin demi-transparent {k, h).
Structure microscopique. — Gaînes. Elles sont formées de
tissu cellulaire proprement dit (pl. XV, fig. 2, e, f ,g; fig. 4, d).