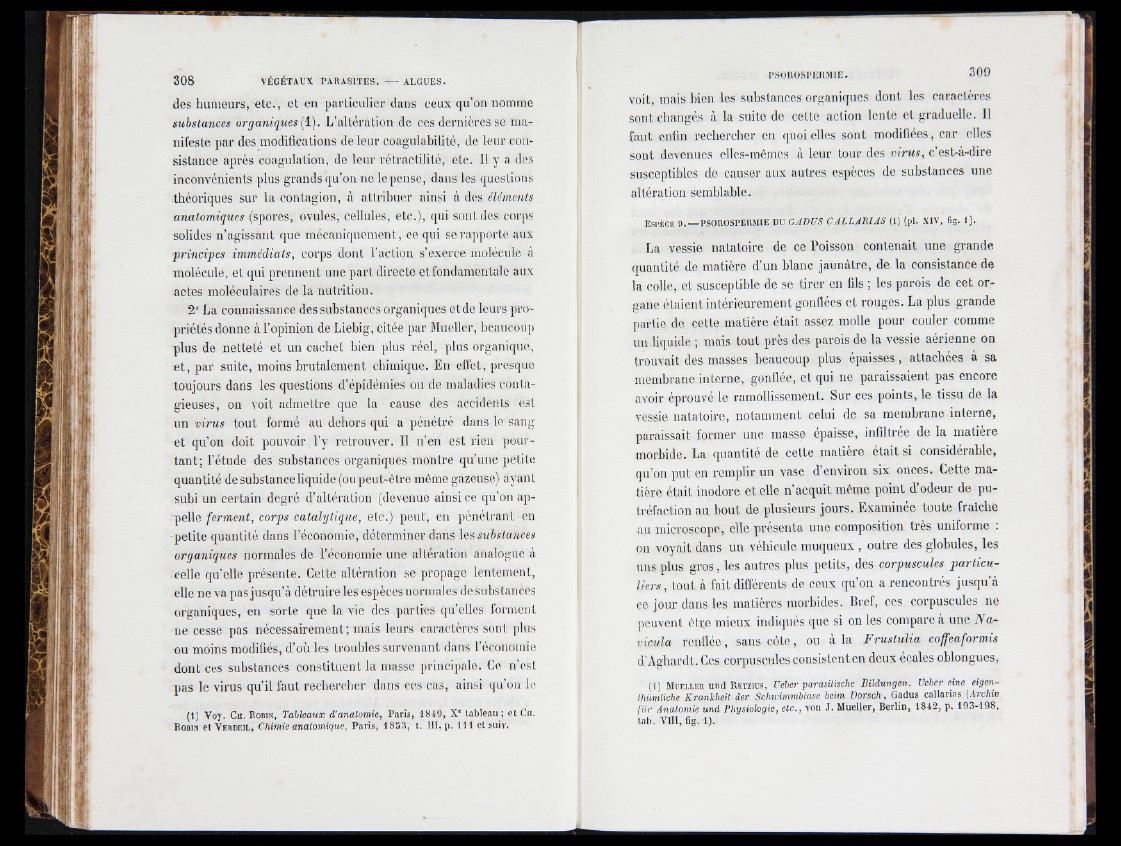
I l * *i'
Î 9 à à
des humeurs, etc., et eu particulier dans ceux qu’ou nomme
substances organiques (1). L’altération de ces dernières se manifeste
par des modifications de leur coagulahilité, de leur consistance
après coagulation, de leur rétractilité, etc. 11 y a des
inconvénients plus grands qu’ou ue le pense, dans les questions
théoriques sur la contagion, à attrihuer ainsi à des éléments
anatomiques (spores, ovules, cellules, etc.), qui sonl des corps
solides n ’agissant que mécaniquement, ce qui se rapporte aux
principes immédiats, corps dont l’action s’exerce molécule à
molécule, et qui prennent une p a rt directe et fondamentale aux
actes moléculaires de la nulritiou.
2“ La connaissance des substances organiques eid e leurs propriétés
donne à l’opinion de Liehig, citée par Mueller, beaucoup
plus de netteté et un cachet bien plus réel, plus organique,
e t, par suite, moins brutalement chimique. En effet, presque
toujours dans les questions d’épidémies ou de maladies contagieuses,
on voit admettre que la cause des accidents est
un virus tout formé au dehors qui a pénétré dans le sang
et qu’on doit pouvoir l ’y retrouver. 11 n ’eu est rien pourta
n t; l’étude des substances organiques montre qu’une petite
quantité de substance liquide (ou peut-être même gazeuse) ayant
subi un certain degré d’altération (devenue ainsi ce qu’on appelle
ferment, corps catalytique, etc.) peut, eu péné trant eu
-petite quantité dans récouomie, déterminer dans \es substances
organiques normales de l’économie une altération analogue à
celle q u elle présente. Cette altération se propage lentement,
elle ne va pas jusqu’à détruire les espèces normales de substances
organiques, en sorte que la vie des parties qu’elles forment
ue cesse pas nécessairement; mais leurs caractères sont plus
ou moins modifiés, d’où les troubles survenant dans l’économie
dont ces substances constituent la masse principale. Ce u ’esl
pas le virus qu’il faut rechercher dans ces cas, ainsi (ju ’o ii h'
(1) Voy. Ch. R o b i n , T a b le a u x d 'a n a tom ie , Par is , 1849, X ' ta b l e a u ; c t Cii.
R ob in e t V e r d e i i , , Ch im ie a n a tom iq u e , Par is , 1 8 5 3 , t . l ! i , i ) . 111 et suiv.
voit, mais bien les substances organiques dont les caractères
sont changés à la suite de celte action lente et graduelle. 11
faut enfin rechercher eu quoi elles sont modifiées, car elles
sont devenues elles-mêmes à leur tour des virus, c’est-à-dire
susceptibles de causer aux autres espèces de substances une
altération semblable.
E spèce 9 .— PSOROSPERMIE DU GADUS C A L L A R IA S (1) (pl. XIV, fig. 1).
La vessie natatoire de ce Poisson contenait une grande
quantité de matière d’un blanc jaunâtre, de la consistance de
la colle, et susceptible de se tirer en fils ; les parois de cet organe
étaient intérieurement gonilées et rouges. La plus grande
partie de cette matière était assez molle pour couler comme
uu liquide ; mais tout près des parois de la vessie aérienne on
trouvait des masses beaucoup plus épaisses , attachées à sa
membrane interne, gonflée, et qui ne paraissaient pas encore
avoir éprouvé le ramollissement. Sur ces points, le tissu de la
vessie natatoire, notamment celui de sa membrane interne,
paraissait former une masse épaisse, infiltrée de la matière
morbide. La quantité de cette matière était si considérable,
qu’on put en remplir un vase d’environ six onces. Cette matière
était inodore et elle n ’acquit même point d’odeur de p u tréfaction
au bout de plusieurs jours. Examinée toute fraîche
au microscope, elle présenta une composition très uniforme :
ou voyait dans uu véhicule muqueux , outre des globules, les
uns plus gros, les autres plus petits, des corpuscules particuliers,
tout à fait différents de ceux qu’ou a rencontrés jusqu’à
cc jour dans les matières morbides. Bref, ces corpuscules ne
peuvent être mieux indiqués que si on les compare à une Na -
vicula renllée, sans cô te, ou à la Frustulia coffeaformis
d’Aghardt. Ces corpuscules consistent en deux écales oblougues,
(1) M cellek u n d R etzius, Ueber p a ra silisch e B i ld m g e n . Ueber eino eig en -
IhiimUche K r a n lih e il d e r S ch u 'im m b la so beim D o r s c h , Gadus callarins [Archiv
f u r A n a tom ie u n d P h y sio lo g ie , e t c ., von J . Muel ler , Ber l in, 18 4 2 , p. 1 9 3 -1 9 8 ,
lab. VIII, fig. 1).