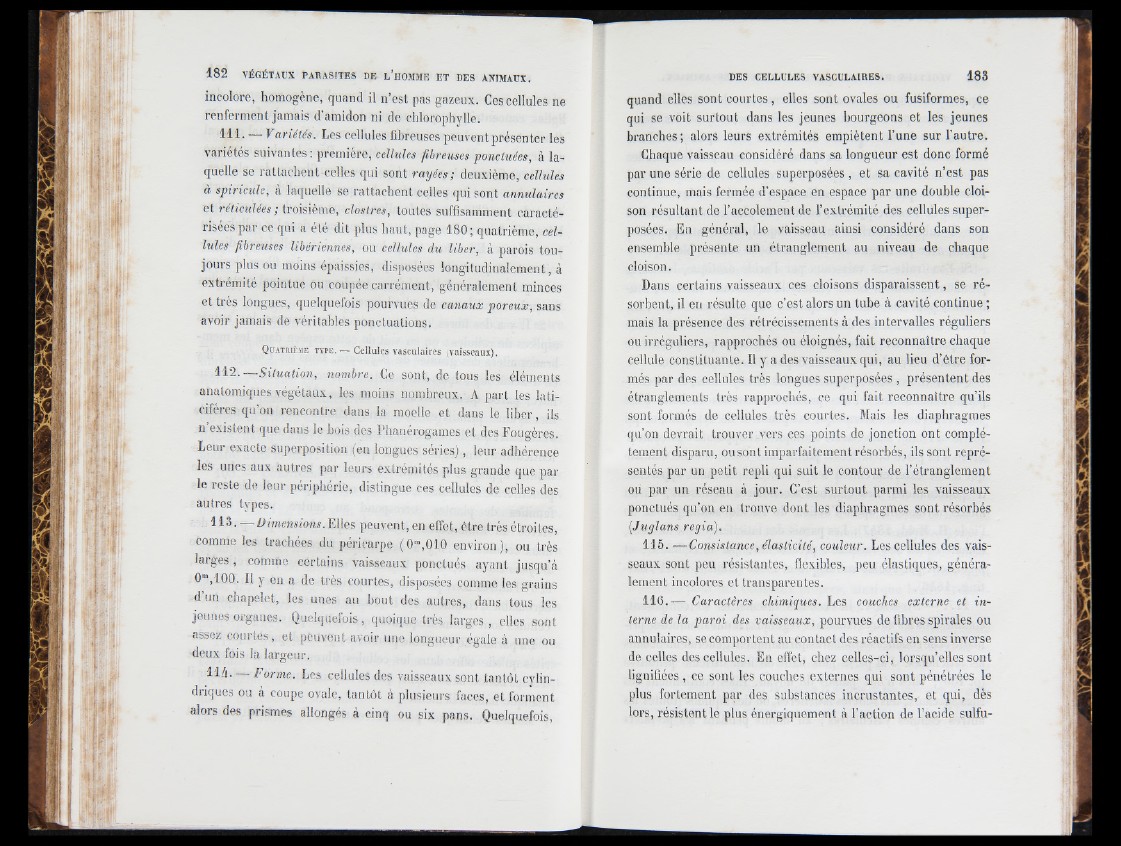
PT'F,
F.
J
,1- 'I
i '-ï
i'
incolore, homogène, quand il n ’est pas gazeux. Ces cellules ne
renferment jamais d’amidon ni de chlorophylle.
l l i . — Variétés. Les cellules fibreuses peuvent présenter les
variétés suivantes: première, celhdes fibreuses ponctuées, à laquelle
se rattachent celles qui sont rayées; deuxième, cellules
à spiricule, à laquelle se rattachent celles qui sont annidaires
et reYiCM/ew; troisième, clostres, toutes suffisamment caractérisées
par ce qui a été dit plus haut, page 180; quatrième, cel-
lides fibreuses libériennes, ou cellules du liber, à parois toujours
plus ou moins épaissies, disposées longitudinalement, à
extrémité pointue ou coupée carrément, généralement minces
et très longues, quelquefois pourvues de canaux poreux, sans
avoir jamais de véritables ponctuations.
Q u a t r ièm e t y p e . — Cel lu le s vasculaires A’aisseaiix),
1V2.—.Situation, nombre. Ce sont, de tous les éléments
anatomiques végétaux, les moins nombreux. A part les lali-
cifères qu’on rencontre dans la moelle et dans le lib e r , ils
n existent que dans le bois des Phanérogames et des Fougères.
Leur exacte superposition (en longues séries) , leur adhérence
les unes aux autres par leurs extrémités plus grande que par
le reste de leur périphérie, distingue ces cellules de celles des
autres types.
àl'à. ■ Dimensions. Elles peuvent, en effet, être très étroites,
comme les trachées du péricarpe (0 ” ,010 environ), ou très
larges , comme certains vaisseaux ponctués ayant jusqu’cà
O^jlOO. Il y en a de très courtes, disposées comme les grains
d’un chapelet, les unes au bout des autres, dans tous les
jeunes organes. Quelqueiois, quoique très larges , elles sont
assez courtes, et peuvent avoir une longueur égale à mie ou
deux fois la largeur.
l i h . ~ Forme. Les cellules des vaisseaux sont tantôt cylindriques
ou à coupe ovale, tantôt cà plusieurs faces, et forment
alors des prismes allongés à cinq ou six pans. Quelquefois,
quand elles sont co u rte s , elles sont ovales ou fusiformes, ce
qui se voit surtout dans les jeunes bourgeons et les jeunes
branches; alors leurs extrémités empiètent l’une sur l’autre.
Chaque vaisseau considéré dans sa longueur est donc formé
par une série de cellules superposées , et sa cavité n ’est pas
continue, mais fermée d’espace en espace par une double cloison
résultant de l’accolement de l’extrémité des cellules superposées.
En général, le vaisseau ainsi considéré dans son
ensemble présente un étranglement au niveau de chaque
cloison.
Dans certains vaisseaux ces cloisons d isp a ra issen t, se ré sorbent,
il en résulte que c’est alors un tube à cavité continue ;
mais la présence des rétrécissements à des intervalles réguliers
ou irréguliers, rapprochés ou éloignés, fait reconnaître chaque
cellule constituante. Il y a des vaisseaux qui, au lieu d’être formés
par des cellules très longues superposées , présentent des
étranglements très rapprochés, ce qui fait reconnaître qu’ils
sont formés de cellules très courtes. Mais les diaphragmes
qu’oii devrait trouver vers ces points de jonction ont complètement
disparu, ousont imparfaitement résorbés, ils sont représentés
par un petit repli qui suit le contour de l’étranglement
ou par un réseau à jour. C’est surtout parmi les vaisseaux
ponctués qu’on en trouve dont les diaphragmes sont résorbés
(Juglans regia).
115. — Consistance, élasticité, couleur. Les cellules des vaisseaux
sont peu résistantes, flexibles, peu élastiques, généralement
incolores et transparentes.
1 1 6 .— Caractères chimiques. Les couches externe et interne
de la paroi des vaisseaux, pourvues de fibres spirales ou
annulaires, se comportent au contact des réactifs en sens inverse
de celles des cellules. Eu eflél, chez celles-ci, lorsqu’elles sont
lignifiées, ce sont les couches externes qui sont pénétrées le
plus fortement piir des substances incrustantes, et qui, dès
lors, résistent le plus énergiquement à Faction de l’acide sulfui
i
li