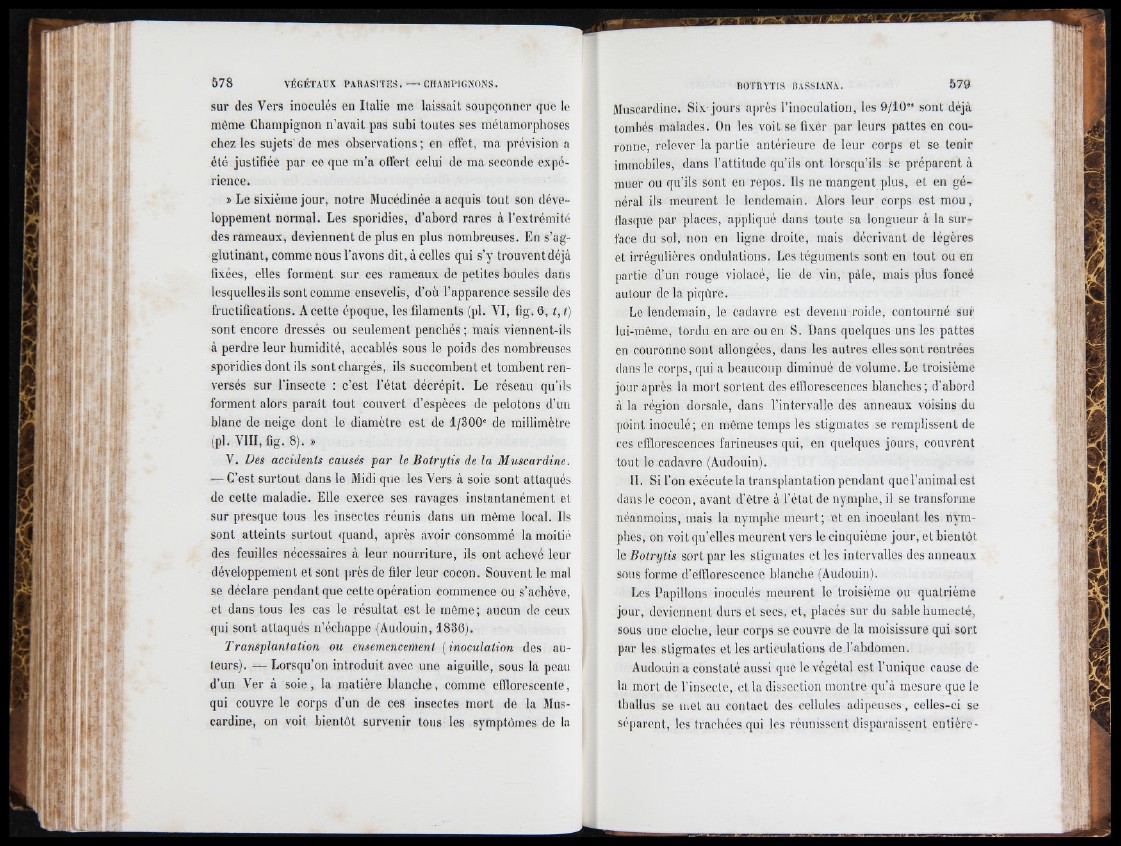
sur des Vers inoculés en Italie me laissait soupçonner cpie le
môme Champignon n ’avait pas subi toutes ses métamorphoses
chez les sujets de mes observations; en effet, ma prévision a
élé justifiée par ce que m’a offert celui de ma seconde expérience.
» Le sixième jour, notre Mucédinée a acquis tout son développement
normal. Les sporidies, d’abord rares à l’extrémité
des rameaux, deviennent de plus en plus nombreuses. En s’agglutinant,
comme nous l’avons dit, à celles qni s’y Irouvent déjà
fixées, elles forment sur ces rameaux de petites boules dans
lesquelles ils sont comme ensevelis, d’où l’apparence sessile des
fructifications. A cette époque, les filaments (pl. VI, fig. 6, t,t)
sont encore dressés ou seulement penchés ; mais viennent-ils
à perdre leur humidité, accablés sous le poids des nombreuses
sporidies dont ils sont chargés, ils succombent et tombent renversés
sur finsec te : c’est l ’état décrépit. Le réseau qu’iis
forment alors paraît tout couvert d’espèces de pelotons d’un
blanc de neige dont le diamètre est de 1/300' de millimètre
(pl. VIII, flg. 8). »
V, Des accidents causés par le Botrytis de la Muscardine.
— C’est surtout dans le Midi que les Vers à soie sont attaqués
de cette maladie. Elle exerce ses ravages instantanément et
sur presque tous les insectes réunis dans un même local. Ils
sont atteints surtout quand, après avoir consommé la moitié
des feuilles nécessaires à leur nourriture, ils ont achevé leur
développement et sont yirès de filer leur cocon. Souvent le mal
se déclare pendant que cette opération commence ou s’achève,
et dans tous les cas le résultat est le même; aucun de ceux
qui sont attaqués n ’échappe (Audouin, 1836).
Transplantation ou ensemencement ( inoculation des auteurs).
— Lorsqu’on introduit avec une aiguille, sous la peau
d’un Ver à soie , la malière blanche, comme elllorcscente,
qui couvre le corps d’un de ces insectes mort de la Mus-
cardine, on voit bientôt survenir tons les symptômes de la
Muscardine. Six- jours a|irès l’inoculation, les 9/10“ sont déjà
tombés malades. On les voit se fixer par leurs pattes en couronne,
relever la partie antérieure de leur corps et se tenir
immobiles, dans l’attitiide qu’ils ont lorsqu’ils Se préparent à
muer ou qu’ils sont en repos. Ils ne mangent plus, et en général
ils meurent le lendemain. Alors leur corps est mou,
flasque par places, appliqué dans toute sa longueur à la surface
du sol, non en ligne droite, mais décrivant de légères
el irrégulières ondulations. Les téguments sont en tout ou en
partie d’un rouge violacé, lie de vin, pàle, mais plus foncé
aulour de la piqûre.
Le lendemain, le cadavre est devenu roide, contourné sur
lui-même, tordu en arc ou en S. Dans quelques uns les pattes
en couronne sont allongées, dans les autres elles sont rentrées
dans le corps, qui a beaucoup diminué de volume. Le troisième
jour après la mort sortent des efflorescences blanches ; d’abord
à la région dorsale, dans l’intervalle des anneaux voisins du
point inoculé; en môme temps les stigmates se remplissent de
ces efflorescences farineuses qui, en quelques jours, couvrent
tout le cadavre (Audouin).
II. Si fon exécute la transplantation pendant quefanimal est
dansle cocon, avant d’être à l’étal de nymphe, il se transforme
néanmoins, mais la nymphe m eu rt; et en inoculant les nymphes,
on voil qu’elles meurent vers le cinquième jour, et bientôt
le Botrytis sort par les stigmates et les intervalles des anneaux
sous forme d’efilorescence blanche (Audouin).
Les Papillons inoculés meurent le troisième ou quatrième
jour, deviennent durs et secs, et, placés sur du sable humecté,
sous une cloche, leur corps se couvre de la moisissure qui sort
par les stigmates e lle s articulations de l’abdomen.
Audouin a constaté aussi que le végétal est l’unique cause de
la morl de rinsecte, e lla dissceüon monlre qu’à mesure que le
tballus se met au contact des cellules adipeuses, celles-ci se
séparent, les trachées qui les réunissent disparaissent en tiè re :
F' -I ■;r .J