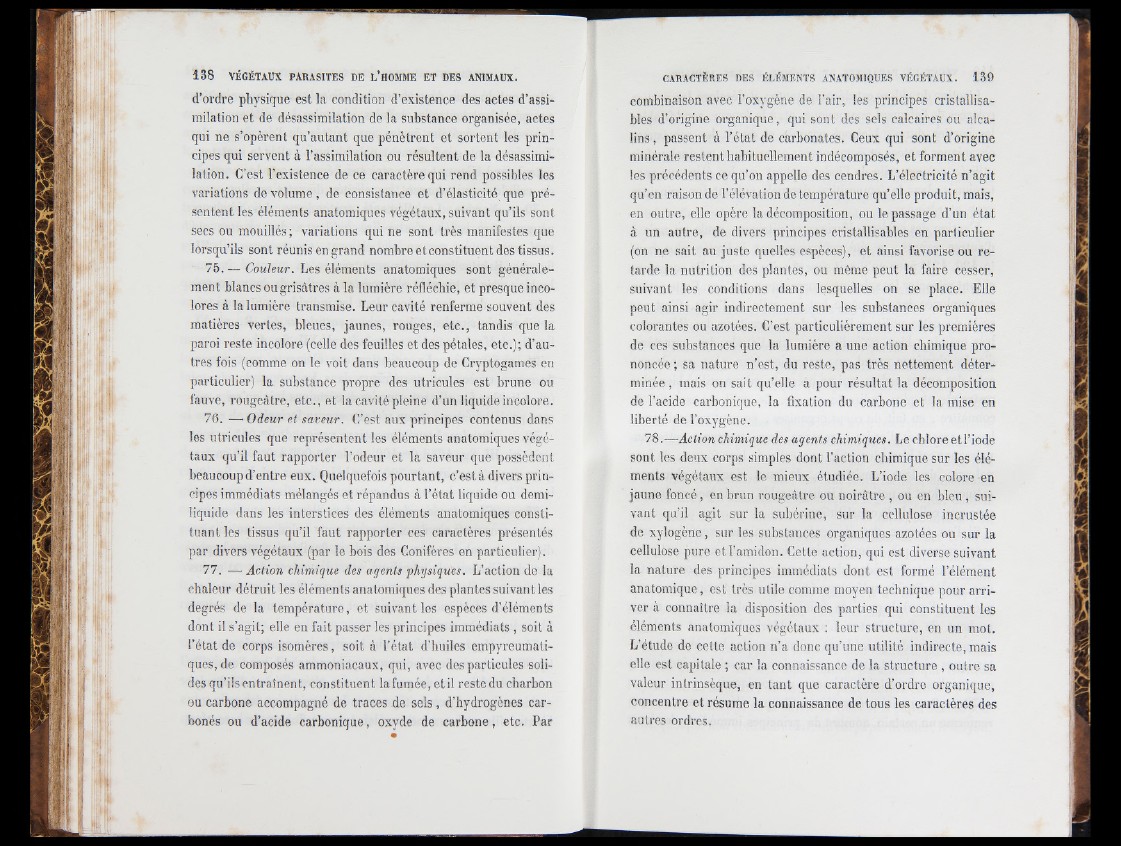
d’ordre physique est la condition d’existence des actes d’assimilation
et de désassimilation de la substance organisée, actes
qui ne s’opèrent qu’au tan t que pénè trent et sortent les principes
qui servent à l ’assimilation ou résultent de la désassimilation.
C’est l’existence de ce caractère qui rend possibles les
variations de volume, de consistance et d’élasticité que présentent
les éléments anatomiques végétaux, suivant qu’ils sont
secs ou mouillés ; variations qui ne sont très manifestes que
lorsqu’ils sont réunis en grand nombre et constituent des tissus.
7 5 .— Couleur. Leséléments anatomiques sont généralement
blancs ou grisâtres à la lumière réfléchie, et presque incolores
à la lumière transmise. Leur cavité renferme souvent des
matières vertes, bleues, jaunes, rouges, e tc ., tandis que ta
paroi reste incolore (celle des feuilles et des pétales, etc.); d’autres
fois (comme on le voit dans beaucoup de Cryptogames en
particulier) la substance propre des utricules est brune ou
fauve, rougeâtre, etc., et la cavité pleine d’un liquide incolore.
76. —■ Odeur et saveur. C’est aux principes contenus dans
les utricules que représentent les éléments anatomiques végétaux
qu’il faut rapporter l’odeur et la saveur que possèdent
beaucoup d’entre eux. Quelquefois pourtant, c’est à divers principes
immédiats mélangés et répandus à l’état liquide ou demi-
liquide dans les interstices des éléments anatomiques constitu
an t les tissus qu’il faut rapporter ces caractères présentés
par divers végétaux (par le bois des Conifères en particulier).
77. — Action chimique des agents physiques. L’action de la
chaleur détruit les éléments anatomiques des plantes suivanties
degrés de la température , et su iv an tie s espèces d’éléments
dont il s’agit; elle en fait passer les principes immédiats , soit à
l’é ta t de corps isomères, soit à l’é ta t d’huiles empyreumati-
ques, de composés ammoniacaux, qui, avec des particules solides
qu’ils entraînent, constituent la fumée, et il reste du charbon
ou carbone accompagné de traces de s e ls , d’hydrogènes carbonés
ou d’acide carbonique, oxyde de ca rb o n e, etc. Par
c a r a c t è r e s d e s ÉLÉMENTS ANATOMIQUES VÉGÉTAUX. 139
combinaison avec l’oxygène de l ’air, les principes cristallisables
d’origine organique, qui sont des sels calcaires ou alcalins
, passent à l’é ta t de carbonates. Ceux qui sont d’origine
minérale restent habituellement indécomposés, e t forment avec
les précédents ce qu’on appelle des cendres. L’électricité n ’agit
qu’en raison de l’élévation de température qu’elle produit, mais,
en outre, elle opère la décomposition, ou le passage d’un é ta t
à un autre , de divers principes cristallisables en parliculier
(on ne sait au juste quelles espèces), et ainsi favorise ou retarde
la nutrition des plantes, ou même peut la faire cesser,
suivant les conditions dans lesquelles on se place. Elle
peut ainsi agir indirectement sur les substances organiques
colorantes ou azotées. C’est particulièrement sur les premières
de ces substances que la lumière a une action chimique prononcée
; sa n ature n ’est, du reste, pas très nettement déterminée
, mais on sait qu’elle a pour ré su lta t la décomposition
de l’acide carbonique, la fixation du carbone et la mise en
liberté de l’oxygène.
7 8 .—Action chimique des agents chimiques. Le chlore e t l ’iode
sont les deux corps simples dont fa c tio n cbimique sur les éléments
végétaux est le mieux étudiée. L’iode les colore en
jaune fo n c é , en brun rougeâtre ou noirâtre , ou en bleu , suivant
qu’il agit sur la subérine, sur la cellulose incrustée
de xy lo g èn e, sur les substances organiques azotées ou sur la
cellulose pure et f amidon. Cette action, qui est diverse suivant
la nature des principes immédiats dont est formé l’élément
anatomique, est très utile comme moyeu technique pour a rriver
à connaître ia disposition des parties qui constituent les
éléments anatomiques végétaux ; leur structure, en un mot.
L’étude de cette action n ’a donc qu’une utilité indirecte, mais
elle est cajtitale ; car la connaissance de la structure , outre sa
valeur intrinsèque, en ta n t que caractère d’ordre organique,
concentre et résume la connaissance de tous les caractères des
auti-es ordres.
I