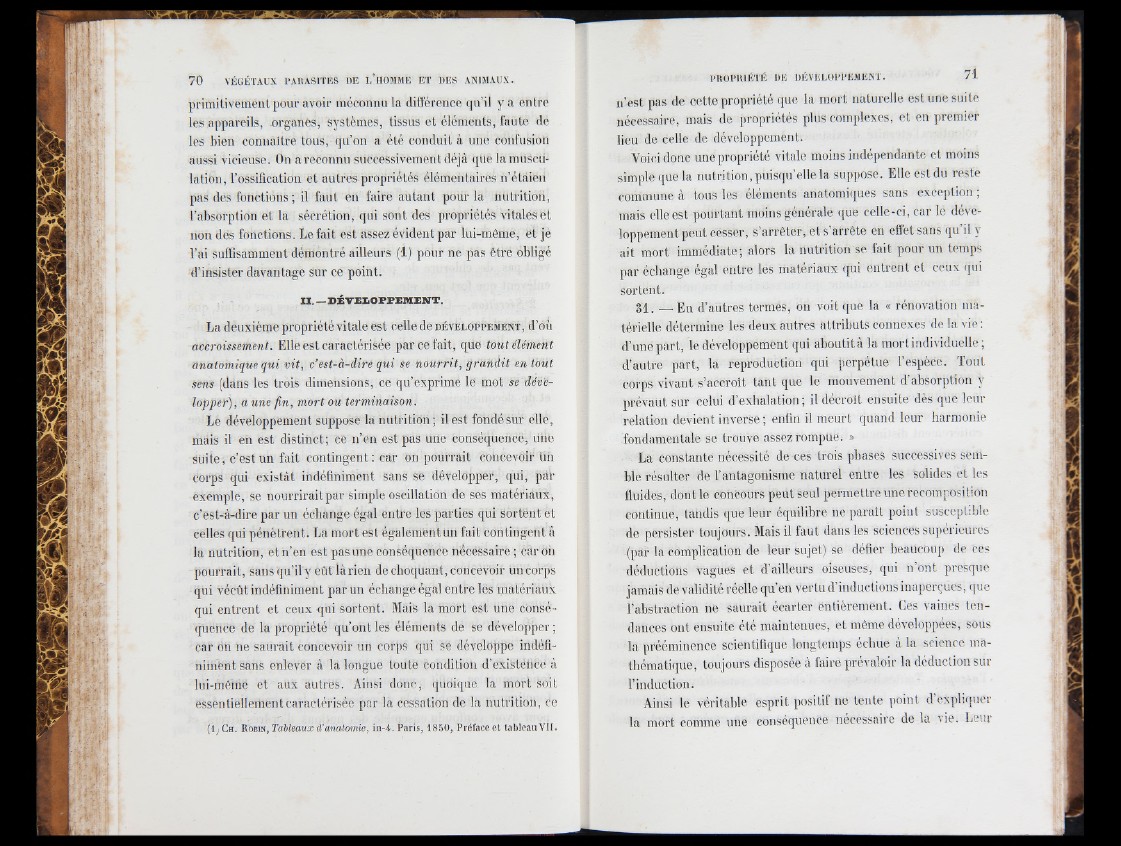
pi'imitivemeiilpoui' avoir mécoiimi la diüéreiice cpi’il y a entre
les appareils, organes, systèmes, tissus et éléments, faute de
les bien connaître tous, qu’on a été conduit à, une confusion
aussi vicieuse. Ou a reconnu successivement déjà que la musculation,
l’ossification et autres propriétés élémentaires n ’étaien
pas des fonctions; il faut en faire autant pour la nutrition,
l’absorption et la sécrétion, qui sont des propriétés vitales et
non des fonctions. Le fait est assez évident par lui-même, et je
l’ai suftisamment démontré ailleurs (1) pour ne pas être obligé
d’insister davantage sur ce point.
II. — BÉVEIOPPEMENT.
La deuxième propriété vilale est celle de d é v e l o p p e m e n t , d’où
accroissement. Elle est caractérisée par ce fait, que tout élément
anatomique qui vit, c’est-à-dire qui se nourrit, grandit en tout
sens (dans les trois dimensions, ce qu’exprime le mot se développer),
aime fin, mort ou terminaison.
Le développement suppose la nutrition ; il est fondé sur elle,
mais il en est distinct; ce n ’en est pas une conséquence, une
suite, c’est un fait contingent: car on pourrait concevoir ün
corps qui existât indéfiniment sans se développer, qui, par
exemple, se nourrirait par simple oscillation de ses matériaux,
c’est-à-dire par un échange égal entre les parties qui sortent et
celles qui pénètrent. La mort est également un fait contingent à
la nutrition, et n ’en est pas une conséquence nécessaire ; car on
pourrait, sans qu’il y eût là rien de choquant, concevoir un corps
qui vécût indéfiniment par un échange égal entre les matériaux
qui entrent et ceux qui sortent. Biais la mort est une conséquence
de la propriété qu’ont les éléments de se développer;
car on ne saurait concevoir un corps qui se développe indéfiniment
sans enlever à la longue toute condition d’existence à
lui-mêmc et aux autres. Ainsi donc, quoique la mort soit
essentiellement caractérisée par la cessation de la initritioii, ce
(1, Ch. Robin, T a b le a u x d ’a n a tom ie , in -4 . P a r is , 1 8 5 0 , P ré fa c e c t ta b lc a uV I I .
n ’e st pas de c e tte p ro p rié té que la m o rt n a lu re lle e sl une su ite
n é cessaire, mais de p ro p rié té s plus complexes, e t en p rem ie r
lieu de celle de développement.
Voici donc une p ro p rié té v ila le moins in d é p e n d a n te e t moins
simple que la n u tritio n , p u isq u ’elle la suppose. El i ees tdu re s te
commune à tous les é lém en ts ana tom iq u e s sans e x c e p tio n ;
mais elle e st ¡lo u rtan t moins g én é ra le (jue c e lle -c i, c a r le dévelo
p p em en t p e u t cesser, s’a r r ê te r, e t s’a rrê te en effet sans q u ’il y
a it m o rt im m éd ia te ; alors la n u tr itio n se fa it p o u r u n temps
p a r éch an g e égal en tre les m a té ria u x qui e n tr e n t e t ceux qui
so rte n t.
3 1 . — En d’autres termes, ou voit que la « rénovation matérielle
détermine les deux autres attributs connexes de la vie :
d’une part, le développement qui aboutità la mortindividiielle ;
d’autre part, la reproduction qui perpétue l’espèce. Tout
corps vivant s’accroît tant que le mouvement d’absorption y
prévaut sur celui d’exhalation ; il décroît ensuite dès que leur
relation devient inverse ; enfin il meurt quand leur harmonie
fondamentale se trouve assez rompue. »
La constante nécessité de ces trois phases successives semble
résulter de f antagonisme naturel entre les solides et les
fluides, dont le concours peut seul permettre une recomposition
continue, tandis que leur équilibre ne paraît point susceptible
de persister toujours. Biais il faut dans les sciences supérieures
(par la complication de leur sujet) se défier beaucoup de ces
déductions vagues et d’ailleurs oiseuses, qui n ’ont presque
jainais de validité réelle qu’en vertu d’inductions inaperçues, que
fab stra ctio n ne saurait écarter entièrement. Ces vaines te n dances
ont ensuite été maintenues, et même développées, sous
la prééminence scientifique longtemps échue à la science mathématique,
toujours disposée à faire prévaloir la déduction sur
findnctioii.
Ainsi le véritable esprit positif ne lente ¡loiiit d’expiliquer
la mort comme une conséquence nécessaire de la vie. Leur
I
Iiu