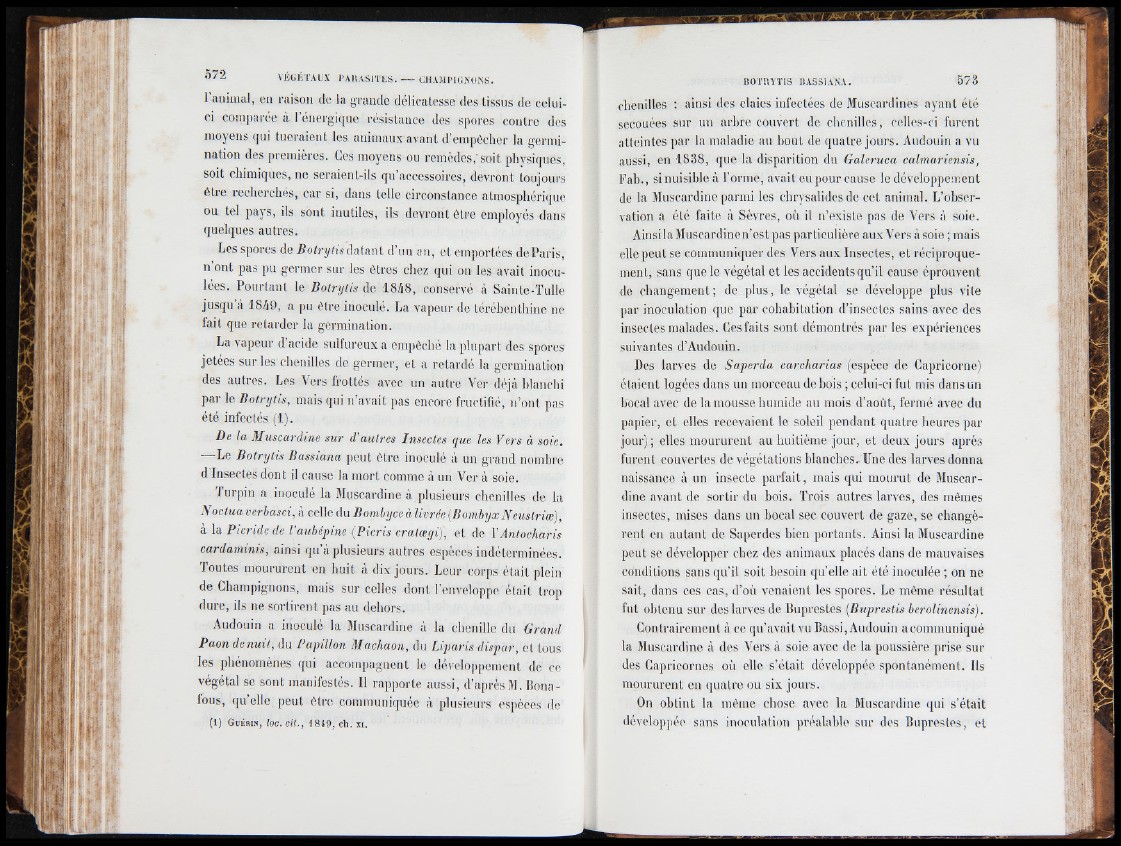
' '1 ■¡1:4
mi?
r i - '
1 animal, en raison de la grande délicatesse des tissus de celui-
ci comparée à réiiergique résistance des spores contre des
moyens qui tueraient les animaux avant d’empêcher la germination
des premières. Ces moyens ou remèdes,’soit physiques,
soit chimiques, ne seraient-ils qu’accessoires, devront toujours
être recherches, car si, dans telle circonstance atmosphérique
ou tel pays, ils sont inutiles, ils devront être employés dans
quelques autres.
Les spores de Botnjhs dniani d’uii an, ct emportées de Paris,
n ont pas pu germer sur ies êtres chez qui ou les avait inoculées.
Pourtant le Boinjtis de 1848, conservé à Sainte-Tulle
jusqu’à 1849, a pu être inoculé. La vapeur de térébeutliiiie ne
fait que retarder la germination.
La vapeur d’acide sulfureux a empêché la plupart des spores
jetées su rle s cbeiiilles de germer, et a retardé la germinalioii
des autres. Les Vers frottés avec un autre Ver déjà blanchi
p ar le Botrytis, mais qui n ’avait pas encore fructifié, n ’ont pas
été infectés (1).
De la Muscardine sur d'autres Insectes que les Vers à soie.
— Le Botrytis Bassiana peut être inoculé à un grand nombre
d Insectes dont il cause la mort comme à un Ver à soie.
Turpin a inoculé la Muscardine à plusieurs chenilles de la
Noctua verhasci, à celle du Bomhijcc à livrée {Bombyx Neuslrioe),
à la Picridedc l’aubépine (Picris cratoegi), et de VAntocharis
cardaminis, ainsi qu’à plusieurs autres espèces indéterminées.
Toutes moururent en liuit à dix jours. Leur corps était plein
de Champignons, mais sur celles dont l’enveloppe était trop
dure, ils ne sortirent pas au dehors.
Audouin a inoculé la Muscardine à la chenille du Grand
Paon denuit, du Papillon Machaon, du Liparis dispar, cl tous
les pbénomènes qui accompagnent le déveIo|)pemciiL de ce
végétal se sont manifestés. Il rapjiorte aussi, d’après M. llona-
fous, qu’elle peut être communiquée à plusieurs espèces de
(1) G u é r in , loc. c i l ., 1 8 4 9 , ch. i i .
chenilles : ainsi des claies infectées de Muscardinés ayant été
secouées sur un arbre couvert de chenilles, celles-ci furent
atteintes par la maladie au boni de quatre jours. Audouin a vu
aussi, en 1838, que la disparition du Galeruca calmariensis,
Fab., si nuisible à Forme, avait eu pour cause le développement
de la Muscardine parmi les chrysalides de cet animal. L’observation
a élé faite à Sèvres, où il n’existe pas de Vers à soie.
Ainsi la Muscardine n’esl pas particulière aux Vers à soie ; mais
elle peut se communiquer des Vers aux Insectes, et réciproquement,
sans que le végétal et les accidents qu’il cause éprouvent
de changement; de plus, le végétal se développe plus vite
par inoculation que par cohabilalion d’insecles sains avec des
insectes malades. Ces faits sont démontrés par les expériences
suivantes d’Audouin.
Des larves de Saperda carcharias (espèce de Capricorne)
élaient logées dans un morceau de bois ; celni-ci fut mis dans un
bocal avec de la mousse humide au mois d’août, fermé avec du
papier, et elles recevaient le soleil pendant quatre heures par
jour); elles moururent au b u itièm e jour, et deux jours après
furent couvertes de végétations blanches.. Une des larves donna
naissance à un insecte p arfait, mais qni mourut de Muscardine
avant de sortir du bois. Trois autres larves, des mêmes
insectes, mises dans un bocal sec couvert de gaze, se changèrent
cn autant de Saperdes bien portants. Ainsi la Muscardine
peut se développer cbez des animaux placés dans de mauvaises
conditions sans qu’il soit besoin qu’elle ait été inoculée ; on ne
sait, dans ces cas, d’où venaient les spores. Le même résultat
fut obicnu sur des larves de Buprestes [Buprcstis berolinensis).
Contrairement à ce qu’avait vu Bassi, Audouin a communiqué
la Muscardine à des Vers à soie avec de la poussière prise sur
des Capricornes où elle s’était développée spontanément. Ils
moururent eu quatre ou six jours.
On obtint la même chose avec la Muscardine qui s’était
développée sans inoculation préalable sur des Buprestes, el
¡F
’(li"'
‘r i;
: ■¡i '-
■ ï