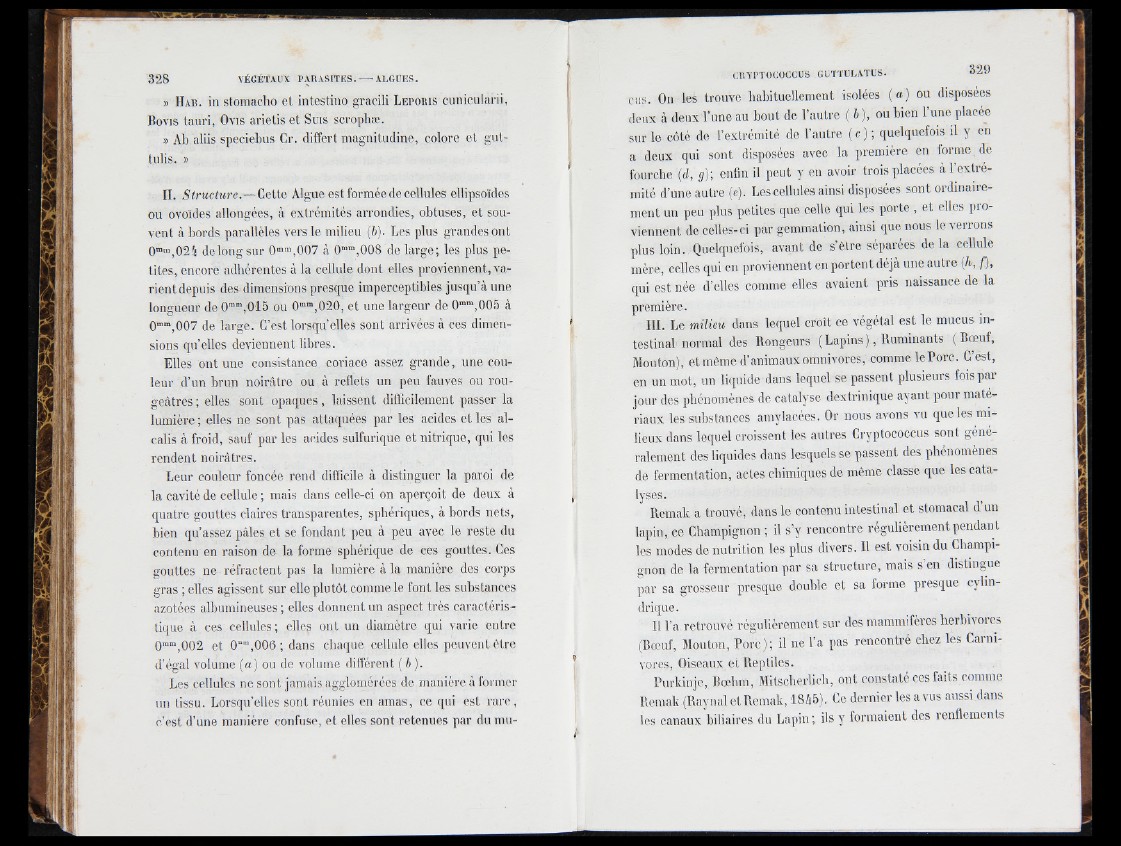
I'
l'f? T “ . :
;. i
-i-.':.
328 VÉGÉTAUX I'AUASlTES.-— ALGUES.
» Hab. ili stomacho el intestino gracili Leporis cunicularii,
Bovis tauri, Ovis arietis et Suis scrophæ.
» Ab aliis speciebus Cr. differì magnitudine, colore et gul-
tnlis. »
11. Airiief i/rr.—Cette Algue est formée de cellules ellipsoïdes
ou OY'Oïdes allongées, à extrémités arrondies, obtuses, et souvent
à bords parallèles vers le milieu {}>). Les plus grandes ont
0mm,02 i de long sur 0""«,007 à 0““ ,008 de large; les plus petites,
encore adhérentes à la cellule dont elles proviennent, varient
depuis des dimensions presque imperceptibles jusqu’à une
longueur de 0'”™,015 ou 0“ ” ,020, et une largeur de 0“ ” ,005 à
0mm,007 qg large. C’est lorsqu’elles sont arrivées à ces dimensions
qu’elles deviennent libres.
Elles out une consistance coriace assez grande, une couleur
d’un brun noirâtre ou à reflets un peu fauves ou ro u geâtres
; elles sont opaq u e s, laissent difficilement passer la
lumière; elles ne soot pas attaquées par les acides e lle s alcalis
à froid, sauf par les acides sulfurique et nitrique, qui les
rendent noirâtres.
Leur couleur foncée rend difficile à distinguer la paroi de
la cavité de cellule ; mais dans celle-ci on aperçoit de deux à
quatre gouttes claires transparentes, sphériques, à bords nets,
bien qu’assez pâles et se fondant peu à peu avec le reste du
contenu en raison de la forme sphérique de ces gouttes. Ces
gouttes ne réfractent pas la lumière à la manière des corps
gras ; elles agissent sur elle plutôt comme le font les substances
azotées albumineuses ; elles donnent un aspect très ca ractéristique
à ces cellules; elles ont un diamètre qui varie entre
Omm,oo2 et O““’,006 ; dans chaque cellule elles peuvent être
d’égal volume (a ) ou de volume différent ( h).
Les cellules ne sont jamais agglomérées de manière à former
nn tissu. Lorsqu’elles sont réunies en amas, ce qui est ra re ,
c’est d’une manière confuse, et elles sont retenues par du mu-
E u V r T « c ü c u u s G u T T u 1. A ï u s . 329 n'M
eus. On les trouve liahituellement isolées ( a ) ou disposées
deux à deux l’une au bout de l’autre ( h), ou bien 1 une placée
sur le côté de l’extrémité de l’autre ( c ) ; quelquefois il y on
a deux qui sont disposées avec la première en lorme de
fourche {d, g'y, cnün il peut y en avoir trois placées a l’extre-
mité d’une autre (e). Les cellules ainsi disposées sont ordinairement
uu peu plus petites que celle qui les porte , et elles proviennent
de celles-ci par gemmation, ainsi que nous le verrons
plus loin. Quelquefois, avant de s’Ôtre séparées d e là cellule
mère, celles qui en proviennent en portent déjà une autre [h, f),
qui est née d’elles comme elles avaient pris naissance de la
première.
III. Le milieu dans lequel croît ce végétal est le mucus intestinal
normal des Rongeurs ( Lapins) , Ruminants (Boeuf,
Mouton), et même d’animaux omnivores, comme leP o rc . C’est,
en un mot, nn liquide dans lequel se passent plusieurs fois par
jour des phénomènes de catalyse dextrinique ayant pour matériaux
les substances amylacées. Or nous avons vu qu eles milieux
dans lequel croissent les autres Cryptococcus sont généralement
des liquides dans lesquels se passent des phénomènes
de fermentation, actes chimiques de même classe que le sc a ta -
lyses.
" Remak a trouvé, dans le contenu intestinal et stomacal d’un
lapin, ce Champignon ; il s’y rencontre régulièrement pendant
les modes de nutrition les plus divers. Il est voisin du Champignon
de la fermenlation par sa structure, mais s’en distingue
par sa grosseur presque double et sa forme presque cylindrique.
Il l’a retrouvé régulièrement sur des mammifères Irerhivores
(Boeuf, Mouton, P o rc ); il ne l’a pas rencontré chez les Carnivores,
Oiseaux et Reptiles.
Purkinje, Roehm, Mitscherlich, ont constaté ces faits comme
Remak (Raymil et Remak, 1845). Ce dernier les a vus aussi dans
les canaux biliaires du Lapin; ils y formaient des renflements