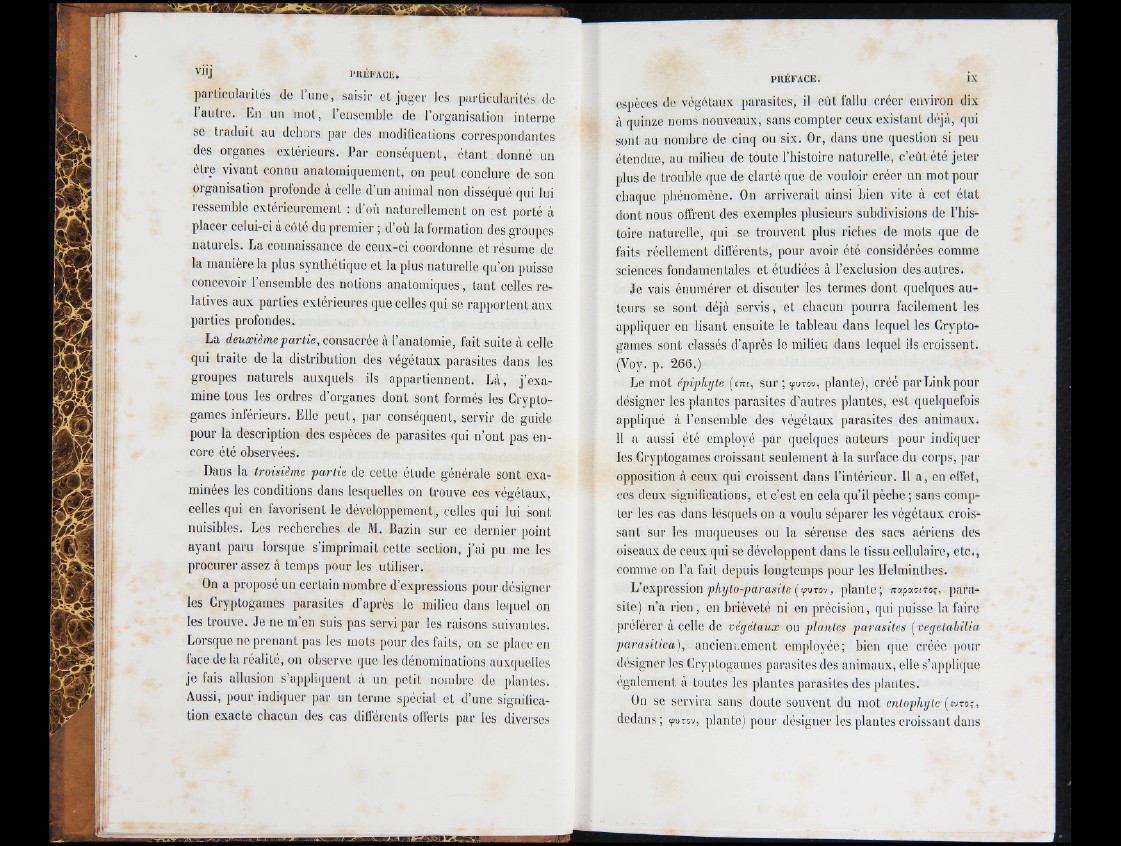
particularités de lu n e , saisir et juger les particularités de
1 autre. En un mot, 1 ensemble de l’organisation iiiteruc
se traduit au dehors par des modilications correspoiidaiites
des organes extcrienrs. Par conséquent, étan t donné un
être vivant connu anatomiquement, on peut conclure de son
organisation profonde à celle d’un animal non disséqué qui lui
ressemble extérieurement ; d’où naturellement on est poi'té à
placer celui-ci à côté du premier ; d’où la formation des groupes
naturels. La connaissance de ceux-ci coordonne et résume de
la manière la plus synthétique et la plus naturelle qu’oii puisse
concevoir l’ensemble des notions anatomiques, taut celles re latives
aux parties extérieures que celles qui se rapjiortent aux
parties profondes.
La deuxième partie, à l’anatomie, fait suite à celle
qui traite de la distribution des végétaux parasites dans les
groupes naturels auxquels ils appartiennent. L à, j ’examine
tous les ordres d’organes dont sont formés les Cryptogames
inférieurs. Elle p e u t, par conséquent, servir de guide
pour la description des espèces de parasites qui n ’ont pas encore
été observées.
Dans la troisième partie de cette étude générale sont examinées
les conditions dans lesquelles on trouve ces végétaux,
celles qui en favorisent le développement, celles qui lui sont
nuisibles. Les recherches de M. Bazin sur ce dernier point
ayant paru lorsque s’imprimait cette section, j ’ai pu me les
procurer assez à temps pour les utiliser.
On a proposé un certain nombre d’expressions pour désigner
les Cryptogames parasites d’après le milieu dans lequel on
les trouve. Je ne m’en suis pas servi par les raisons suivantes.
Lorsque ne prenant pas les mots pour des faits, on se place en
face de la réalité, on observe que les dénominations auxquelles
je fais allusion s’appliquent à un petit nombre de plantes.
Aussi, pour indiquer par un terme spécial et d’une signilica-
tion exacte chacua des cas dilférciits offerts par les diverses
espèces de végétaux parasites, il eût fallu créer environ dix
à quinze noms nouveaux, sans compter ceux existant déjà, qui
sont au nombre de cinij ou six. Or, dans une question si peu
étendue, au milieu de toute l’histoire naturelle, c’eût été je ter
plus de trouble que de clarté que de vouloir créer un mot pour
chaque phénomène. On arriverait ainsi bien vite à cet é ta t
dont nous olfrent des exemples plusieurs subdivisions de l’histoire
naturelle, qui se trouvent plus riches de mots que de
faits réellement diiïérents, pour avoir été considérées comme
sciences fondamentales et étudiées à l’exclusion des autres.
Je vais énumérer et discuter les termes dont quelques auteurs
se sont déjà servis, et chacun pourra facilement les
appliquer en lisant ensuite le tableau dans lequel les Cryptogames
sont classés d’après le milieu dans lequel ils croissent.
(Voy. p. 206.)
Le mot épiphyte (etti, s u r ; -furov, plante), créé parL in k p o u r
désigner les plantes parasites d ’autres plantes, est quelquefois
appliqué à l’ensemble des végétaux parasites des animaux.
11 a aussi été employé par quelques auteurs pour indif[ucr
les Cryptogames croissant seulement à la surface du corps, par
opposition à ceux qui croissent dans l’intérieur. Il a , en elîét,
ces deux significations, et c’est en cela qu’il pèche ; sans compter
les cas dans lesquels on a voulu séparer les végétaux croissant
sur les muqueuses ou la séreuse des sacs aériens des
oiseaux de ceux qui se développent dans le tissu cellulaire, etc.,
comme on l’a fait depuis longtemps pour les Helminthes.
U expression phijto-par as i te {fuzo'j, p lan te; •îrapacri'fo?, parasite)
n ’a rien , en brièveté ni en précision, qui puisse la faire
préférer à celle de végétaux ou plantes parasites ( vegelabilia
parasitica), ancieni.emeut employée; bien que créée pour
designer les Cryptogames parasites des animaux, elle s’applique
également à toutes les plantes parasites des plantes.
On se servira sans doute souvent du mot entophyte (evto:,
dedans; yurov, plante) pour désigner les plantes croissant dans
E U