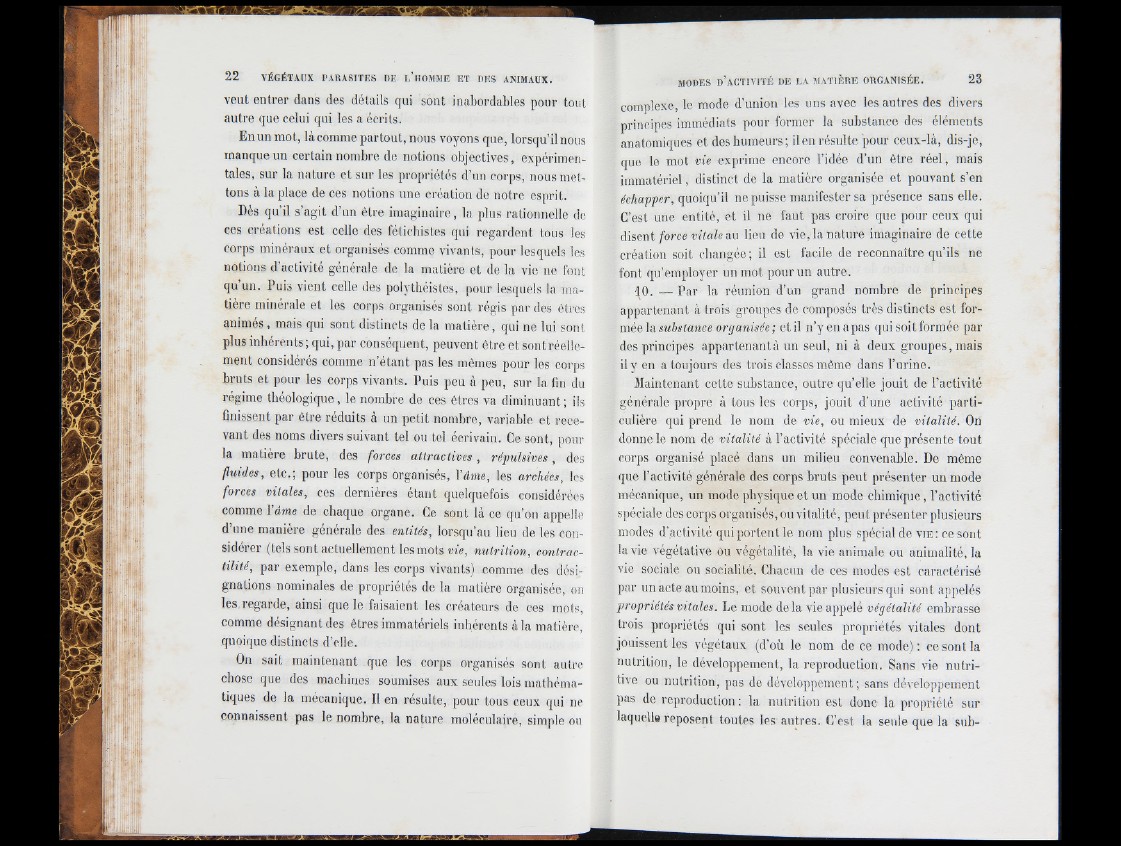
riP^îH', ■
i P è r i i i
lîi,r fÎLi»,*. ':è: ■I II'
aMèi' f ■.
ii■i r'j ■ l■u
ill
veut entrer dans des détails qui sont inabordables pour tout
autre que celui qui les a écrits.
En un mot, là comme partout, nous voyons que, lorsqu’il nous
manque un certain nombre de notions objectives, expérimentales,
sur la nature et sur les propriétés d’un corps, nous mettons
à la place de ces notions une création de notre esprit.
Dès qu’il s’agit d’un être imagina ire, la plus raLionneJle de
ces créations est celle des féticbistes qui regardent tous les
corps minéraux et organisés comme vivants, pour lesquels les
notions d’activité générale de la matière et de la vie ne font
qu un. Puis vient celle des polythéistes, pour lesquels la matière
minérale et les corps organisés sont régis par des êtres
animés, mais qui sont distincts d e là m a tiè re , qui ne lui sont
plus inhérents; qui, par conséquent, peuvent être et sont réellement
considérés comme n ’étan t pas les mômes pour les corps
bruts et pour les corps vivants. Puis peu à peu, sur la fin du
régime théologique, le nombre de ces êtres va diminuant; ils
finissent par être réduits à un petit nombre, variable et recevant
des noms divers suivant tel ou tel écrivain. Ce sont, pour
la matière brute, des forces attractives , répulsives, des
fluides, etc.; pour les corps organisés, Vâme, les archées, les
forces vitales, ces dernières étant quelquefois considérées
comme Vdme de chaque organe. Ce sont là ce qu’on appelle
d’une manière générale des entités, lorsqu’au lieu de les considérer
(tels sont actuellement lesmots Die, nutrition, contractilité,
par exemple, dans les corps vivants) comme des désignations
nominales de propriétés do la matière organisée, on
les regarde, ainsi que le faisaient les créateurs de ces mots,
comme désignant des êtres immatériels inhérents à la matière,
quoique distincts d’clle.
On sait maintenant que les corps organisés sont antre
chose que des machines soumises aux seules lois mathématiques
de la mécanique. Il en résulte, pour tous ceux qui ne
connaissent pas le nombre, la nature moléculaire, simple on
complexe, le mode d’union les uns avec les autres des divers
principes immédiats pour former la substance des éléments
anatomiques et des humeurs; ilen résulte pour ceux-là, dis-je,
que le mot vie exprime encore l’idée d ’un être ré e l, mais
immaté riel, distinct de la matière organisée et pouvant s’en
échapper, quoiqu’il ne puisse manifester sa présence sans elle.
C’est une entité, et il ne faut pas croire que pour ceux qui
disent force vitale au lien de vie, la n ature imaginaire de cette
création soit changée; il est facile de reconnaître qu’ils ne
font qu’employer un mot pour un autre.
10. — Par la réunion d’un grand nombre de principes
appartenant à trois groupes de composés très distincts est formée
la jMkiawce organisée; et il n ’y e n a p a s qui soit formée par
des principes appartenant à un seul, ni à deux gro u p es, mais
il y en a toujours des trois classes même dans l’urine.
Alaintenant cette substance, outre qu’elle jouit de l’activité
générale propre à tous les corps, jouit d’une activité p a rticulière
qui prend le nom de vie, ou mieux de vitalité. On
donne le nom de vitalité à l’activité spéciale que présente tout
corps organisé placé dans un milieu convenable. De même
que l’activité générale des corps bruts peut présenter un mode
mécanique, un mode physique et un mode chimique, l ’activité
spéciale des corps organisés, ou vitalité, peut présenter plusieurs
modes d’activité qui po rten t le nom plus spécial de vie: ce sont
la vie végétative ou végétalité, la vie animale ou animalité, la
vie sociale ou socialité. Chacun de ces modes est caractérisé
par un acte au moins, et souvent par plusieurs qui sont appelés
propriétés vitales. Le mode d e là vie appelé végétalité embrasse
trois propriétés qui sont les seules propriétés vitales dont
jouissent les végétaux (d’où le nom de ce mode) : ce sont la
nutrition, le développement, la reproduction. Sans vie n u tritive
ou nutrition, pas de développement; sans développement
pas de reproduction: la nutrition est donc la propriété sur
laquelle reposent toutes les autres. C’est la sevde que la sub