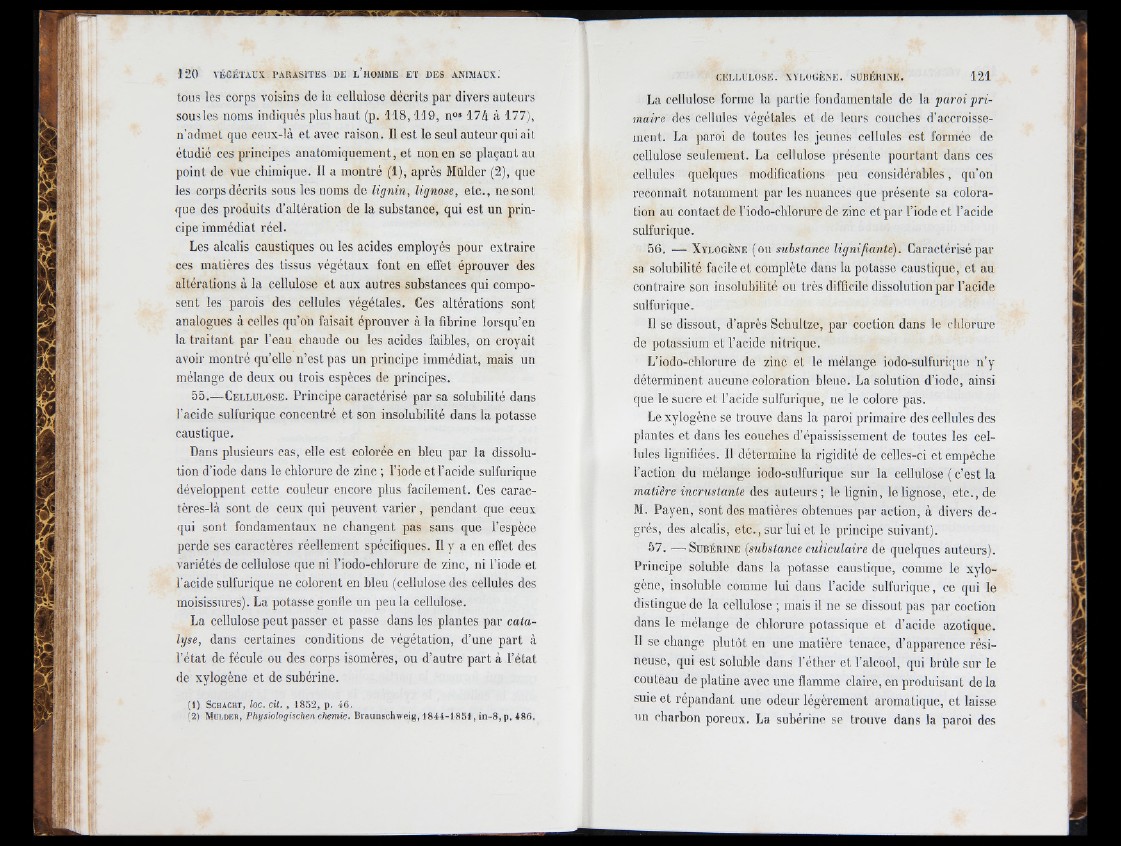
tous les corps voisins de ia cellulose décrits par divers auteurs
souslcs noms indiqués plushaut (p. 1 1 8 ,1 1 9 , n “» 174 à 177),
n ’admet que ceux-là et avec raison. Il est le seul auteur qui ait
étudié ces principes anatomiquement, et non en se plaçant au
point de vue chimique. II a montré (1), après Mülder (2), que
les corps décrits sous les noms de lignin, lignose, etc., nesonl
que des produits d’altération de la substance, qui est un principe
immédiat réel.
Les alcalis caustiques ou les acides employés pour extraire
ces matières des tissus végétaux font en effet éprouver des
altérations à la cellulose et aux autres substances qui composent
les parois des cellules végétales. Ces altérations sont
analogues à celles qu’on faisait éprouver à la fibrine lorsqu’en
la traitan t par l’eau chaude ou les acides faibles, on croyait
avoir montré qu’elle n ’est pas un principe immédiat, mais un
mélange de deux ou trois espèces de principes.
55.— C e l l u l o s e . Principe caractérisé par sa solubilité dans
l’acide sulfurique concentré et son insolubilité dans la potasse
caustique.
Dans plusieurs cas, elle est colorée en bleu par la dissolution
d’iode dans le chlorure de zinc ; l ’iode et l’acide sulfurique
développent cette couleur encore plus facilement. Ces carac-
tères-ià sont de ceux qui peuvent v a rie r, pendant que ceux
qui sont fondamentaux ne changent pas sans que l’espèce
perde ses caractères réellement spécifiques. Il y a en effet des
variétés de cellulose que ni Fiodo-clilorure de zinc, ni l’iode et
l’acide sulfurique ne colorent en bleu (cellulose des cellules des
moisissures). La potasse gonfie un peu la cellulose.
La cellulose peut passer et passe dans les plantes par catalyse,
dans certaines conditions de végétation, d’une p a rt à
l’é ta t de fécule ou des corps isomères, ou d’autre p a rt à l’état
de xylogène et de subérine.
(1) Sch a c h t , loc. cil. , 1832, p. 46.
'2) Mülder, Physiolngischenchemie. Braunschweig, 1 8 4 4 -1851, in -8 ,p . 486.
La cellulose forme la partie fondamentale de la paroi p r imaire
des cellules végétales et de leurs couches d’accroissement.
La jiaroi de toutes les jeunes cellules est formée de
cellulose seulement. La cellulose présente pourtant dans ces
cellules quelques modifications peu considérables, qu’on
reconnaît notamment par les nuances que présente sa coloration
au contact de l’iodo-chlorure de zinc et par l’iode et l ’acide
sulfurique.
56. — X y l o g è n e (ou substance lignifiante). Caractérisé par
sa solubilité facile et complète dans la potasse caustique, et au
contraire son insolubilité ou très difficile dissolution par l’acide
sulfurique.
Il se dissout, d’après Schultze, par coction dans le cbiorure
de potassium et l’acide nitrique.
L’iodo-cblorure de zinc et le mélange iodo-sulfuriipic u ’y
déterminent aucune coloration bleue. La solution d’iode, ainsi
que le sucre et l’acide sulfurique, ne le coloi’e pas.
Le xylogène se trouve dans la paroi primaire des cellules des
plantes et dans les couches d’épaississement de toutes les cellules
lignifiées. Il détermine la rigidité de celles-ci et empêche
l’action du mélange iodo-sulfurique sur la cellulose ( c’est la
matière incrustante des au teu rs; le lignin, le lignose, etc., de
M. Payen, sont des matières obtenues par action, à divers degrés,
des alcalis, etc ., sur lui et le principe suivant).
57. —^ S u b é r i n e [substance cuticulaire de quelques auteurs).
Principe soluble dans la potasse caustique, comme le xylogène,
insoluble comme lui dans l’acide sulfurique, ce qui le
distingue de la cellulose ; mais il ne se dissout pas par coction
dans le mélange de cbiorure potassique et d’acide azotique.
Il se change plutôt en une matière tenace, d’apparence résineuse,
qui est soluble dans l’éther et l’alcool, qui brûle sur le
couteau de platine avec une flamme claire, en produisant d e là
suie et répandant une odeur légèrement aromatique, et laisse
nn charbon poreux. La subérine se trouve dans la paroi des
-f,