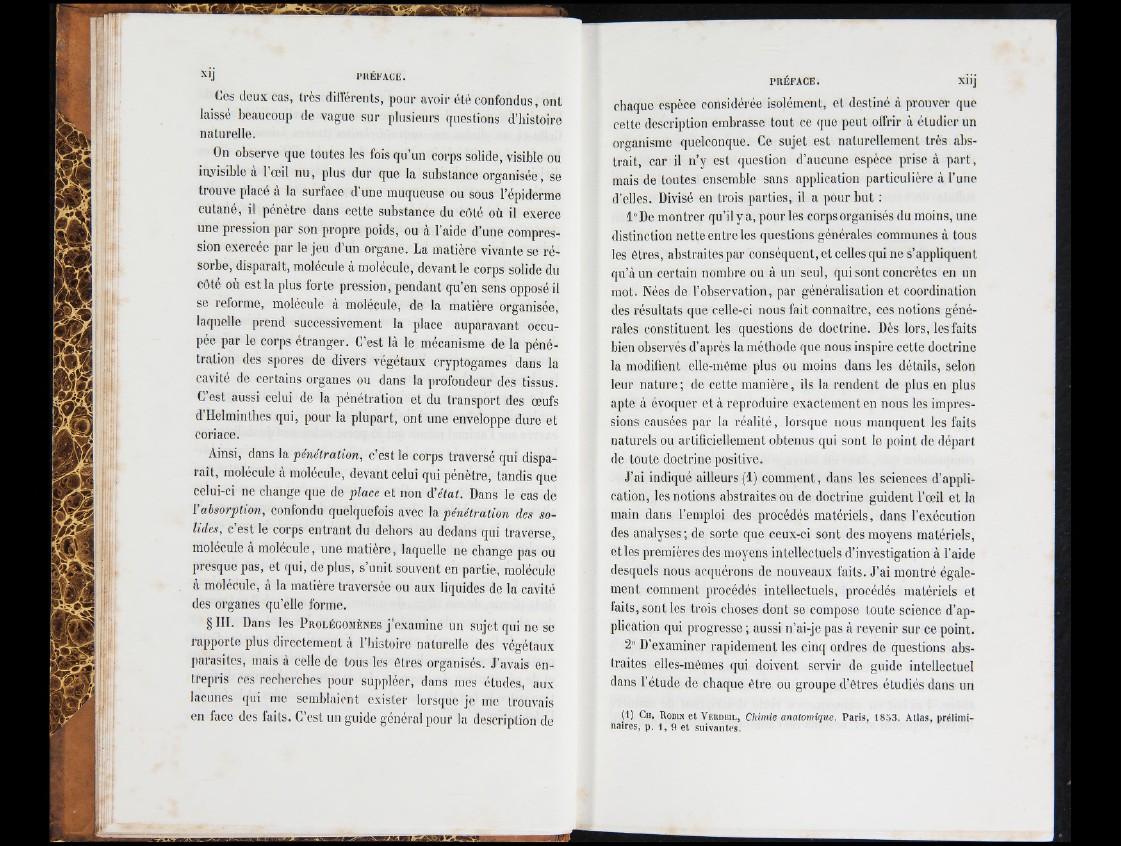
Ces deux cas, très différents, pour avoir été confondus, ont
laissé beaucoup de vague sur plusieurs questions d’histoire
naturelle.
On observe que toutes les fois qu’un corps solide, visible ou
invisible à l’oeil n u , plus dur que la substance organisé e, se
trouve placé ii la surface d’une muqueuse ou sous l’épiderme
cutané, il pénètre dans cette substance du côté où il exerce
une pression par son propre poids, ou à l’aide d’une compression
exercée par le jeu d’un organe. La matière vivante se ré sorbe,
disparaît, molécule à molécule, devant le corps solide du
côté où est la plus forte pression, pendant qu’en sens opposé il
se reiorme, molécule à molécule, de la matière organisée,
laquelle prend successivement la place auparavant occupée
iw le corps étranger. C’est là le mécanisme de la pénétration
des spores de divers végétaux cryptogames dans la
cavité de certains organes ou dans la profondeur des tissus.
C’est aussi celui de la pénétration et du transport des oeufs
d’Helminthes qui, pour la plupart, ont une enveloppe dure et
coriace.
Ainsi, dans \tx pénétration, c’est le corps traversé qui dispara
ît, molécule à molécule, devant celui qui pénètre, tandis que
celui-ci ne change que de place et non d’e'iaf. Dans le cas de
l’absorption, confondu quelquefois avec la pénétration des solides,
c est le corps en tran t du dehors au dedans qui traverse,
molécule à molécule, une ma tiè re , laquelle ne change pas ou
presque pas, et qui, de plus, s’unit souvent en partie, molécule
à molécule, à la matière traversée ou aux liquides de la cavité
des organes qu’elle forme.
§ III. Dans les P r o l é g o m è n e s j ’examine un sujet qui ne se
rapporte plus directement à l’histoire naturelle des végétaux
parasites, mais à celle de tous les êtres organisés. J ’avais entrepris
ces recherches pour suppléer, dans mes études, aux
lacunes qui me semblaient exister lorsque je me trouvais
en face des faits. C’est un guide général pour la description de
PREFAC E. XM]
chaque espèce considérée isolément, et destiné à prouver que
cette description embrasse tout ce que peut offrir à étudier un
organisme quelconque. Ce sujet est naturellement très abstrait,
car il n ’y est question d’aucune espèce prise à p a rt,
mais de toutes ensemble sans application particulière à l’une
d’elles. Divisé en trois parties, il a pour but :
l°De montrer qu’il y a, pour les corps organisés du moins, une
distinction nette en tre les questions générales communes à tous
les êtres, abstraites par conséquent, et celles qui ne s’appliquent
qu’à un certain nombre ou à un seul, qui sont concrètes en un
mot. Nées de l’observation, par généralisation et coordination
des résultats que celle-ci nous fait connaître, ces notions générales
constituent les questions de doctrine. Dès lors, les faits
bien observés d’après la méthode que nous inspire cette doctrine
la modifient elle-même plus ou moins dans les détails, selon
leur n a tu re ; de cette manière, ils la rendent de plus en plus
apte à évoquer et à reproduire exactement en nous les impressions
causées par la réa lité , lorsque nous manquent les faits
naturels ou artificiellement obtenus qui sont le point de départ
de toute doctrine positive.
J ’ai indiqué ailleurs (1) comment, dans les sciences d’application,
les notions abstraites ou de doctrine guident l ’oeil et la
main dans l’emploi des procédés matériels, dans l’exécution
des analyses; de sorte que ceux-ci sont des moyens matériels,
et les premières des moyens intellectuels d’investigation à l’aide
desquels nous acquérons de nouveaux faits. J ’ai montré également
comment procédés intellectuels, procédés matériels et
faits, sont les trois choses dont se compose toute science d’application
qui progresse ; aussi n ’ai-je pas à revenir sur ce point.
2“ D’examiner rapidement les cinq ordres de questions abstraites
elles-mêmes qui doivent servir de guide intellectuel
dans l’étude de chaque être ou groupe d’êtres étudiés dans un
(1) Cu. Robin e t V e r d i ï i l , Ch im ie a n a tom iq u e . P a r is , 1 8 5 3 . A tla s, p ré lim in
a ire s , p . 1 , 9 e t s u iv a n te s .
éL B U