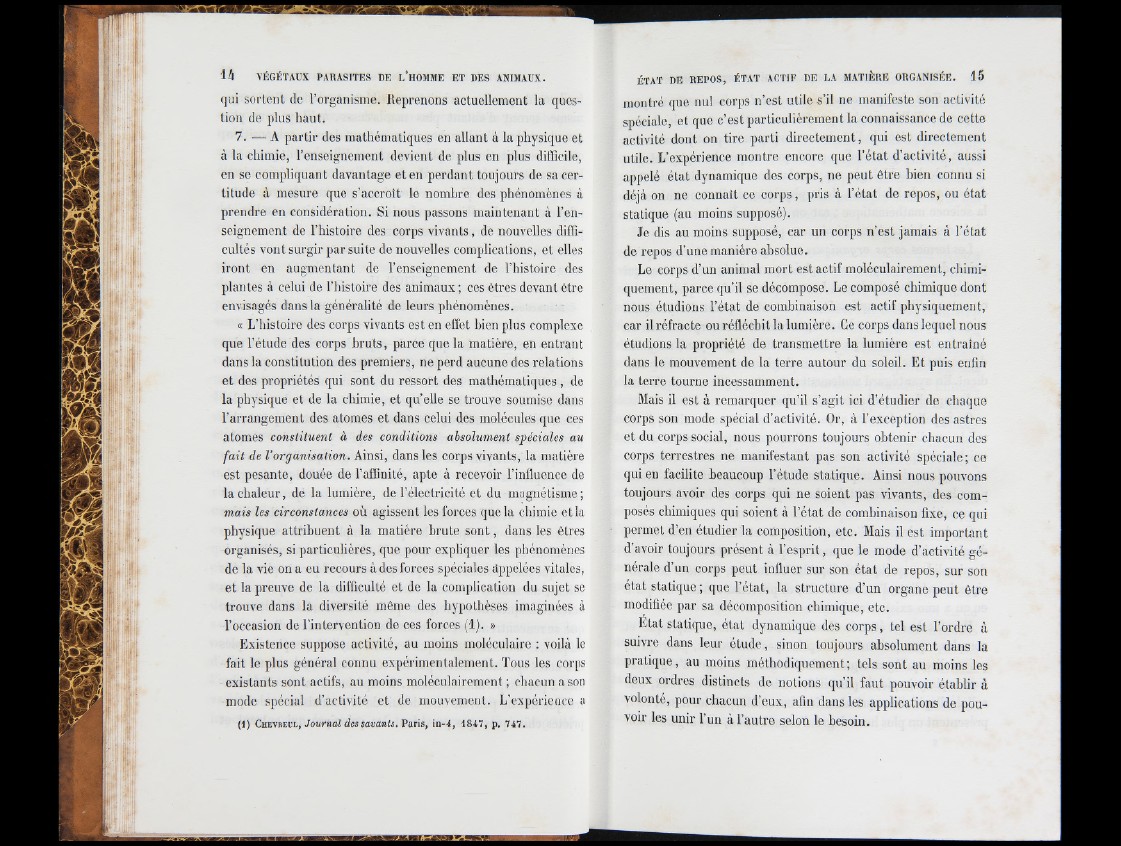
qui sortent de l’organisine. Reprenons actuellement la question
de plus haut.
7. ■— A partir des mathématiques en allant à la physique et
à la chimie, l’enseignement devient de plus en plus difficile,
en se compliquant davantage et en perdant toujours de sa certitude
à mesure que s’accroît le nombre des phénomènes à
prendre en considération. Si nous passons maintenant à l’enseignement
de l’histoire des corps v iv an ts, de nouvelles difficultés
vont surgir par suite de nouvelles complications, et elles
iront en augmentant de l’enseignement de l’histoire des
plantes à celui de l’histoire des animaux ; ces êtres devant être
envisagés dans la généralité de leurs phénomènes.
« L’histoire des corps vivants est en effet bien plus complexe
que l’étude des corps b ru ts , parce que la matière, en entrant
dans la constitution des premiers, ne perd aucune des relations
e t des propriétés qui sont du ressort des ma thém atiques, de
la physique et de la chimie, et qu’elle se trouve soumise dans
l’arrangement des atomes et dans celui des molécules que ces
atomes constituent à des conditions absolument spéciales au
fa it de l’organisation. Ainsi, dans les corps vivants, la matière
est pesante, douée de l ’affinité, apte à recevoir l’influence de
la chaleur, de la lumière, de l’électricité et du magnétisme;
mais les circonstances où agissent les forces que la chimie et la
physique attribuent à la matière brute s o n t , dans les êtres
organisés, si particulières, que pour expliquer les phénomènes
de la vie on a eu recours à des forces spéciales appelées vitales,
e t la preuve de la difficulté et de la complication du sujet se
trouve dans la diversité même des hypothèses imaginées à
l’occasion de rintervention de ces forces (1). »
Existence suppose activité, au moins moléculaire : voilà le
fait le plus général connu expérimentalement. Tous les corps
existants sont actifs, au moins moléculairemenl ; chacun a son
mode spécial d’activité et de mouvemenl. L’expérieuce a
(1) C h e v r e u l , J o u r n a l des s a v a n ts . P a r is , in - 4 , 1 8 4 7 , p . 7 4 7 .
ÉTAT DE REPO S, ÉTAT ACTIF DE LA MATIÈRE ORGANISÉE. 15
montré que nul corps n ’est utile s ’il ne manifeste son activité
spéciale, et que c’est particulièrement la connaissance de cette
activité dont on tire p arti d irectement, qui est directement
utile. L’expérience montre encore que l ’é ta t d’activité, aussi
appelé état dynami([ue des corps, ne peut être bien connu si
déjà on ne connaît ce c o rp s , pris à l’é ta t de repos, ou état
statique (au moins supposé).
Je dis au moins supposé, car un corps n ’est jamais à l’é ta t
de repos d’une m anière absolue.
Le corps d’un animal mort est actif moléculairement, chimiquement,
parce qu’il se décompose. Le composé chimique dont
nous étudions l’é ta t de combinaison est actif physiquement,
car il réfracte ou réfléchit la lumière. Ce corps dans lequel nous
étudions la propriété de transmettre la lumière est entraîné
dans le mouvement de la te rre autour du soleil. E t puis enfin
la terre tourne incessamment.
3Iais il est à remarquer qu’il s’agit ici d’étudier de chaque
corps son mode spécial d’activité. Or, à l’exception des astres
et du corps social, nous pourrons toujours obtenir chacun des
corps terrestres ne manifestant pas son activité spéciale; ce
qui en facilite beaucoup fé tu d e statique. Ainsi nous pouvons
toujours avoir des corps qui ne soient pas vivants, des composés
chimiques qui soient à l ’é ta t de combinaison fixe, ce qui
permet d’en étudier la composition, etc. 3Iais il est important
d’avoir toujours présent à f e s p rit, que le mode d’activité générale
d’un corps peut influer sur son é ta t de repos, sur son
état statique ; que l’état, la stru ctu re d’un organe peut être
modifiée par sa décomposition chimique, etc.
Éta t statique, é ta t dynamique des c o rp s , tel est l’ordre à
suivre dans leur é tu d e , sinon toujours absolument dans la
pratique, au moins méthodiquement; tels sont au moins les
deux ordres distincts de notions qu’il faut pouvoir établir à
volonté, pour chacun d’eux, afin dans les applications de pouvoir
les unir l’un à l’autre selon le besoin.
A smsa