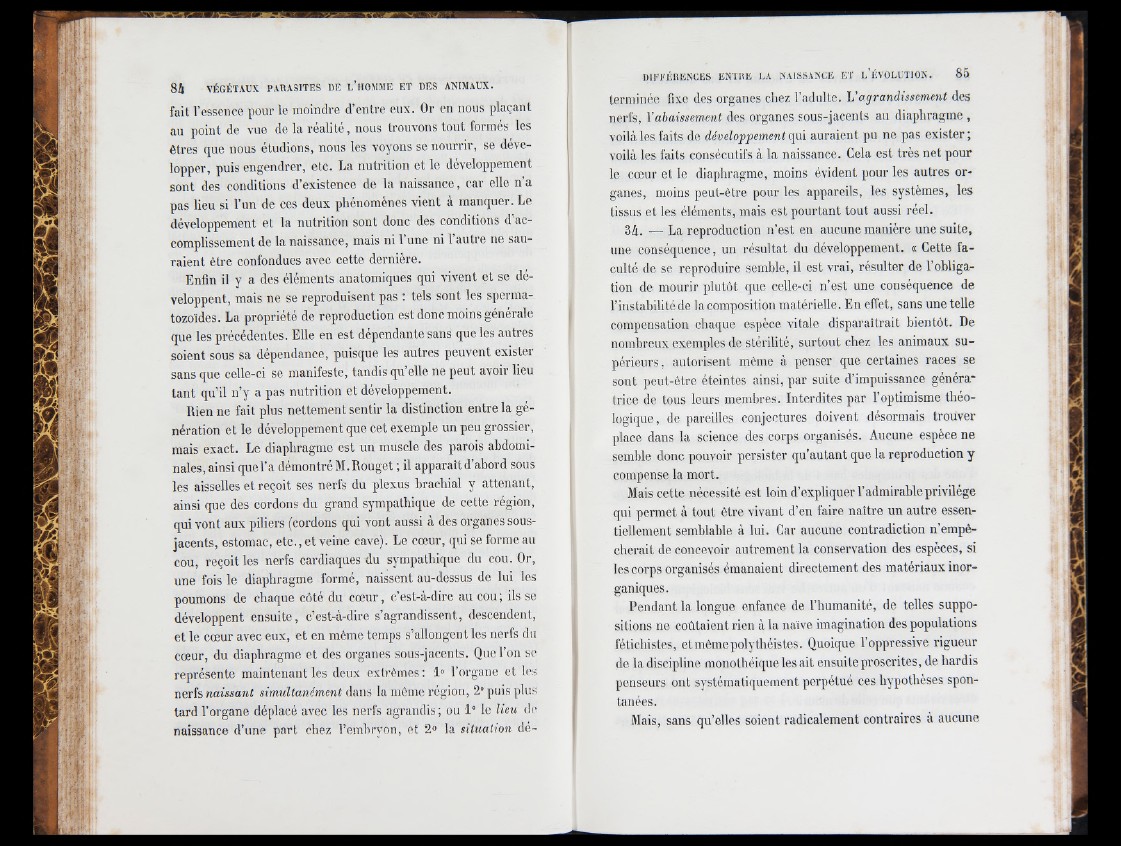
I
fait l’esseiice pour le moindre d’entre eux. Or en nous plaçant
au point de vue de la réa lité , nous trouvons tout formés les
êtres que nous étudions, nous les voyons se nourrir, se développer,
puis engendrer, etc. La nutrition et le développement
sont des conditions d’existence de la naissanc e, car elle n ’a
pas lieu si l’un de ces deux phénomènes vient à manquer. Le
développement et la nutrition sont donc des conditions d’accomplissement
de la naissance, mais ni l’une ni l’autre ne saura
ien t être confondues avec cette dernière.
Enfin il y a des éléments anatomiques qui vivent et se développent,
mais ne se reproduisent pas : tels sont les spermatozoïdes.
La propriété de reproduction est donc moins générale
que les précédentes. Elle en est dépendante sans que les autres
soient sous sa dépendance, puisque les autres peuvent exister
sans que celle-ci se manifeste, tandis q u e lle ne peut avoir lieu
ta n t qu’il n’y a pas nutrition et développement.
Rien ne fait plus nettement sentir la distinction entre la génération
et le développement que cet exemple un peu grossier,
mais exact. Le diaphragme est un muscle des parois abdominales,
ainsi q u e l’a démontré BI. Rouget ; il apparaît d’abord sous
les aisselles et reçoit ses nerfs du plexus brachial y attenant,
ainsi que des cordons du grand sympathique de cette région,
qui vont aux piliers (cordons qui vont aussi à des organes sous-
jacents, estomac, etc., e t veine cave). Le coeur, qui se forme au
cou, reçoit les nerfs cardiaques du sympathique du cou. Or,
une fois le diaphragme formé, naissent au-dessus de lui les
poumons de cbaque côté du coe u r, c’est-à-dire au cou ; ils se
développent ensuite , c’est-à-dire s’agrandissent, descendent,
et le coeur avec eux, et en même temps s’allongent les nerfs du
coeur, du diaphragme et des organes sous-jacents. Que l’on sc
représente maintenant les deux extrêmes : 1° l’organe ct les
n e r k naissant simultanément dans la même région, 2“ puis plus
lard l’organe déplacé avec les nerfs agrandis; ou 1“ le lieu de
naissance d’une p a rt cbez l’embryon, et 2« la situation dé-
DIFE ÉUENCE S EN TR E LA NAISSANCE ET l 'É V O L F T T O N . 85
terminée fixe des organes cbez l’adulte. L ’agrandissement des
nerfs, Vabaissement des organes sous-jacents au diaphragme ,
voilà les faits de développement qui auraient pu ne pas exister ;
voilà les faits consécutifs à la naissance. Cela est très n e t pour
le coeur et le diaphragme, moins évident pour les autres o rganes,
moins peut-être pour les appareils, les systèmes, les
tissus et les éléments, mais est pourtant tout aussi réel.
34. — La reproduction n ’est en aucune manière une suite,
une conséquence, un résultat du développement. « Cette fa culté
de se reproduire semble, il est vrai, résulter de l’obligation
de mourir plutôt que celle-ci n ’est une conséquence de
l’instabilité de la composition matérielle. En effet, sans une telle
compensation chaque espèce vitale disparaîtrait bientôt. De
nombreux exemples de stérilité, surtout chez les animaux supérieurs,
autorisent même à penser que certaines races se
sont peut-être éteintes ainsi, par suite d’impuissance génératrice
de tous leurs membres. Interdites par l’optimisme théologique,
de pareilles conjectures doivent désormais trouver
place dans la science des corps organisés. Aucune espèce ne
semble donc pouvoir persister qu’au tan t que la reproduction y
compense la mort.
Biais cette nécessité est loin d’expliquer l’admirable privilège
qui permet à tout être vivant d’en faire n aître un autre essentiellement
semblable à lui. Car aucune contradiction n ’empêcherait
de concevoir autrement la conservation des espèces, si
les corps organisés émanaient directement des matériaux inorganiques.
Pendant la longue enfance de l’humanité, de telles suppositions
ne coûtaient rien à la naïve imagination des populations
féticbistes, et même polythéistes. Quoique l ’oppressive rigueur
de la discipline monolbéiquelesait ensuite proscrites, de hardis
penseurs ont systématiquement perpétué ces hypothèses spontanées.
Biais, sans qu’elles soient radicalement contraires à aucune.
i