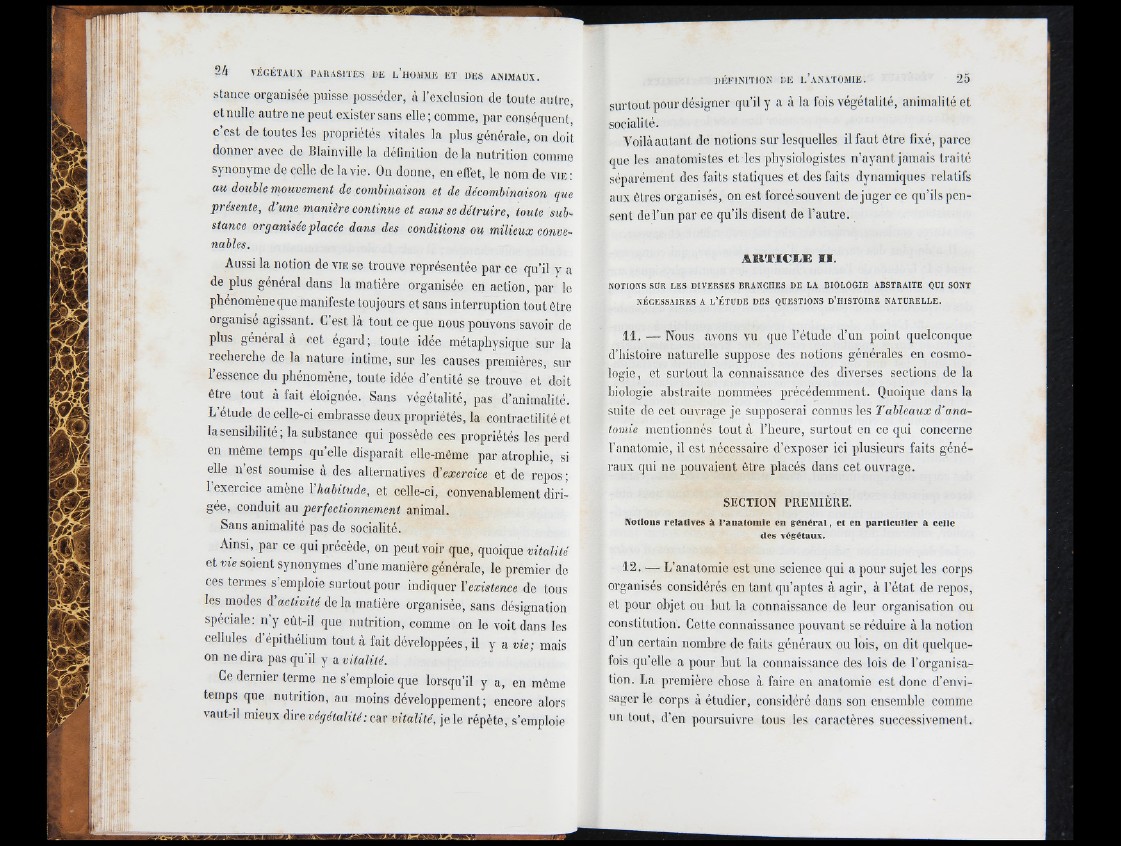
■ !
,i • il
l i '' 'i
! ; : T è li
fi': -j in
» .ìSS
2/1 VÉGÉTAUX PARASITES DE l ’hoMME ET DES ANIMAUX.
stance organisée puisse posséder, à l’exclusion de toute autre,
et nulle autre ne peut exister sans elle; comme, par conséquent,
c est de toutes les propriétés vitales la plus générale, on doit
donner avec de Blainville la déünition d e là nutrition comme
synonyme de celle de la vie. On donne, en elTet, le nom de vie :
au double mouvement de combinaison et de décombinaison que
présente, d ’une manière continue et sans se détruire, toute substance
organisée placée dans des conditions ou milieux convenables.
Aussi la notion de vie se trouve représentée par ce qu’il y a
de plus général dans la matière organisée en action, par le
phénomèneque manifeste toujours et sans interruption tout être
oiganise agissant. C est la tout ce que nous pouvons savoir de
plus général à cet égard; toute idée métaphysique sur la
recherche de la nature intime, sur les causes premières, sur
1 essence du phénomène, toute idée d’entité se trouve et doit
être tout à fait éloignée. Sans végétalité, pas d’animalité.
L’étude de celle-ci embrasse deux propriétés, la contractilité et
la sensibilité; la substance qui possède ces propriétés les perd
en même temps qu’elle disparaît elle-même par atrophie, si
elle n est soumise a des alternatives à’exercice et de repos ;
1 exercice amène Vhabitude, et celle-ci, convenablement dirigée,
conduit au perfectionnement animal.
Sans animalité pas de socialité.
Ainsi, par ce qui précède, on peut voir que, quoique vitalité
et vie soient synonymes d’une manière générale, le premier do
ces termes s’emploie surtout pour indiquer Y existence de tous
les modes d ac/fni/e de la matière organisée, sans désignation
speciale: n ’y eùt-d que nutrition, comme on le voit dans les
cellules d’épithélium tout à fait développées, il y a vie; mais
on ne dira pas qu'il y a vitalité.
Ce dernier terme ne s’emploie que lorsqu’il y a, en môme
temps que nutrition, au moins développement; encore alors
vaut-il mieux dwa végétalité: car vitalité, je le répète, s’emploie
d é f i n i t i o n d e e ’a x a t ü m i e . 25
surtout pour désigner qu’il y a à la fois végétalité, animalité et
socialité.
"Voilà autant de notions sur lesquelles il faut être fixé, parce
que les anatomistes et les physiologistes n ’ayant jamais traité
séparément des faits statiques et des faits dynamiques relatifs
aux êlres organisés, on est forcé souvent d é ju g e r ce qu’ils pensent
d e l’un par ce qu’ils disent de l ’autre.
n o t i o n s s ü r l e s d i v e r s e s b r a n c h e s d e l a b i o l o g i e a b s t r a i t e o d i s o n t
n é c e s s a i r e s a l ’é t u d e d e s q u e s t i o n s d ’h i s t o i r e n a t u r e l l e .
11. — Nous avons vu que l’étude d’un point quelconque
d’histoire naturelle suppose des notions générales en cosmologie
, et surtout la connaissance des diverses sections de la
biologie abstraite nommées précédemment. Quoique dans la
suite de cet ouvrage je supposerai connus les Tableaux d’anatomie
mentionnés tout à l’heure, surtout en ce qui concerne
l’anatomie, il est nécessaire d’exposer ici plusieurs faits généraux
qui ne pouvaient être placés dans cet ouvrage.
SECTION PREMIERE.
IVolious relatives à l’anatoinle en g é n é r a l, et en p a rticu lie r à celle
des végétaux.
12. — L’anatomie est une science qui a pour sujet les corps
organisés considérés en tant qu’aptes à agir, à l’é ta t de repos,
et pour objet ou but la connaissance de leur organisation ou
constitution. Cette connaissance pouvant se réduire à la notion
d’un certain nombre de faits généraux ou lois, on dit quelquefois
qu’elle a pour b u t la connaissance des lois de l’organisation.
La première chose à faire en anatomie est donc d’envisager
le corps à étudier, considéré dans son ensemble comme
un tout, d’en poursuivre tous les caractères successivement.
m m Ê O i H