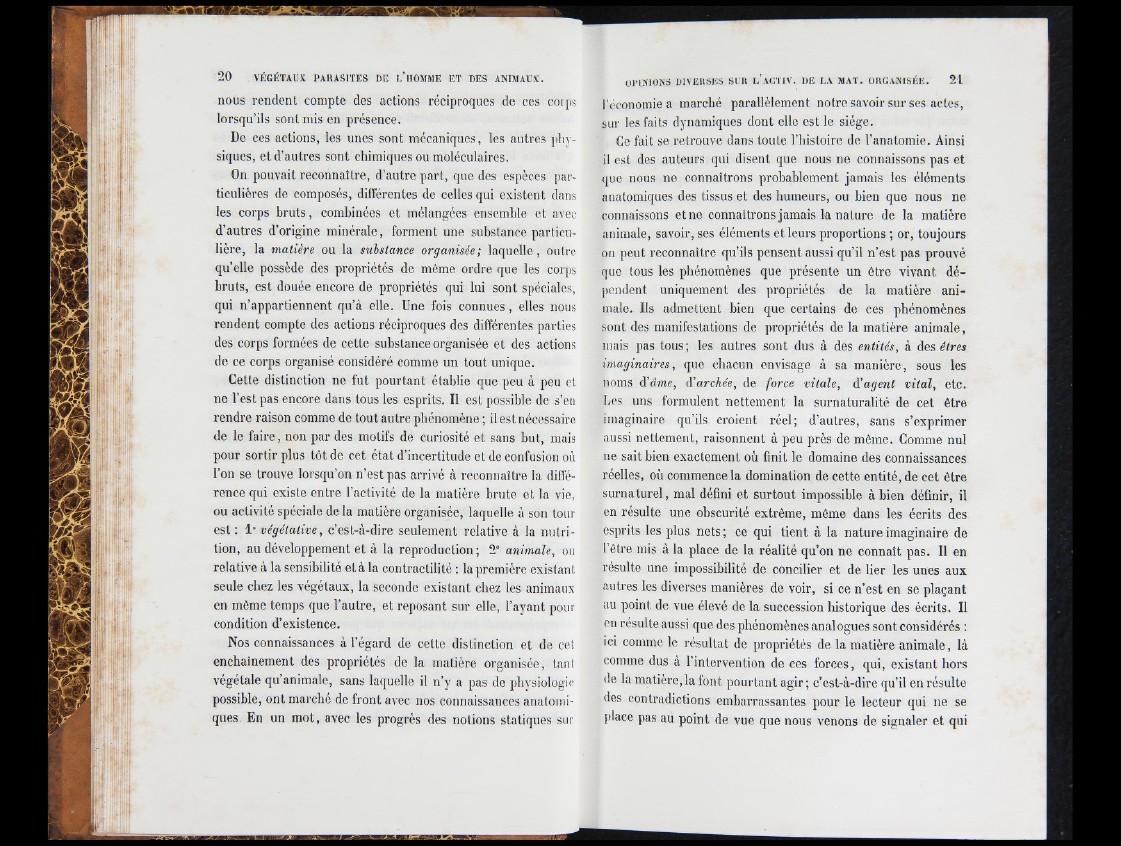
1 :M
I II,-.;
I II 'Il
I l '¡t '
W ' -
nous rendent compte des actions réciproques de ces corps
lorsqu’ils sont mis en présence.
De ces actions, les unes sont mécaniques, les autres pliT-
siques, et d’autres sont chimiques ou moléculaires.
On pouvait reconnaître, d’autre part, que des espèces particulières
de composés, différentes de celles qui existent dans
les corps b ru ts , combinées et mélangées ensemble et avec
d’autres d’origine minérale, forment une substance particulière,
la matière ou la substance organisée; laquelle, outre
qu’elle possède des propriétés de même ordre que les corps
bruts, est douée encore de propriétés qui lui sont spéciales,
qui n ’appartiennent qu’à elle. Une fois co n n u e s, elles nous
ren d en t compte des actions réciproques des différentes parties
des corps formées de cette substance organisée et des actions
de ce corps organisé considéré comme un tout unique.
Cette distinction ne fut pourtant établie que peu à peu et
ne l’est pas encore dans tous les esprits. Il est possible de s’en
rendre raison comme de tout autre phénomène ; il est nécessaire
de le faire, non par des motifs de curiosité et sans but, mais
pour sortir plus tôt de cet é ta t d’incertitude et de confusion où
l’on se trouve lorsqu’on n ’est pas arrivé à reconnaître la différence
qui existe entre l’activité de la matière brute et la vie,
ou activité spéciale d e là matière organisée, laquelle à son tour
e s t: 1° végétative, c’est-à-dire seulement relative à la n u trition,
au développement et à la reproduction; 2“ animale, ou
relative à la sensibilité et à la contractilité : la première existant
seule chez les végétaux, la seconde existant chez les animaux
en même temps que l’autre, et reposant sur elle, l’ayant pom
condition d’existence.
Nos connaissances à l’égard de cette distinction et de cet
enchaînement des propriétés de la matière organisée, tant
végétale qu’animale, sans laquelle il n ’y a pas de physiologie
possible, ont marché de front avec nos connaissances anatomiques.
En un mot, avec les progrès des notions statiques sur
l’économie a marché parallèlement notre savoir sur ses actes,
sur les faits dynamiques dont elle est le siège.
Ce fait se retrouve dans toute l’histoire de l’anatomie. Ainsi
il est des auteurs qui disent que nous ne connaissons pas et
que nous ne connaîtrons probablement jamais les éléments
anatomiques des tissus et des humeurs, ou bien que nous ne
connaissons e tn e connaîtrons jamais la nature de la matière
animale, savoir, ses éléments et leurs proportions ; or, toujours
on peut reconnaître qu’ils pensent aussi qu’il n ’est pas prouvé
que tous les phénomènes que présente un être vivant dé-
jiendent uniquement des propriétés de la matière animale.
Us admettent bien que certains de ces phénomènes
sont des manifestations de propriétés de la matière animale,
mais pas tous; les autres sont dus à des entités, à des êtres
imaginaires, que chacun envisage à sa manière, sous les
noms d’âme, d’archée, de force vitale, g a g en t v ita l, etc.
Les uns formulent nettem ent la surnatura lité de cet être
imaginaire qu’ils croient réel; d’autres, sans s’exprimer
aussi nettement, raisonnent à peu près de même. Comme nul
ne sait bien exactement où finit le domaine des connaissances
réelles, où commence la domination de cette entité, de cet être
su rn a tu re l, mal défini e t surtout impossible à bien définir, il
en résulte une obscurité extrême, même dans les écrits des
esprits les plus n e ts; ce qui tient à la n a tu re imaginaire de
fê tre mis à la place de la réalité qu’on ne connaît pas. Il en
résulte une impossibilité de concilier et de lier les unes aux
autres les diverses manières de voir, si ce n ’est en se plaçant
au point de vue élevé de la succession historique des écrits. Il
en résulte aussi que des phénomènes analogues sont considérés :
ici comme le résultat de propriétés de la matière an im ale, là
comme dus à l’intervention de ces forces, qui, existant hors
de la matière, la font pourtant agir ; c’est-à-dire qu’il en résulte
des contradictions embarrassantes pour le lecteur qui ne se
place pas au point de vue que nous venons de signaler et qui