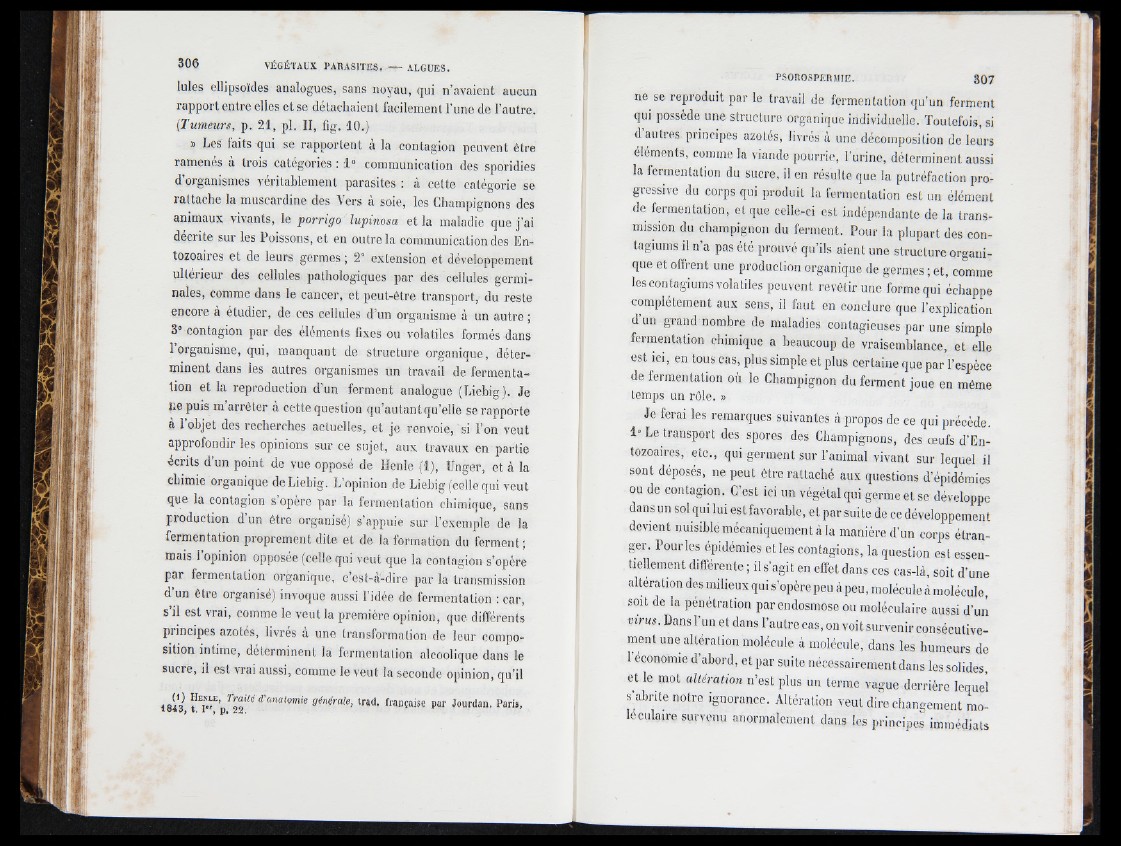
j tin
Ík-'1i . JV '
*1
LÎ
: ii:
lules ellipsoïdes analogues, sans uoyau, qui n ’avaient aucun
rapport entre elles et se détachaient facilement l’une de l’autre.
(Tumetirs, p. 21, pl. 11, fig. 10.)
» Les faits qui se rapportent à la contagion peuvent être
ramenés à trois catégories ; 1» communication des sporidies
d’organismes véritahlemeut parasites : à cette catégorie se
rattache la muscardine des Vers à soie, les Champignons des
animaux vivants, le porrigo lupinosa et la maladie que j ’ai
décrite sur les Poissons, e t en outre la communication des Entozoaires
et de leurs germes ; 2 “ extension et développement
ultérieur des cellules pathologiques par des cellules germinales,
comme dans le cancer, et peut-être transport, du reste
encore à étudier, de ces cellules d ’un organisme à un autre ;
3° contagion par des éléments fixes ou volatiles formés dans
¡organisme, qui, manquant de structure organique, déterminent
dans les autres organismes un travail de fermentation
et la reproduction d ’un ferment analogue (Liebig). Je
J.e puis m arrête r a cette question qu’au ta n tq u ’elle se rapporte
à l’objet des recherches actuelles, et je renvoie, si Fou veut
approfondir les opinions sur ce sujet, aux travaux en partie
écrits d’un point de vue opposé de líenle (1), ÎJnger, et à la
chimie organique de Liebig. L’opinion de Liebig (celle qui veut
que la contagion s’opère par la fermentation chimique, sans
production d’un être organisé) s’appuie sur l’exemple de la
fermentation proprement dite et de la formation du ferment;
mais l’opinion opposée (celle qui veut que la contagion s’opère
par fermentation organique, c’est-à-dire par la transmission
d ’un être organisé) invoque aussi l’idée de fermentation : car,
s il est vrai, comme le veut la première opinion, que différents
principes azotés, livres a une transformation de leur composition
intime, déterminent la fermentation alcoolique dans le
sucre, il est vrai aussi, comme le veut la seconde opinion, qu’il
18« , ^ SieViifrate, trad. française par Jourdan. Paris,
ne se reproduit par le travail de fermentation qu’un ferment
qui possède une slrueture organique individuelle. Toutefois, si
d autres principes azolés, livrés à une décomposition de leurs
éléments, comme la viande pourrie, l’urine, déterminent aussi
la fermentation du sucre, il en résulte que la putréfaction progressive
du corps qui produit la fermentation est uu élément
de fermenlation, et que celle-ci est indépendante de la tran smission
du champignon du ferment. Pour la plupart des con-
tagiurns il n a pas été prouvé qu’ils aient une struclure organique
et ofirent une production organique de germes ; et, comme
lescontagiumsvolatiies peuvent revêtir une forme qui échappe
complètement aux sens, il faut en conclure que l’explication
d’un grand nombre de maladies contagieuses par une simple
fermentation chimique a beaucoup de vraisemblance, e t elle
est ici, en tous cas, plus simple et plus certaine que par l’espèce
de fermentation où le Champignon du ferment joue en même
temps un rôle. »
Je ferai les remarques suivantes à propos de ce qui précède.
1“ Le transport des spores des Champignons, des oeufs d’En-
tozoaires, etc., qui germent sur l’animal vivant sur lequel il
sont déposés, ne peut être rattaché aux questions d'épidémies
ou de contagion. C’est ici un végétal qui germe et se développe
dans un sol qui lui est favorable, et par suite de ce développement
devient nuisible mécaniquement à la manière d’un corps é tran ger.
Pourles épidémies et les contagions, la question est essentiellement
différente ; il s’agit en effet dans ces cas-là, soit d ’une
alteration des milieux qui s’opère peu à peu, molécule à molécule,
soit de la pénétration par endosmose ou moléculaire aussi d ’un
virus. Dans l’un et dans l’autre cas, on voit survenir consécutivement
une altéraliou molécule à molécule, dans les humeurs de
1 économie d’ahord, et par suite nécessairement dans les solides
et le mot altération n ’est plus uu terme vague derrière lequel
s abrite noire ignorance. Altération veut dire changement moléculaire
survenu anormalement dans le.s principes immédiats
i