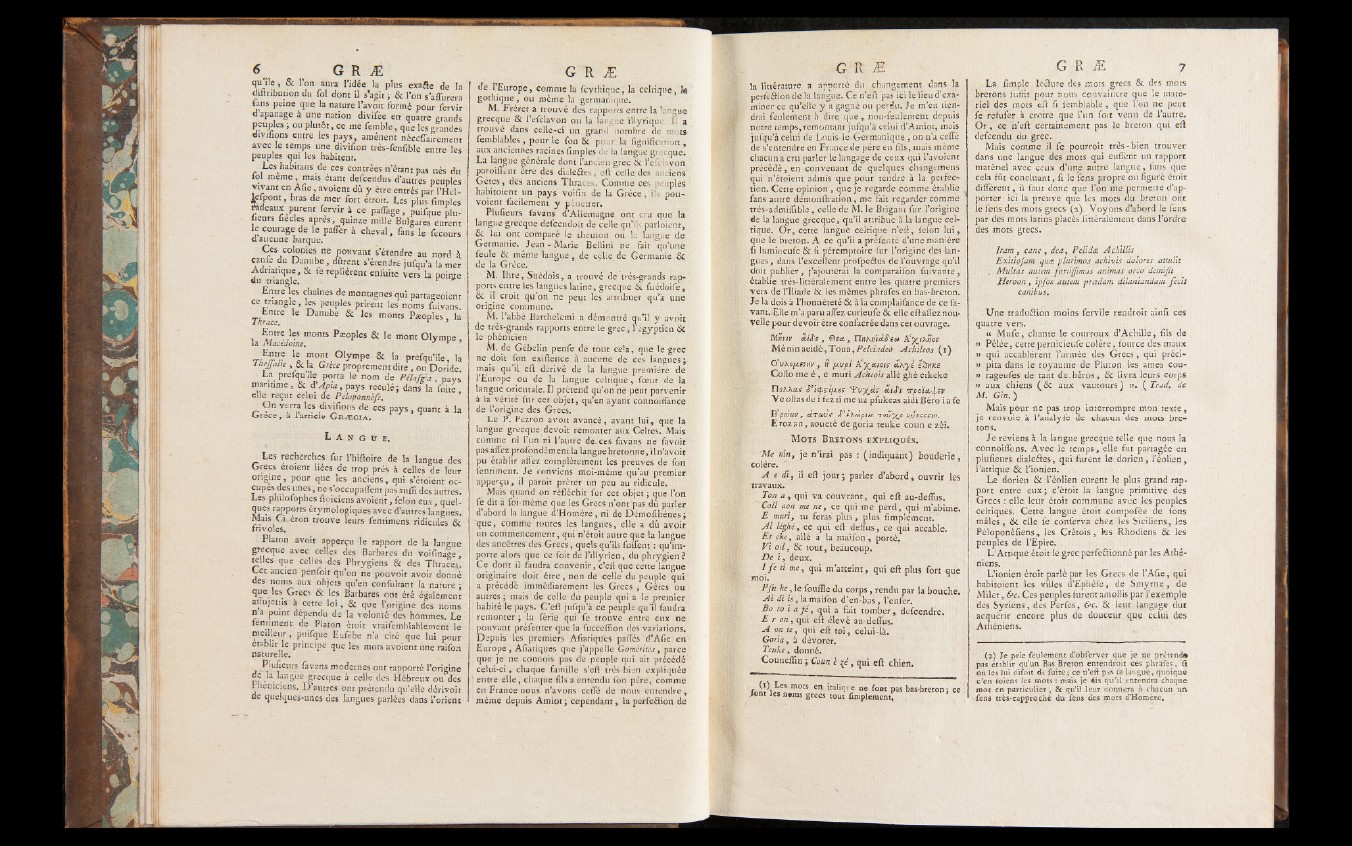
6 G R Æ qu'île, & l’on aura l’idée la plus exafle de la
diflribution du fol dont U s’agit ; & l’on s’affurera
fans peine que la nature l’avoit formé pour fervir
d’apanage à une nation divifèe en quatre grands
peuples ; ou plutôt, ce me fomble, que les grandes
oiyifions entre les pays, amènent nécefi’airement
avec le temps une divifton très-fenfible entre les
peuples qui les habitent.
Lesjiabitans de ces contrées n’étant pas nés du
loi meme, mais étant defoendus d’autres peuples
vivant en A fie , avoient dû y être entrés par l’Hel-
Jefpont, bras de mer fort étroit. Les plus Amples
radeaux purent fervir à ce paffage, puifque plu-
fieurs fiecles apres, quinze mille Bulgares eurent
le courage de le paffer à cheval, fans le fecours
daucune barque.
Ces colonies ne pouvant s’étendre au nord à
calife du Danube, durent s’étendre jufou’à la mer
Adriatique, & fo replièrent enfuite vers la poime
au triangle. r ~ '
Entre les chaînes de montagnes qui partageoient
ce triangle, les peuples prirent les noms fuivans.
T fom ? 6 Dsuube & les monts Pæoples, la
Entre les monts Pæoples & le mont O lym p e ,
la Macedoine. J r
W m “ »P1 , Olympe & la prefqu’île, la
Thejfalie & la Grèce proprement dite , ou Doride.
La preiqu île porta le nom de Pélafeia, pays
Pjaritime, & d'Apia, pays reculé; dans la fuite,
elle reçut celui de Péloponnèfe. -
On verra les divifions de ces pay s , quant à la
Grece, a 1 article G r æ c ia .
L a n g u e .
Les recherches fur l’hiftoire de la langue des
Grecs etoient liées de trop près à celtes de leur
origine, pour que les anciens, qui s’étoient oc-
cupes destines, nes’occupaffent pas aufli des autres.
Les philofophes ftoïciens avoient, félon eux, quel-
ques rapports étymologiques avec d’autres langues.
Mais CLéron trouve leurs fentimens ridicules &
frivoles.
Platon a voit apperçu le rapport de la langue
grecque avec celles des Barbares du voisinage
telles que celles des Phrygiens & des Thrace^
Cet ancien penfoit qu’on ne pouvoit avoir donné
des noms aux objets qu'en confultant la nature ;
^ e. . ,recs & Ks E g a r é s ont été également
aliujettis à cette lo i , & que l’origine des noms
n a point dépendu de la volonté des hommes. Le
fentiment de Platon étoit vraifemblablement le
meilleur, puifque Eufèbe n’a cité que lui pour
établir le principe que les mots avoient une raifon
naturelle.
, .^.V^eur. S oe modernes ont rapporté l’origine
de la langue grecque à celle des Hébreux ou des
Phéniciens. D ’autres ont prétendu qu’elle dérivoit
de quelques-unes des langues parlées dans l’orient
G R Æ
de l’Europe, comme la fcy thique', la celtique, J«t
gothique, ou même la germanique.
M. Fréret a trouvé des rapports entre la langue
grecque & l’efclavon ou la langue illyrique. Il a
trouve dans celle-ci un. grand nombre de mots
femblabies , pour le fon & pour la lignification ,
aux anciennes racines fimples de la langue grecque.
La langue générale dont l’ancien grec & l’efclavon
paroiffent être des dialeôes, eft celle des anciens
Gètes, des anciens Thraces* Comme ces peuples
habitoient un pays voifin de la Grèce, ils pou*',
voient facilement y pénétrer.
Plufieurs favaus d’Allemagne ont cru que la
langue grecque defcendoit de celle qu’ils partaient,
8c lui ont comparé le theiiton ou la langue de
Germanie. Jean - Marie Bellini ne fait qu’une
feule 8c même langue, de celle de Germanie Sc
de la Grèce.
M. Ihre, Suédois, a trouvé de très-grands rapports
entre les langues latine, grecque 8c fuédoife ,
8c il croit qu’on ne peut les attribuer qu’à une
origine commune.
M. l’abbé Barthelemi a démontré qu’il y avoit
de très-grands rapports entre le grec, l'égyptien 8c
le phénicien.
M. de Gébelin penfe de tout cela, que le grec
ne doit fon exiftence à aucune de ces langues ;
mais qu’il eft dérivé de la . langue première de
l’Europe ou de la langue celtique, foeur de la
langue orientale. Il prétend qu’on ne peut parvenir
à la vérité fur cer objet, qu’en ayant connoiffance
de l’origine des Grecs.
Le P. Pezron avoit avancé, avant lui, que la
langue grecque devoit remonter aux Celtes. Mais
comme ni l’un ni l’autre de..ces favans ne favoit
pas affez profondément la langue bretonne, il n’avoit
pu établir allez complètement les preuves de fon
fentiment. Je conviens moi-même qu’au premier
apperçu, il paroit prêter un peu au ridicule.
Mais quand on réfléchit fur cet objet ; que l’on
fe dit à foi-même que les Grecs n’ont'pas dû parler
d’abord la langue d’Homèrè, ni de Démofthènes ;
que, comme toutes les langues, elle a dû avoir
un commencement, qui n’étoit autre que la langue
des ancêtres des Grecs, quels qu’ils fanent : qu’importe
alors que ce foit de l’illyrien, du phrygien?
Ce dont il faudra convenir, c’eft que cette langue
originaire doit ê tre, non de celle du peuple qui
a précédé immédiatement les Grecs , Gètes ou
autres ; mais de celle du peuple qui a le premier
habite le pays. C ’eft jufqu’à ce peuple qu’il faudra
remonter ; la férié qui fe trouve entre eux ne
pouvant préfenter que la fucceflion des variations.
Depuis les premiers Afiariqifes paftés d’Afte en
Europe, Afiatiques que j’appelle Gomérites, parce
que je ne connois pas de peuple qui ait précédé
celui-ci, chaque famille s’eft très-bien expliquée
' entre elle, chaque fils a entendu fon père, comme
en France nous n’avons cefle de nous entendre,
même depuis Amiot; cependant, laperfeêUon de
G R Æ
la littérature a apporté du changement dans la
perfe&ion delà langue. Ce n’eft pas ici le lieu d’examiner
ce qu’elle y a gagné ou perdu. Je m’en tiendrai
feulement à dire que, non-feulement depuis
notre temps, remontant jufqu’à celui d’Amiot, mais
jufqu’à celui de Louis-le-Germanique , on n’a cefle
de s’entendre en France de père en fils, mais même
chacun a cru parler le langage de ceux qui l’avoient
précédé, en convenant de quelques changemens
qui n’étoient admis que pour tendre à la perfection.
Cette opinion , que je regarde comme établie
fans autre démonftration, me fait regarder comme
très-admiflible, celle de M. le Brigant fur l’origine
de la langue grecque, qu’il attribue à la langue celtique.
O r , cette langue celtique n’eft, félon lui,
que le breton. A ce qù’ii a préfenté d’une manière
fi lumineufe & fi péremptoire fur l’origine desdan-
gues, dans l’excellent profpeéfas de l'ouvrage qu’il
doit publier, j’ajouterai la comparaifon fuivante,
établie très-littéralement entre les quatre premiers
vers de l’Iliade & les mêmes phrafes en bas-breton.
Je la dois à l’honnêteté & à la complaifance de ce fa-
vant..Elle m’a paru affez curieufe & elle eft affez nouvelle
pour devoir être confacrée dans cet ouvrage.
Milpiv a.tS'e , ©gct, riiihmciS'sa k'^ikrjoç
Mé nin aeidé, Toua, Peleïadeô Achileos ( i )
O'vhop.evnv, M pvpi A'xcuoiç ct\yé sSme
Collo me è , e mûri Acheois allé ghé etkeke
Wqkkcls u.ïJ'i irpoïcL^ev
Ve ollas de i fez ti me uz pfukeas aidi Béro i a fe
H pctiav, ctTtÿvç S^sKaptA tsî‘ï'/js Hvveççiv.
Erozan, aoueté de goria teuke coun e zéi.
M o t s B r e t o n s e x p l iq u é s .
'Me nin, je n’irai pas : (indiquant) bouderie,
colère.
A e di, il eft jour; parler d'abord, ouvrir les
travaux.
Ton a , qui va couvrant, qui eft au-deffus.
to ll a on me ne, ce qui me perd, qui m’abîme.
E mûri, tu feras plus, plus Amplement.
A l lèghé, ce qui eft deffus, ce qui accable.
Et éke, allé à la maifon , portée
Vi otl, & tout, beaucoup.
De i , deux.
I f e ù me, qui m’atteint, qui eft plus fort que
moi.
Pfu ke, le fouffle du corps, rendu par la bouche.
A i di is , la maifon d’en-bas , l’enfer.
Bo ro i a fé , qui a fait tomber, defcendre.
E r on, qui eft élevé au-deffus.
A on te, qui eft toi, celui-là,
Goria, à dévorer.
Teuke, donné.
Couneflin ; Coun è , qui eft chien.
f«nr i« « motS en lta,icil ® ne font pas bas-breton; i jont les ntms grecs tout finalement.
La fimple M u r e des mors grecs & d?s mots
bretons fuftir pour nous convaincre que le matériel
des mots eft fi femblable , que l’on ne peut
fe refufer à croire que i’un foit verni de l’autre.
O r , ce n’eft certainement pas le breton qui eft
defcendu du grec.
Mais comme il fe pourroit très-bien trouver
dans une langue des mots qui euffent un rapport
matériel avec ceux d’une autre langue, fans que
cela fût concluant, fi le fens propre ou figuré étoit
différent, il faut donc que l’on me permette d’apporter
ici la preuve que les mots du breton ont
le fens des mots grecs (a). Voyons d’abord le fens
par des mots latins placés littéralement dans l’ordre
des mots grecs.
lram , cane , dea, Pelidcz Achillis
Exitiofam quct plurimos achivis dolores attulh
I Multas autem fortijjimas animas orco demijit
Heroon, ipfos autem proedam dilaniandarn fecit
canfbus.
Une tradu&ion moins fervile rendroit ainfi ce-s
quatre vers.
« Mufe, chante le courroux d’Achille, fils de
» Pélée, cette pernicieufe colère, fource des maux
» qui accablèrent l’armée des Grecs, qui préci-
» pita dans le royaume de Pluton les.âmes cou-
» rageufes de tant de^héros, & livra leurs corps
» aux chiens ( & aux vautours ) ?>. ( Trad. de
M. Gin.)
Mais pour ne pas trop interrompre mon texte,
je renvoie à l’analyfe de chacun des mots bretons.
Je reviens à la langue grecque telle que nous la
connoiffons. Avec le temps , elle fut partagée en
plufieurs diale&es, qui furent le dorien, l’éolien,
l ’attique & l’ionien.
Le dorien & l’éolien eurent le plus grand rapport
entre eux; c’étoit la langue primitive des
Grecs : elle leur étoit commune avec les peuples
celtiques. Cette langue étoit compofée de fons
mâles, & elle fe conferva chez les Siciliens, les
Péloponéfiens, les Crétois, les Rhodiens & les
peuples de l’Epire.
L ’Attique étoit le grec perfeftionné par les Athéniens.
L’ionien étoit parlé par les Grecs de l’Afie , qui
habitoient les villes d’Ephèfe » de Smyrne , de
Milet , &c. Ces peuples furent amollis par l’exemple
des Syriens, des Perfes, &c. & leur langage dut
acquérir encore plus de douçeur que celui des
Athéniens.
(a) Je prie feulement d’observer que je ue prétend»
pas établir qu’un Bas Breton entendroit ces phrafes, Û
on les lui diloit de fuite; ce n’eft pas la langue, quoique
c ’en Soient les mots : mais je dis qu’il entendra chaque
mot en particulier, & qu’il leur donnera à chacun un
fens très-rapproché du fens des mots d’Homère.