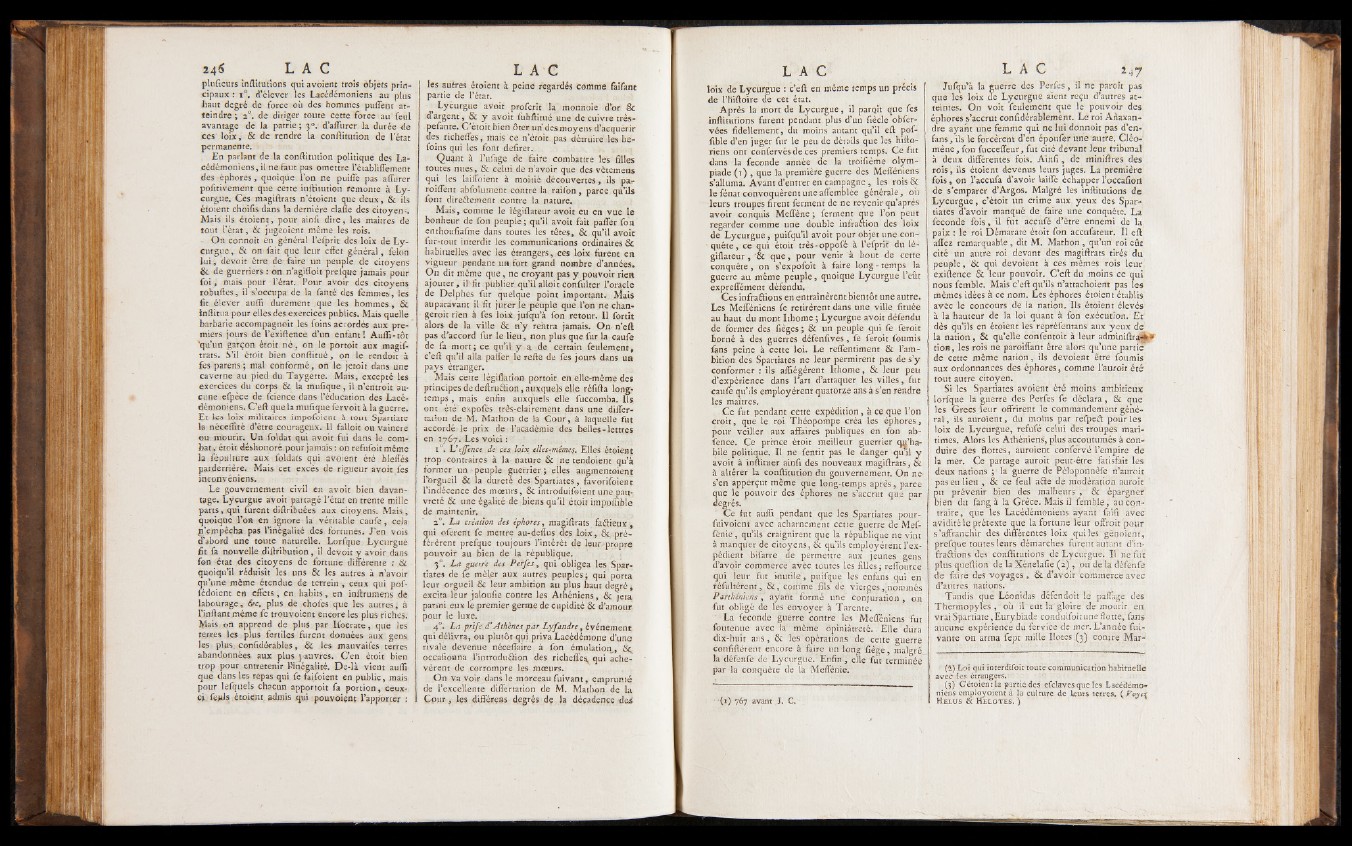
plufieurs inftitutions qui avoient trois Objets principaux
: i°. d’élever les Lacédémoniens au plus
haut degré de force où des hommes puffent atteindre
; 2°. de diriger toute cette force au feul
avantage de la patrie; 30. d’aflùrer la durée <le
ces' loix, & de rendre la conftitution de l ’état
permanente.
En parlant de la conftitution politique des Lacédémoniens,
il ne faut pas omettre Fétabliffement
des éphores, quoique l’on ne puiffe pas affurer
pofitivement que cette inftitution remonte à L y curgue.
Ces magiftrats n’étoient que deux, & ils
étaient choifis dans la dernière clafîe des citoyens
Mais ils étoient, pour ainfl dire, les maîtres de
tout Fçtat, & jugeoient même les rois.
On connoît en général Fefprit des loix de L y curgue,
& on fait que leur effet général, félon
lu i, devoit être de faire un peuple de citoyens
& de guerriers : on n’agiffoit prefque jamais pour
f o i , mais pour l’état. Pour avoir des citoyens
robuftes, il s’occupa de la fanté des femmes, les
fit élever aufli durement que les hommes , &
inftitua pour elles des exercices publics. Mais quelle
barbarie aecompagnoit les foins accordés aux premiers
jours de l’exiftence d’un enfant! Aufli-tôt
'qu’un garçon étoit, né;, on le portoit aux magiftrats.
S’il était bien conflitué, on le rendoit à
fes parens ; mal conformé , on le jetoit dans une
caverne au pied du Taygette. Mais, excepté les
exercices du corps & la mufique, il n’entroit aucune
efpèce de fcience dans l’éducation des Lacédémoniens.
C ’eft que la mufique fervoit à la guerre.
Et les loix militaires impofoient à tout Spartiate
la néceffité d’être courageux. 11 falloit ou vaincre
ou mourir. Un foldat qui avoit fui dans le combat,
était déshonoré,pour jamais : on refufoit même
la fépultùre aux foldats qui avoient é té . bleffés
patderriêre.. Mais cet excès de rigueur avoit fes
ineonvéniens.
Le gouvernement civil en avoit bien davantage.
Lycurgue avoit partagé l’état en trente mille
parts,.qui furent diftribuées aux citoyens. Mais,
quoique l’on en .ignore la véritable caufe, cela
g ’empêcha pas l’inégalité des fortunes. J’en vois
d’abord une toute naturelle. Lorfque Lycurgue
fit fa nouvelle difiribution , il devoit y avoir dans
fon état des citoyens de fortune différente ; &
quoiqu’il réduisît les uns & les autres à n’avoir
qu’une même étendue de terrein , ceux qui pof-
lédoient en effets, en habits, en inffrumens de
labourage, plus de chofes que les autres; à
Finftant même fe trouvoient encore les plus riches.
Mais on apprend de plus par Ifocrate, que les
te/.res le s . plus fertiles furent données aux gens,
les plus, confidérables, & les mauvaifes terres
abandonnées aux plus pauvres. C ’en était bien
trop pour entretenir Pinégalité. De-là vient aufli
que dans les rèpas qui fe faifoient en public, mais
pour lefquels chacun apportoit fa portion, ceux-
ci feufs étaient admis qui pouvoiçnt l’apporter ;
les autres étoient à peine regardés comme faifant
partie de l’état.
y Lycurgue avoit profcrit la monnoie d’or &
d argent, & y avoit fubftitué une de cuivre très-
pefante. C ’etoitbien ôter un des moyens d’acquérir
des richefles, mais ce n’étoit pas détruire les be-
foins qui les font defirer.
Quant à l’ufage de faire combattre les filles
toutes nues, & celui de n’avoir que des vêtemens
qui les laiffoient à moitié découvertes, ils pa?
roiffent abfolument contre la raifon, parce qu’ils
font dire&ement contre la nature.
Mais, comme le légiflateur avoit eu en vue le
bonheur de fon peuple ; qu’il avoit fait paffer fon
enthoufiafme dans toutes les têtes, & qu’il avoit
fur -tout interdit les communications ordinaires &
habituelles avec les étrangers, ces loix furent en
t vigueur pendant am fort grand nombre d’années.
On dit même que, ne croyant pas y pouvoir rien
ajouter, if fit publier qu’il alloit confulter l’oracle
de Delphes fur quelque point important. Mais
auparavant il fit jurer le peuple que l’on ne chan-
geroit rien à fes loix jufqu’à fon retour. Il fortit
alors de la ville & n’y rentra jamais. On n’eflt
pas d’accord fur le lieu, non plus que fur la caufe
de fa mort; ce qu’i l y a de certain feulement,
c’eft qu’il alla paffer le refte de fes jours dans un
pays étranger.
Mais cette légiflation portoit en elle-même des
principes de deftruéiion, auxquels elle réfifta longtemps
, mais enfin auxquels elle fuccoinba. Ils
ont été expofés très-clairement dans une difler-
tation de M. Mathon de la Cour, à laquelle fut
accordé le prix de l’académie ; des belles - lettres
en 1767V Les voi.ci :
i°. Uejfence de ces. loix elles-méme^. Elles étoient
trop contraires à .la-nature & ne tendoient qu’à
former un 1 peuple guerrier ; elles augmentoient
Fbrgueil & la dureté des Spartiates, fevorifoient
l’indécence des moeurs, & introduifoient une pauvreté
& une égalité de biens qu’il étpit impofiible
de maintenir,
20. La création des éphores, magiftrats fa&ieux,
qui ofèrent fe mettre au-deflus des lo ix , & ^préférèrent
prefque toujours l’intérêt de leur-propre
pouvoir au bien de la république.
30. La pierr'e des Perfes, qui obligea les Spartiates
de fe mêfer aux autres peuples; qui porta
leur orgueil & leur ambition au plus haut degré;
excita leur jaloufie contre les Athéniens, & jeta
parmi eux le premier gernje de cupidité & d’amour
pour le luxe,
40. La prife d*Athènes par Lyfandre, événement
qui délivra, ou plutôt qui priva Lacédémone d’une
rivale devenue néceffaire à fon émulation,, &
occafionna l’introduéfion des richeffes qui achevèrent
de corrompre les tnoeurs.
On va voir dans le morceau fuivant, emprunté
de l’excellente differtation de M. Mathon de la
C ç u r , les diffèrçQs degrés dç la déçadçnpe des'
loix de Lycurgue : c’eft en même temps un précis
de l’hiftoire de cet état.
Après la mort de Lycurgue, il parQÎt que fes
inftiturions furent pendant plus d’un fiècle obfer-
vées fidellemenf, du moins autant qu’il eft pof-
fible d’en juger fur le peu de détails que les hifto-
riens ont confervés de ces premiers temps. Ce fut
dans la fécondé année de la troifième olympiade
( t ) , que la première guerre des Mefféniens
s’alluma. Avant d’entrer en campagne, les rois &
le fénat convoquèrent une aflemblée générale, où
leurs troupes firent ferment de ne reyenir qu’après
avoir conquis Meffène; ferment que l’on peut
regarder comme line double infraction des loix
de Lycurgue, puifqu’il avoit pour objet une conquête,
ce qui était très-oppofé à l’efprif du légiflateur
, & que, pour venir à bout de cette
conquête, on s’expofoit à faire long - temps la
guerre au même peuple, quoique Lycurgue l’eût
expreffément défendu.
Ces inffaétions en entraînèrent bientôt une autre.
Les Mefféniens fe retirèrent dans une ville fituée
au haut du mont Ithome ; Lycurgue avoit défendu
de former des fièges; & un peuple qui fe feroit
borné à des guerres défenfives, fe feroit fournis
fans peine à cette loi. Le reffentiment & l’ambition
des Spartiates ne leur permirent pas de s’y
conformer : ils afliégèrent Ithome, & leur peu
d’expérience dans l’art d’attaquer les villes, fut
caufe qu’ils employèrent quatorze ans à s’en rendre
les maîtres.
Ce fut pendant cette expédition, à ce que l’on
croit, que le roi Théopompe créa les éphores,
pour veiller aux affaires publiques en fon absence.
Ce prince étoit meilleur guerrier cm’ha-
bile politique. Il ne fentit pas le danger quil y
avoit à instituer ainfi des nouveaux magiftrats, &
à altérer la conftitution du gouvernement. On ne-
s’en apperçut même que long-temps après, parce
que le pouvoir des éphores ne s’accrut que par
degrés. ’
Ce fut aufli pendant que les Spartiates pour-
fuivoient avec acharnement cette guerre de Mef-
fénie, qu’ils craignirent que la république ne vînt
à manquer de citoyens, & qu’ils employèrent l’expédient
bifarre de permettre aux jeunes gens
d’avoir commerce avec toutes les filles ; reffource
qui leur fut inutile, puifque les enfans qui en
réfultèrent, & , comme fils de vierges ,:nommés
Parthénîens, ayant formé une conjuration , on
fut obligé de les envoyer à Tarente. T
' La fécondé guerre contre les Mefféniens fut
foutenue avec la même opiniâtreté. . Elle diira
dix-huit ans, & les opérations de cette guerre
confifièrent encore à faire un long fiège, malgré
la défenfe de Lycurgue. Enfin, elle fut terminée
par la conquête de la Meffénie.
(1) 767 avant J. C,
Jufqu’à la guerre des Perfes, il ne paroît pas
que les loix de Lycurgue aient reçu d’autres atteintes.
On voit feulement que le pouvoir des
éphores s’accrut confidérablement. Le roi Anaxan-
dre ayant une femme qui ne lui donnoit pas d’en-
fans,ils le forcèrent d’en époufer une autre. Cléo-;
mène, fon fucceffeur, fut cité devant leur tribunal
à deux différentes fois. A in fi, de miniftres des
rois, ils étoient devenus leurs juges. La première
fois, on l’accufa d’avoir laiffé échapper l’occafion
de s’emparer d’Argos. Malgré les inftitutions de
Lycurgue, c’était un crime aux yeux des Spartiates
d’avoir manqué de faire une conquête. La
fécondé fôis, il fut accufé d’être ennemi de la
pa^x : le roi Démarate étoit fon accnfateur. Il eft
affez remarquable, dit M. Mathon , qu’un roi eût
cité un autre roi devant des magiftrats tirés du
peuple, & qui dévoient à ces mêmes rois leur
exiftence & leur pouvoir. C ’eft du moins ce qui
nous fernble. Mais c’eft qu’ils n’attachoient pas les
mêmes idées à ce nom. Les éphores étoient établis
avèe le concours de la nation. Ils étoient élevés
à la hauteur de la loi quant à fon exécution. Et
dès qu’ils en étoient les repréfentans aux yeux de
la nation, & qu’elle confentoit à leur adminiftrA#'
tioa, les rois ne paroiffant être alors qu’une partie
de cette même nation, ils dévoient être fournis
aux ordonnances des éphores, comme l'auroit été
tout autre citoyen.
Si les Spartiates avoient été moins ambitieux
lorfque la guerre des Perfes fe déclara, & que
les Grecs leur offrirent le commandement général
, ils auroient, du moins par refpecl pour les
j loix de Lycurgue, refufé celui des troupes maritimes.
Alors les Athéniens', plus accoutumés à conduire
des flottes, auroient confèrvé l’empire de
la mer. Ce partage auroit peut-être fatisfait les
deux nations ; la guerre de Péloponnèfe n’auroit
pas eu lieu , & ce feul a&e de modération auroit
pu prévenir bien des malheurs & épargner1
bien du fang à la Grèce. Mais il femble, au contraire,
que les Lacédémoniens ayant faifi avec
avidité le prétexte que la fortune leur offroit pour
s ’affranchir des différentes loix qui les gênoient,
prefque toutes leurs démarches furent autant d’in-
fraftions des conftitutions de Lycurgue. Il ne fut
plus queftion de la Xénelafie (2) , ou de la défenfe
de faire des voyages, & .d’avoir commerce avec
d’autres nations.
Tandis que Léonidas défendoit le paflage des
Thermopyles où il eut la’ gloire de mourir en
vrai Spartiate, Eurybiade conduifoit une flotte, fans
aucune expérience du fervice de mer. L’année fui-
vante on arma fept mille Ilotes (3) contre Mar-
■ (2) Loi qui interdifoit toute communication habituelle
avec les étrangers. '
. (3) C’étoientla partie des enclaves que fes Lacédémoniens
employoient à la culture de leurs terres. ( Voyct
Helus & Helotes. )