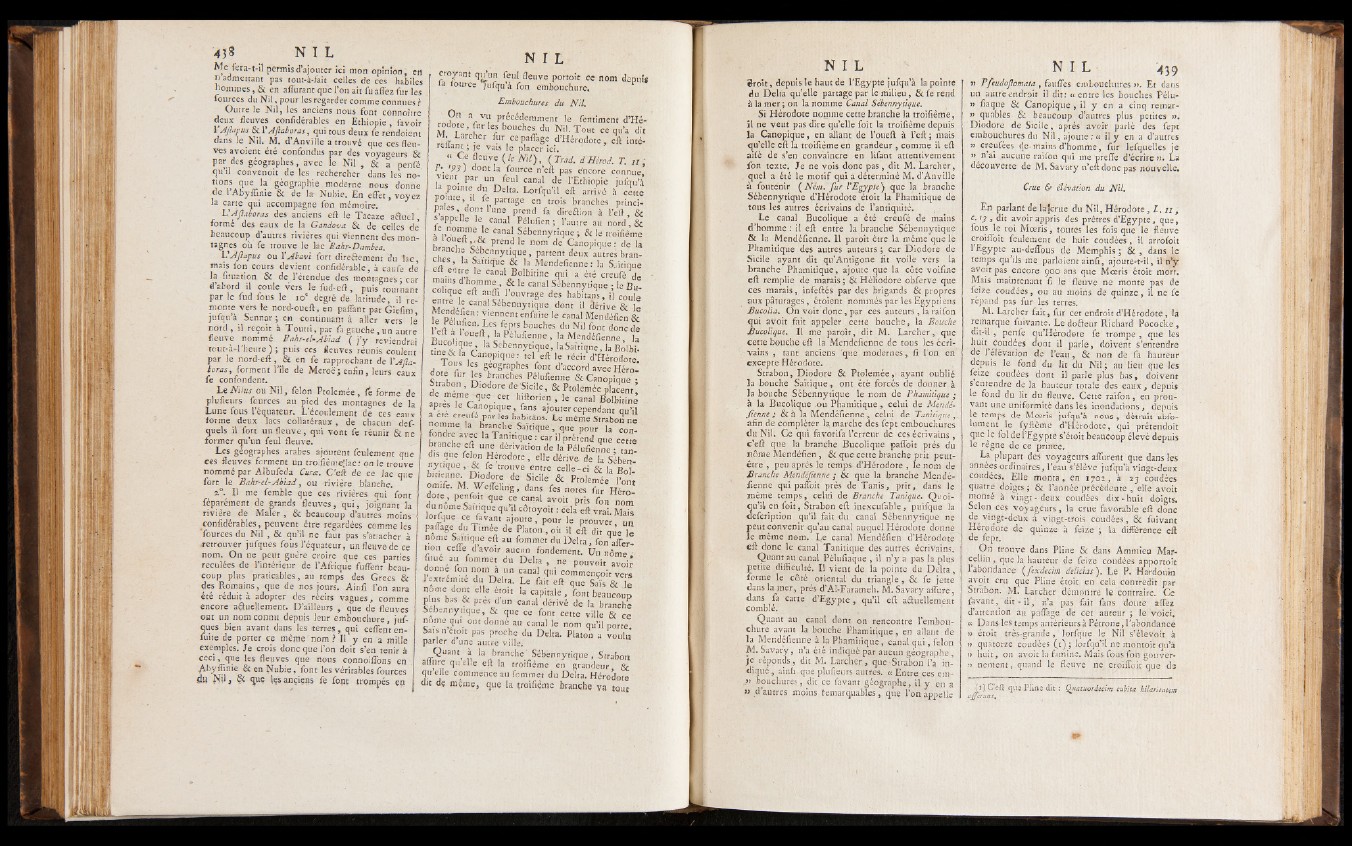
4 3 ? N I L
Me (era-t-tl permis d'ajouter ici mon opinion; erl
n admettant pas tout-à-fait celles de ces habiles
hommes, & en affûtant que l’on ait lu affez fur les
fources du Nil . pour les regarder comme connues ?
Outre le Nil. les anciens nous font connoïtre
deux fleuves conftdêrables en Ethiopie, favoir
YAJlapus & ÏAJlaboras, qui tous deux fe r.endoient
dans le Nil. M. d’Anville a trouvé que ces fleuves
avoient été confondus par des voyageurs &
par des géographes, avec le Nil , & a penfé
qu’il convenoit de les rechercher dans les no-
,,lon1f f l ue la géographie moderne nous donne
de 1 Abyflînie & de la' Nubie. En effet, voyez
la carte qui accompagne fon mémoire.
L'Afiaboras des anciens eft le TScaze aéîuel,
formé des eaux de la Gandova & de celles de
beaucoup d’autres rivières qui Viennent des montagnes
où fe trouve le lac Bahr-Dambea.
VAJlapus ou l’Abavi fort directement 'du lac,
mais fon cours devient confidérable, à caufe de
la fituation & de l’étendue des montagnes ; car
d’abord il coule vers le fud-efl, puis tournant
par le fud fous le to ' degré de latitude, il remonte
vers le nord-oueft, en paffant parGieftm,
jufqn’-à Sennar ; en continuant à aller vers le
nord, il reçoit à Toutti, par fa gauche,un autre
fleuve nommé Bahr-cl-Abiad ( j’y reviendrai
teut-à-l’heure) ; puis ces fleuves réunis coulent
par le nord-eft, & en fe rapprochant de l'Afta-
boras, forment l’île de Meroé; enfin, leurs eaux
fe confondent.
Le Nilus ou N il, félon Ptolemée , fe forme de
plufieurs fources au pied des montagnes de la
Lune fous l’équateur. L’écoulement de ces eaux
forme deux lacs collatéraux, de chacun def-
quels il fort un fleuve, qui vont fe réunir & ne
former qu’un feul fleuve.
Les géographes arabes ajoutent feulement que
ces fleuves forment tin troifième'lac: on le trouve I
nommé par Albufeda CW . C ’eft de ce lac que
fort le Bahr-cl-Abiad, ou rivière blanche.
z°. U me femble que ces rivières qui font
féparément de grands fleuves, qui, joignant la
rivière de Maler , & beaucoup d’autres moins
conftdêrables, peuvent être regardées comme les
‘fources du Nil , & qu’il ne faut pas s’attacher à
«trouver jùfques fous l’équateur, unfleuvede ce
nom. On ne peut guère croire que ces parties
reculées de l’intérieur de l’Afrique fuffent beaucoup
plus praticables, au temps des Grecs &
des Romains, que de nos jours. Air,fl l’on aura
été réduit à adopter des récits vagues, comme
encore aftueljemenr. D ’ailleurs , que de fleuves
oat un nom connu depuis leur embouchure, juf-
ques bien avant dans les terres, qui ceffept en-
fuite de porter ce même nom ? Il y en a mille
exemples. Je crois donc que l’on doit s’en tenir à
ceci, que les fleuves que nous connoiffons en
Abyffnie & en Nubie, font les véritables .fources
du î’fù s & que lçs anciens fe fopt trompés en
N I L
croyant qtdun feul fleuve portoit ce nom depuis
fa fource fufqu’à fon embouchure.
Embouchures du Nil.
On a vu précédemment le fentiment d’Hérodote,
furies bouches du Nil. Tout ce qu’a dit
M Larcller fur ce paffage d’Hérodote , eft inti-
rtliant.; je vais le placer ici.
“ f ü ? eUVf V e N il)> (Trad. d Hérod. T. i l ;
P\ '93) dont la fource n’eft pas encore connue
vient par un feul canal de l’Ethiopie jufqu’à
la pointe du Delta. Lorfqu’il eft arrivé à cette
S T ' 6 j ft . partaSe en trois branches principales
. dont 1 une prend fa direâion à l’eft , &
s appelle le canal Pélufien ; l’autre au n o rd ,&
le nomme j e canal Sébennytique ; & le troifième
a 1 ou eft, . & prend le nom de Canopique : de la
nranche bébennyttque, partent deux autres branches
, la Sattique & la Mendefienne : la Ssïtique
6 -entpr e canal Bolbitine qui a été creufé de
mauts d homme, & le canal Sébennytique ; le Bucolique
eft auflï l’ouvrage des habitans, il coule
entre le canal Sébennytique dont il dérive & le
Mendefien: viennent enfuite le canal Mendéfien &
i, /fe. U,flen’J ’es feP,s bouches du Nil font donede 1 eft a l’oueft, la Pélufienne , la Mendélienne, I
f i n e & T c a Scbennytique, laSaïtiqne, la.Bolbi-
nne&la Canoptque: tel eft le récit d’Hérodote,
d S^°§rapbes font d’accord avec Hérodote
fur k s branches Pélufienne & Canopique ;
Strabon, Diodore de ’Sicile, & Ptolemée placent
auti ! t P " e apres le Canop-icqeute , hf^an0sr iea?jo u’ tleer cceapneanl dwant Hqu’il
■ a ete creufé par les habitàns. Le même Strabon ne
omme la branche Sattique,, que pour la confondre
avec la Tan,tiqué : car il prétend que cette
branche eft une dérivation de la Pélufienne Han-
dis que félon Hérodote , elle dérive de la Séhen
n y tiq u e ,.& fe trouve entre celle-ci & la Bol-
bittenne Dtodore de Sicile & Ptolemée l’ont
omtfe. M. Weffeltng, dans fes notes fur Hérodote^,
penfoit que ce canal avoit pris fon nom
du nome Sattique qu’il côtoyoit : cèla eft vrai. Mais
lorfque ce (avant ajoute, pour le prouver un
paffage du Tintée de Platon, où il eft dit que le
nome Sattique eft au fommet du Delta, fon affer-
tion ceffe d avoir aucun fondement. Un nôme
fitue au fommet du D e lta , ne pouvoit avoiî
donné fon nom a un canal qui commetiçoit vers
lextretnite du Delta. Le .fait eft que Sais & le
nome dont elle etoit la capitale, font beaucoup
plus bas & près d un canal dérivé de la branche
Sebennyttque, & qUe ce fon[ cette v iue & cg
name qut ont donné au canal le nom qu’il porte
Satsneto.t pas proche du Delta. Platon a ïoulu
parler cl une autre ville*
Quant à la branche- Sébennytique , Strabon
afiiire qu elle eft la troifième en grandeur Sc
qu elle commence au fommet du Delta. Hérodote
dit de même, que la troifième brançhç ya (Qlls
Sroît, depuis le haut de l’Egypte jufqu’à la pointe
du Delta qu’elle partage par le milieu, & fe rend
à la mer ; on la nomme Canal Sébennytique.
Si Hérodote nomme cette branche la troifième,
il ne veut pas dire qu’elle foit la troifième depuis
la Canopique, en allant de l’oueft à l’eft ; mais
qu’elle eft la troifième en grandeur , comme il eft
aifé de s’en convaincre en lifant attentivement
fon texte. Je ne vois donc pas, dit M. Larcher,
quel a été le motif qui a déterminé M. d’Anville
à foutenir ( Ném. fur l’Egypte ) que la branche
Sébennytique d’Hérodote étoit la Phamitique de
tous les autres écrivains de l ’antiquité.
Le canal Bucolique a été creufé de mains
d’homme : il eft entre la branche Sébennytique
& la Mendéfienne. 11 paroît être la même que le
Phamitique des autres auteurs ; car Diodore de
Sicile ayant dit qu’Antigone fit voile vers la
branche Phamitique, ajoute que la côte voifine
eft remplie de marais ; & Héliodore obferve que
ces marais, infeftés par des brigands & propres
aux pâturages, étoient nommés par les Egyptiens
Bucolia. On voit donc, par ces auteurs, la raifon
qui avoit fait appeler cette bouche, la Bouche
Bucolique. Il me paroît, dit M. Larcher, que
cette bouche eft la Mendefienne de tous les écrivains
, tant anciens 'que modernes, fi I on en
excepte Hérodote.
Strabon, Diodore & Ptolemée,- ayant oublié
la bouche Saïtiqtie, ont été forcés de donner à
la bouche Sébennytique le nom de Phamitique ;
à la Bucolique .ou Phamitique , celui de Mendé-
fienne ; & à la Mendéfienne, celui de Tanitique,.
afin de compléter la marche des fept embouchures
du Nil. Ce qui favorifa l’erreur de ces écrivains ,
c ’eft: que la branche Bucolique paffoit près du
nônae Mendéfien , & que cette branche prit peut-
être , peu après le temps d’Hérodote , le nom de
Branche Mendéfienne ; & que la branche Mendéfienne
qui paffoit près de Tanis, prit, dans le
même temps, celui de Branche Tanique. Quoiqu’il
en foit, Strabon eft inexcufable, puifque la
defeription qu’il fait du canal Sébennytique ne
peut convenir qu’au canal auquel Hérodote donne
le même nom. Le canal Mendéfien d’Hérodote
eft donc le canal Tanitique des autres écrivains.
Quant au canal Pèlufiaque , il n’y a pas la plus
petite difficulté. Il vient de la pointe du De lta,
forme le côté oriental du triangle , & fe jette
dans la mer, près d’Al-Farameh. M. Savary affure,
dans fa carte d’Egypte , qu’il eft actuellement
comblé.
Quant au canal dont on rencontre l’embouchure
avant la bouche Phamitique, en allant de
la Mendéfienne à la Phamitique, canal qui, fqlon
M. Savary, n’a été indiqué par aucun géographe ,
je réponds, dit M. Larcher, que Strabon l’a indiqué,
îiinü que plufieurs autres. « Entre ces em-
j» bouchures, dit ce favant géographe, il y en a
» d’autres moins remarquables, que l’on appelle
» Vfeudofiomata, fauffes embouchures ». Et dans
un autre endroit il dit: « entre les bouches Pélu-
» fiaque & Canopique , il y en a cinq remar-
» quables .& beaucoup d’autres plus petites».
Diodore de Sicile, après avoir parlé des fept
embouchures du N il, ajoute : « il y en a d’autres
» creufées de-mains d’homme, fur lefquelles je
» nai aucune raifon qui me prelTe d’écrire». La
decouverte de M. Savary n’eft donc pas nouvelle.
Crue & élévation du Nil,
En parlant de la Jcrue du Nil, Hérodote, L. n
c. iq , dit avoir appris des prêtres d’Egypte, que,
fous le roi Moeris, toutes les fois que le fleuve
croiffoit feulement de huit coudées , il arrofoit
1 Egypte au-deffous de Memphis; & , dans le
temps qu’ils me parloient ainfi, ajoute-t-il, il n?y
avoit pas encore 900 ans que Moeris étoit mort.
Mais maintenant fi le fleuve ne monte pas de
feize coudées, ou au moins de quinze, il ne fe
répand pas fur les terres.
M. Larcher fait, fur cet endroit d’Hérodote, la
remarqué fuivante. Le doâeur Richard Pococke ,
dit-âl, penfe qu’Hérodote fe trompe, que les
buir ^oudées dont il parle, doivent s’entendre
de 1 élévation de l’eau, & non de fa hauteur
depuis le fond du lit du Ni! ; au lieu que les
feize coudées dont il parle plus bas, doivent
s entendre de la hauteur totale des eaux , depuis
le fond du lit du fleuve. Cette raifon, en prouvant
une uniformité dans les inondations, depuis
le temps de Moeris jufqu’à nous,, détruit abfo-
lument le fyftême d’Hérodote, qui prétendoit
que le fol de l’Egypte s’étoit beaucoup élevé depuis
le règne de ce prince,
Lîi plupart des voyageurs affurent que dans les
années ordinaires, l’eau s’élève jufqu’à vingt-deux
coudées. Elle monta, en 1702, à 23 coudées
quatre doigts ; & l’année précédente , elle avoit
monte à vingt - deux coudées dix-huit doigts.
Selon ees voyageurs, la crue favorable eft donc
de vingt-deltx à vingt-trois coudées , & fuivant
Hérodote de quinze à feize ; la différence eft
de fept.
On trouve dans Pline & dans Ammieo Marcellin,
que la hauteur de feize coudées apportoit
l’abondance ( fexdecim delicias). Le P. Hardouki
avoit cru que Pline étoit en cela contredit par
Strabon. M. Larcher démontré le contraire. Ce
favant, d i t - i l , n’a pas fait fans doute affez
d’attention au paffage de cet auteur ; le voici.
« Dans les temps antérieurs à Pétrone, l’abondance
» étoit très-grande , lorfque. le Nil s’élevoît à
» quatorze coudées (1) ; lorfqu’il ne montoit qu’à
» huit, on avoit la famine. Mais fous fon gouver-
» nenient, quand le fleuve ne croiffoit que de
(r) Ç eft que Pline dit : Qiiatuordecim cubita hilaritaum
affirunt,