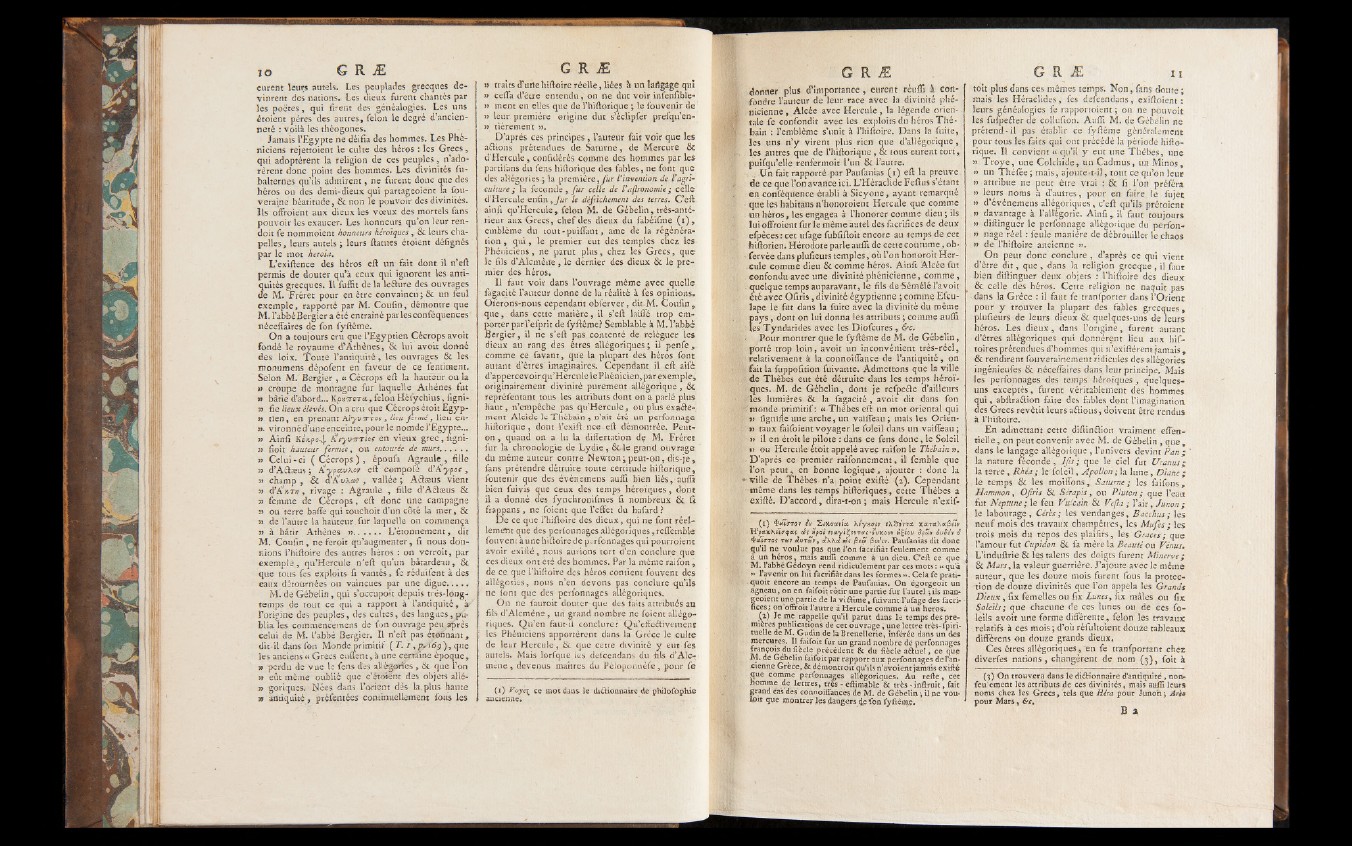
eurent leurs autels. Les peuplades grecques devinrent
des nations.- Les dieux furent chantés par
les poètes, qui firent des généalogies. Les uns
étoient pères des autres, félon le degré d’ancienneté
: voilà les théogonès.
Jamais l’Egypte ne déifia des hommes. Les Phéniciens
rejettoient le culte des héros : les Grecs,
qui adoptèrent la religion de ces peuples, n’adorèrent
donc point des hommes. Les divinités fu-
qu’ils admirent, ne furent donc que des
des demi-dieux qui partageoient la fou-
balternes
héros ou
vera^ne béatitude, & non le pouvoir des divinités.
Ils offroient aux dieux les voeux des mortels fans
pouvoir les exaucer. Les honneurs qu’on leur ren-
doit fe nommoient honneurs héroïques, & leurs chapelles
, leurs autels ; leurs ftatues étoient défignés
par le mot heroïa.
L ’exiftence des héros eft un fait dont il n’eft
permis de douter qu’à ceux qui ignorent les antiquités
grecques. Il fuffit de la leâure des ouvrages
de M. Fréret pour en être convaincu; & un feul
exemple, rapporté par M. Coufin, démontre que
M. l’abbéBergier a été entraîné parlesconféquences
néceffaires de fon fyftême.
On a toujours cru que l’Egyptien Cécrops avoit
fondé le royaume d’Athènes, & lui avoit donné
des loix. Toute l’antiquité, les ouvrages & les
monumens dépofent en faveur de ce fentiment.
Selon M. Bergier , « Cécrops eft la hauteur ou la
» croupe de montagne fur laquelle Athènes fut
» bâtie d’abord... Kpa-rerct, félon Hèlychius, figni-
» fie lieux élevés. On a cru que Cécrops étoit Egyp-
» tien, en prenant hiyvTToç , lieu fermé, lieu en-
9f. vironné d’une enceinte, pour le nomde l’Egypte...
» Ainfi K£xp<>4 en vieux grec y ftgni-
» fioit hauteur fermée, ou entourée de murs............
fi Celui-ci ( Cécrops-), époufa Agraule, fille
» d ’A&æus; fiypctvxov eft compofé d’Avypor,
» champ , & d’A'uàûH' , vallée ; A&æus vient
» d5â xtm , rivage : Agraule , fille d’A&æus &
» femme de Cécrops, eft donc une campagne
» ou terre baffe qui touchoit d’un côté la mer, &
» de l’autre la haliteur. fur laquelle on commença
» à bâtir Athènes »........... L’étonnement, dit
M. Coufin, ne feroit qu’augmenter, fi nous donnions
l’hiftoire des autres héros : on verroit, par
exempté, qu’Hercule n’eft qu’un batardeau, &
que tous les exploits fi vantés, fe réduifent à des
eaux détournées ou vaincues par une d igue......
M. de Gébelin, qui s’occupoit depuis très-longtemps
de tout ce qui a rapport à l’antiquité,
l’origine des peuples, des cultes, des langues, publia
les commencemens de fon ouvrage peu après
celui dé M. l’abbé Bergier. Il n’eft pas étôfinant,
dit-il dans fon Mondeprimirif ( T. i , pÂog) , que
les anciens« Grecs euffent,à une certaine époque,
» perdu de vue le fens des allégorfes , & que l’on
» eût même oublié que c’étaient des objets allé-
» -gorique& £Jées dans l’orient dès la,plus haute
» antiquité, préfentées commuellemein fous les
» traits cTtnle hiftoire réelle, liées à un langage qui
» ceffa d’être entendu, on ne dut voir infenftble-
» ment en elles que de l’hiftorique ; le louvenir de
11 leur première origine dut s’éclipfer prefqu’en-
11 fièrement ».
D ’après ces principes , l’auteur fait voir que les
a&ions prétendues de Saturne, de Mercure &
d’Hercule, confidérés comme des hommes par les
partifans du fens hiftorique des fables, ne font que
des allégories ; la première, fur l’invention de Vagriculture
; la fécondé , fur celle de U agronomie ; celle
d’Hercule enfin,fur le défrichement des terres. C ’eft
ainfi qu’H ercule, félon M. de Gébelin, très-antérieur
aux Grecs, chef des dieux du fabéifme ( i ) ,
emblème du tout - puiffant, ame de la régénération
, q u i, le premier eut des temples chez les
Phéniciens, ne parut plus, chez les Grecs, que
le fils d’Alcmène, le dernier des dieux & le premier
des héros.
Il faut voir dans l’ouvrage même avec quelle
fa'gacité l’auteur donne de la réalité à fes opinions»
Oferons-nous cependant obferver, dit.M. Coufin „
que, dans cette matière, il s’eft laiffé trop emporter
parl’efprit de fyftême? Semblable à M. l ’abbé
Bergier, il ne s’eft pas contenté de reléguer les
dieux au rang des êtres allégoriques ; il penfe
comme ce favant, que la plupart des héros font
autant d’êtres imaginaires. Cependant il eft aifè
d’appercevoirqu’Hercule le Phénicien,par exemple,
originairement divinité purement allégorique, &
représentant tous les attributs dont on a parlé plus
haut, n’empêche pas qu’Hercule, ou plus exactement
Alcide le Thébain , n’ait été un perfonnage
hiftorique, dont l’exift nce eft démontrée. Peutn
on , quand on a lu la differtation de M. Fréret
fur la chronologie de L yd ie , &4 e grand ouvrage
du même auteur contre Newton;peut-on, dis-je,
fans prétendre détruire toute certitude hiftorique,
foutenir que des événemens aufli bien liés, • auffi
bien fuivis que ceux des temps héroïques, dont
il a donné des fynchronifmes fi nombreux & i»
frappans, ne foient que l’effet du hafard ?
De ce que l’hiftoire des dieux, qui ne font réellement
que des perlonnages allégoriques,reffemble
fouvent à une hiftoire de perfonnages qui pourroient
avoir exifté, nous aurions tort d’en conclure que
ces dieux ont été des hommes. Par la même rai fon ,
de ce que l’hiftoire des héros contient fouvent des
allégories, nous n’en devons pas conclure qu’ils
ne font que des perfonnages allégoriques.
On ne fauroit douter que des faits attribués au
fils d’Alcmène, un grand nombre ne foient allégoriques.
Qu’en faut-il conclure? Qu’effeCtivemens
les Phéniciens apportèrent dans la Grèce le culte
de leur Hercule , & que cette divinité y eut fes
autels. Mais lorfque les delcendans du fils d’Ale-
mène, devenus maîtres du Péloponnèfe, pour fe
( i) Voye^ ce mot dans le dictionnaire de philofophie
ancienne»
donner plus d’importance, eurent réuffi à confondre
l’auteur de leur race avec la divinité phé-
. nicienne, Alcée avec Hercule, la légende orientale
fe confondit avec les exploits du héros Thé-
bain : l’emblème s’unit à l’hiftoire. Dans la fuite,
les uns n’y virent plus rien que d’allégorique ,
les autres que de l’hiftorique, oc tous eurent tort,
puifqu’elle renfermoit l'un & l’autre.
. Un fait rapporté par Paufanias ( i ) eft la preuve
de ce que l’on avance ici. L’Héraclide Feftus s’étant
en conféquence établi à Sicyone, ayant remarqué
que les habitans n’honoroient Hercule que comme
un héros, les engagea à l’honorer comme dieu; ils
lui offroient fur le même autel des facrifices de deux
efpèces: cet ufage fubfiftoit encore au temps de cet
feiftoriem Hérodote parle auffi de cette coutume, ob-
• fervée dans plufieurs temples, où l’on honoroit Hercule
comme dieu & comme héros. Ainfi Alcée fut
confondu avec une divinité phénicienne, comme,
quelque temps auparavant, le fils de-Sémélé l’avoit
été avec Ofiris, divinité égyptienne ; comme Efcu-
lape le fut dans la fuite avec la divinité du même
pays, dont on lui donna les attributs ; comme aufli
les Tyndarides avec les Diofcures, &c.
< Pour montrer que le fyftême de M. de Gébelin,
porté trop loin, avoit un inconvénient très-réel,
^relativement à la connoiffance de l’antiquité, on
fait la fuppofition fuivante. Admettons que la ville
de Thèbes eut été détruite dans les temps héroïques.
M. de Gébelin, dont je refpe&e d’ailleurs
^les lumières & la fagacité, avoit dit dans fon
-monde primitif: « Thèbes eft un mot oriental qui
!: » fignific une arche, un vaiffeau ; mais les Orien-
» taux faifoient voyager le foleil dans un vaiffeau ;
» il en étoit le pilote : dans ce fens donc, le Soleil
» ou Hercule étoit appelé avec raifon le Thébain ».
. D ’après ce premier raifonnement, il femble que
l’on peut, en bonne logique, ajouter : donc la
♦ ville de Thèbes n’a point exifté (2). Cependant
même dans les temps hiftôriques,, cette Thèbes a
exifté. D ’accord, dira-t-on ; mais Hercule n’exif- (l)
( l) $4t,i(rrQV tv hèyxo-iv tk^évra. jctf.ret\«/2e7v
Hcpa.x.kiï<rq*c aft npoi evcrytÇovTctc’oviiouv itf'tov Spctt évfs'v o‘
Qttïrrot tmv dw d d i $t& fiw'iv. Paufanias dit donc
fjuJil ne^ voulut pas que l’on facrifiât feulement comme
à un héros, mais auffi comme à un dieu. C’eft ce que
M. l'abbe Gédôyn rend ridiculement par ces mots : « qu’à
»♦ l’avenir on lui facrifiât dans les formes ». Cela fe prati-
quoit encore au temps de Paufanias. On égorgeoit un
agneau, on en faifoit rôtir une partie fur l’autel ; ils man»
geoient une partie de la vi&ime, fuivant l’ufage des facri*
nces; onvoffroit l’autre à Hercule comme à ua héros.
IggJ -te me. rappelle qu’il parut dans le temps des premières
publications de cet ouvrage, une lettre très-fpiri-
tuelle de M. Gudin de la Brenellerie, inférée dans un des
mercures. Il faifoit fur un grand nombre dé perfonnages
françois du fiecle précédent & du fiiècle aéluel, ce que
M» de Gebelin faifoit par rapport aux perfonnages de l’ancienne
Grèce, & démontroit qu'ils n’avoient jamais exifté
que comme pèffonnages allégoriques. Au refte, cet
homme de lettres, très - eftimabLe & très • inôruit, fait
grand cas des eonnoiffaqcés de M. de Gébelin *, il ne voulait
que montrer les .dangers 4,e fon fyftême.
toit plus dans ces mêmes temps. Non, fans doute ;
mais les Héraclides, fes defeendans, exiftoient :
leurs généalogies fe rapportoient ; on ne pouvoit
les fufpeéler de collufton. Auffi M. de Gébelin ne
prétend-il pas établir ce fyftême généralement
pour tous les faits qui ont précédé la période hiflo-
rique. Il convient « qu’il y eut une Thèbes, une
» T ro y e , une Colchide, un Cadmus, un Minos,
» un Théfée ; mais, ajoute-t-il, tout ce qu’on leur
» attribue ne peut être vrai : & fi l’on préféra
11 leurs noms à d’autres, pour en faire Je fujet
» d’événemens allégoriques, c’eft qu’ils prêtoient
» davantage à l’altégorie. A in fi,, il faut toujours
» diftinguer le perfonnage allégorique du perfon-
11 nage réel : feule manière de débrouiller le,chaos
» de Thiftoire . ancienne ».
On peut donc conclure, d’après ce qui vient
d’être dit, que, dans la religion grecque, il faut
bien diftinguer deux objets : l’hiftoire des dieux
& celle des héros. Cette religion ne naquit pas
dans la Grèce : il faut fe tranfporter dans l’Orient
pour y trouver la plupart des fables grecques,
plufieurs de leurs dieux & quelques-uns de leurs
héros. Les dieux, dans l’origine, furent autant
d’êtres allégoriques qui donnèrent lieu aux histoires
prétendues d’hommes qui n’exiftèrent jamais ,
& rendirentSouverainement ridicules des allégories
ingénieufes & néceffaires dans, leur principe. Mais
les perfonnages des temps héroïques, quelques-
uns exceptés, furent véritablement des hommes
qui, abftraâion faite des fables dont l’imagination
des Grecs revêtit leurs aélions, doivent être rendus
à l’hiftoire.
En admettant cette diftinélion vraiment effeti-
rielle, on peut convenir avec M. de Gébelin , que,
dans le langage allégorique , l’univers devint Pan ;
la nature féconde, I fs ; que le ciel fut Uranus;
la terre , Rhèa ; le'foleil, Apollon ; la lune, Diane ;
le temps & les moiffons, Saturne ; les faifons,
Hammotz, Ofiris & Sir apis, ou Pluton; que l’eau
fut Neptune ; le feu Vulcaïn & Ve fia ; l’air, Junon ;
le labourage, Cérès; les vendanges, Bacckus; les
neuf mois des travaux champêtres, les Mufies; les
trois mois du repos des plaifirs, les Grâces; que
l’amour fut Cupidon & fa mère la Beauté 011 Vénus.
L’induftrie & les talens des doigts furent Minerve;
& Mars, la valeur guerrière. J’ajoute avec le même
auteur, que les douze mois furent fous la protection
de douze divinités que l’on appela les Grands
Dieux, fix femelles ou fix Lunes, fix mâles ou fix
Soleils ; que chacune de ces lunes ou de ces fo-
leils avoit une forme différente, félon les travaux
relatifs à ces mois ; d’où réfultoient douze tableaux
différens ou douze grands dieux.
Ces êtres allégoriques, en fe tranfportant chez
diverfes nations, changèrent de. nom (3 ), foit à
(3) On trouvera dans le diftionnaire d'antiquité , non»
feu'ement les attributs de ces divinités, mais auffi leurs
nouas chez les Grecs, tels que Béra pour Junon ; Arts
pour Mars, &c.
B a