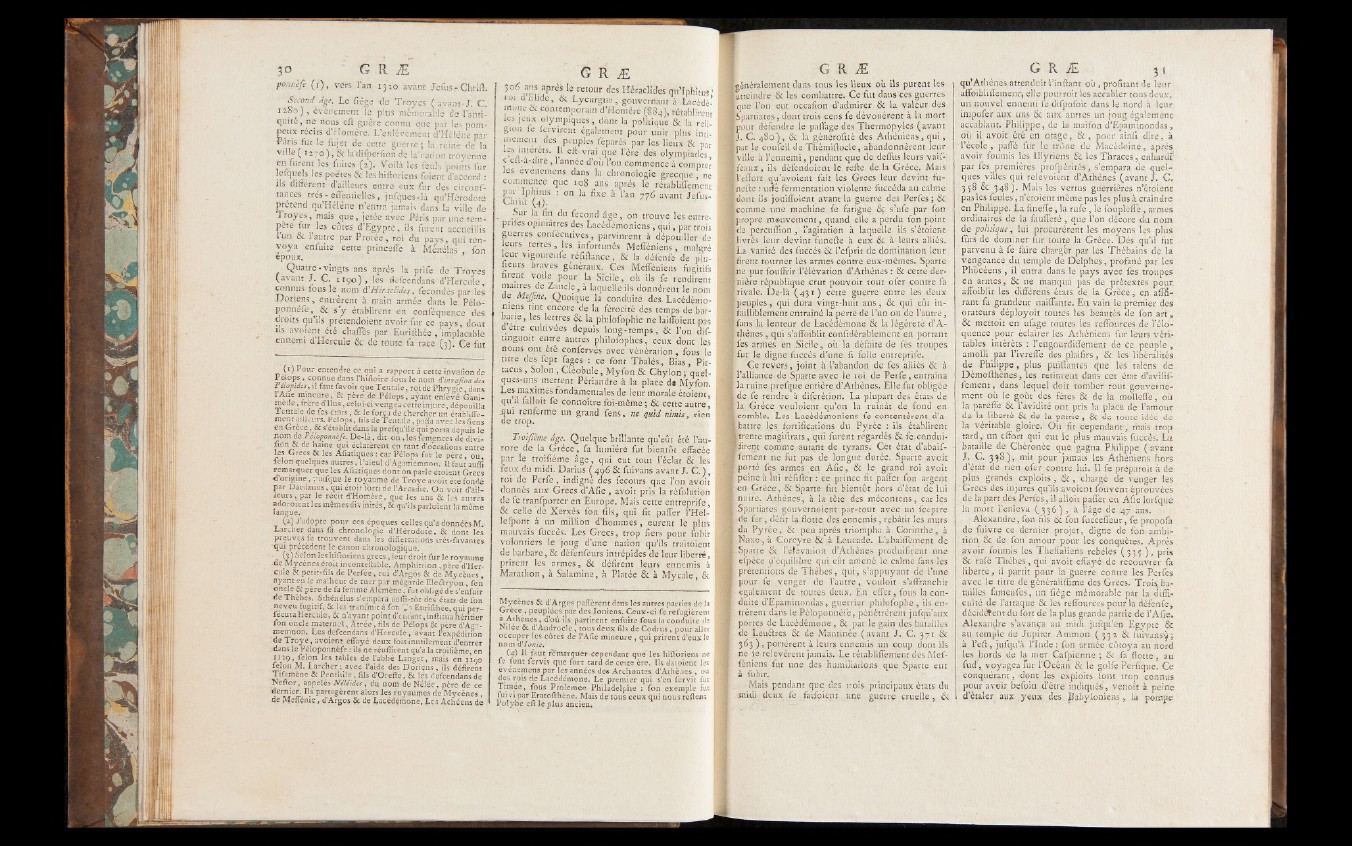
30 G R Æ
ponnèfe, ( i ) , vers l’an 13V0 avant Jefns- Clii-lft.
Second âgé. Le fiège de Troÿes (. avant-S. C.
i i 8 o ) , événement le plus mémorable de l’anri-
qnitê, ne nous eft guère connu que par les pompeux
récits d’Homère. L’enlèvement d’Hélène par
Pâris fut le fujet de cette guerre ; la ruine de' la
ville ( 1270 ) , & la clifperfion de la nation troyenne
en furent les fuites (2). Voilà les feuls 'points fur
Jetqueis les poetes & les hiftoriens foient d’accord :
ils diffèrent d’ailleurs entre eux fur des circonf-
tances très - elfentielles, jufqnes-là qu’Hérodote
prétend qu’Hélène n’entra jamais dans la ville de
T ro y e s , mais que, jetée avec Paris par une tempête
fur les côtes; d’Egypte, ils furent accueillis
l ’un & l’autre par Protée, roi du pays, qui renv
o y a enfutte cette princsffe à Ménèlas , fon
époux.
Quatre-vingts ans après la prife de Troyes
(avant. J. Ç. 1190) , les defcendans d’Hefc.ule,
connus fous lé nom d'Héracudes, fécondés par les
Doriens, entrèrent à main armée dans le Péloponnèfe
,^& s 'y établirent en conféquence des
croîts qu’ils prétendoient avoir fur ce pays, dont
1 s avoient ete chaffes par Eurifthée, implacable
ennemi d Hercule & de toute fa race (3). Ce fut
(1) Pour entendre ce qui a rapport à cette mvafion de
Pejops, connue dans l’hiftoire fous le nom d'invafion des
Felopides j il faut favoir que Tentale, roi de Phrygie, dans
lAfie mineure i & père de Pélops, ayant enlevé Garnî
t 6 , frère d’ilus, celui-ci vengea cette injure, dépouilla
Tentale.de fes étars , & le força de chercher un étabîiffe-
ment ailleurs. Pélops, fils de Tentale, paffa avec les liens
en G rèce, & s établit dans la prefqu’île qui porta depuis le
nom de Péloponnèfe. D e-là, dit-on, les femences de divi-
fion & de haine qui éclatèrent en tant d’occaiïons entre
les Grecs & les Afiatiques : car Pélops fut le père, ou,
leJon quelques autres, l ’aïeul d’Agamemnon. U faut auffi
remarquer que les Afiatiques dont on parle étoient Grecs
-d’origine, ruifque le royaume de Troye avoir été fondé
par Dardanus, qui étoit iorti de l’Arcadie. On voit d’ailleurs,
par le récit d’Homère, que les uns & les autres
adoroxent les mêmes divinités, & qu’ils parloient la même
langue.
(2) J’adopte pour ces époques celles qu’a données M.
Larcher dans fa chronologie d’Hérodote, & dont les
preuves fe trouvent dans les differtations irès-favantes
qui précèdent le canon chronologique.
(3) Selon les hiftoriens grecs, leur droit fur le royaume
•de Mycenes étoit inconteftable. Amphitrion , pèred’Her-
cule & petit-fils de Perféé, roi d’Argôs & de Mycènes,
ayant eu le malheur de tuer par mégarde Eleétryon, fon
oncle & père de fa femme Alcmène, fut obligé de s’enfuir
deThèbes. Sthénélus s’empara auffi-tôt des états de foa
.neveu fugitif, & les'tranfmit à fofc rJ~> Eurifthée, qui per-
fecutaHercule, & n’ayant point d’enfant,inftîtùa héritier
fon oncle maternel, Atrée, -fils de Pélops & père d’Agn-
memnon. Les defcendans d’Herciile, avant l’expédition
de Troye , avoient effayé deux fois inutilement d’entrer
.dans le Péloponnèfe : ils ne réufljrent qu’à la troifième, en
*Ia9 » félon lés tables de l’abbé Langer, mais en tioo
félon M. Larcher; avec l’aide des Doriçns, ils défirent
Tifamène & Penthile, fils d’Orefte, & lès defcendans de
Neftor, appelés Néléides, du nom de Nélée, père de ce
dernier. Ils partagèrent alorsles royaumes de Mycènes , 4e MefTénie, d’Argos & de Lacédémone. Les Achéens de
Ê RÆ
>°6 “ s. après le retour des Héraclides qti'Iphitus’
roi d hlide, & Lycurgue, gouvernant à Lacédémone
& contemporain d’Homère (884), rétablirent
les jeux olympiques, dont la politique & la reli-
gion le 1er,virent également pour unir plus intimement
des peuples léparés par les lieux & par
les interets. Il eft.vrai que l’ère des olympiades,
c eu-a-dire , 1 année d’où l’on commencé à compter
les evenemens dans la chronologie grecque ne
commence que 10S ans après le rétabliffement
..P , t.us •’ on la fixe à l’an 776 avant jefus-
Chnft (4).
Sur la fin du fécond â g e , on trouve les entre-
prîtes opiniâtres des Lacédémoniens, qui, par trois
guerres confécutives, parvinrent à dépouiller de
leurs terres, les infortunés Mefféniens , malgré
leur vigottreufe réfiftance, & la défenfe de plu-
fieurs braves généraux. Ces Mefféniens fugitifs
firent voile pour la Sicile, où ils fe rendirent
maîtres de Zancle, à laquelle ils donnèrent le nom
de MeJJitte. Quoique la conduite des. Lacédémoniens
tint encore de la férocité des temps de bar-
barte, les lettres & la philofopbie ne laiifoient pas
d erre ciiltivées depuis. long- temps, & l’on dif-
tingùoit entre autres philofophes, ceux dont les
noms ont été confervés avec vénération, fous le
titre des fept fages : ce font Thaïes, Bias, Pit-
tacus , Solon , Cléobule, Myfon & Chylon ; quelques
uns mettent Périandre à la place d« Myfon.
Les maximes fondamentales de leur morale étoient,
qu il falloit fe connoître foi-même ; & cette autre,
.qui renferme un grand fens, ne quid nirnis, rien
de trop.
Troifième âge. Quelque brillante qu’eût été l’aurore
de la Grèce, fa lumière fut bientôt effacée
par le troifième âge , qui eut tout l’éclat & les
feux du midi. Darius (496 & fuivans avant J. C . ) ,
roi de Perfe, indigné des fecotirs que l’on avoit
donnés aux Grecs d’A fie , avoit pris la réfolution
de fe tranfporter en Europe. Mais cette entreprife,
& celle de Xerxès fon fils, qui fit .paffer FHel-
lefpont à un million d’hommes , eurent le plus
mauvais fuccès. Les Grecs, trop fiers pour fubir
volontiers le joug d’une nation qu’ils traitoient
de barbare, & défenfeurs intrépides de leur liberté,
prirent les armes, & défirent leurs ennemis à
Marathon, à Salamine, à Platée & à Mycale, &
Mycènes & d’Argos paffèrent dans les autres parties de la
Grèce , peuplées par des Ioniens. Ceux-ci fe réfugièrent
a Athènes, d’où ils partirent enfuite fous la conduite de
Nilée & d’Androcle, tous deux fils de Codrus, pour aller
occuper les côtes de l’Afie mineure , qui prirent d’eux le
nom d'Ionie.
(4} Il faut remarquer cependant que les hiftoriens ne
fe font fervis que fort tara de cette ère. Ils datoient les
évenemens par les années de« Archontes d’Athènes , ou
des rois de Lacédémone. Le premier qui s’en fervit fut
Timée, fous Prolemée Pliiladelphe : fon exemple fut
fuivi par Eratofthène. Mais de tous ceux qui nous reflet»
Polybe eft le plus ancien.
G R Æ 3 1
qu’Athènesattendoit l’inftant où , profitant de leur
affoibUffemenr, elle pourroit les accabler tous deux,
un nouvel ennemi fe difpofoit dans le nord à leur
impofer aux uns & aux autres un joug également
accablant. Philippe, de la maifon d’Epam inondas ,
où il avoit été en otage, & , pour ainfi dire, à
l’école, paffé fur le trône de Macédoine, après
avoir fournis les Illÿriens & lesThraces, enhardi'
par fes premières prospérités, s’empara -de quelques
villes qui relevoient d’Athènes (avant ƒ. C.
.358 & 348 ). Mais les vertus guerrières n’étoient
pas les feules, n’étoient même pas les plus à craindre
en Philippe. La fineffe, la rufe, le foupleffe, armes
ordinaires de la fauffeté, que l’on décore du nom
de politique, lui procurèrent les moyens lés plus
fûrs de dominer fur toute la Grèce. Dès qu’il fut
parvenu à fe faire charger par les Thébains de la
vengeance du temple de Delphes, profané par les
Phocéens , il entra dans le pays avec fes troupes
en armes, & ne manqua pas de prétextes pour
affoiblir les difterens états de. la Grèce, en afférant
fa grandeur naiffante. En vain le premier des
orateurs déployoit toutes les beautés de fon ar t,
& mettoit en ufage toutes les reffources de l’éloquence
pour éclairer les Athéniens fur leurs véritables
intérêts : l’engourdiflement de ce peuple ,
amolli par l’ivreffe des plaifirs, & les libéralités
de Philippe, plus puiflantes que les talens de
Démofihènes, les retinrent dans cet état d’avilif-
fement, dans lequel doit tomber tout gouvernement
où le goût des fêtes & de la mollelfe, où
la par elfe & l’avidité ont pris la place de l’amour
de la liberté & de la patrie, & de toute idée de
la véritable gloire. On fit cependant, mais trop
tard, un effort qui eut le plus mauvais fuccès. La
bataille de Chéronée que gagna Philippe (avant
J. C. 338), mit pour jamais les Athéniens hors
d’état de rien ofer contre.lui. Il fe préparoit à de
plus grands exploits, & , chargé de venger les
Grecs des injures qu’ils avoient fo'uvent éprouvées
de la part des Perfes, il ail oit paffer en Afie lorfque
la mort l’enleva ( 336 ) , à l’âge d e '47 ans.
Alexandre, fon fils ,& fon fucceffeur, fe propofa
de fui-vre ce dernier projet, digne de fon ambition
& de fon amour pour les conquêtes. Après
avoir fournis les Thefïaliens rebèles (335 ) , pris
& rafé Thèbes, qui avoit effayé de recouvrer fa
liberté, il partit pour la guerre contre les Perfes
avec le titre de généralilîime des Grecs. Troi% batailles
fameufes , un fiège mémorable par la difficulté
de l’attaque & les reffources pour la défenfe,
décidèrent du fort de la plus grande partie de l’Afie.
Alexandre s’avança au midi jufqu’en Egypte &
au temple de Jupiter. Ammon (332 & fuivans^ j
à l’e ff, jufqu’à l’Inde : fon armée côtoya au nord
les bords de la mer Cafpienne ; & fa flotte, au
fud , voyagea fur l’Océan & le golfe Perfique. Ce
conquérant, dont les exploits font trop connus
pour avoir befpin d’être' indiqués, venoit à peine
d’étaler aux yeux des Babyloniens, la pompe
J