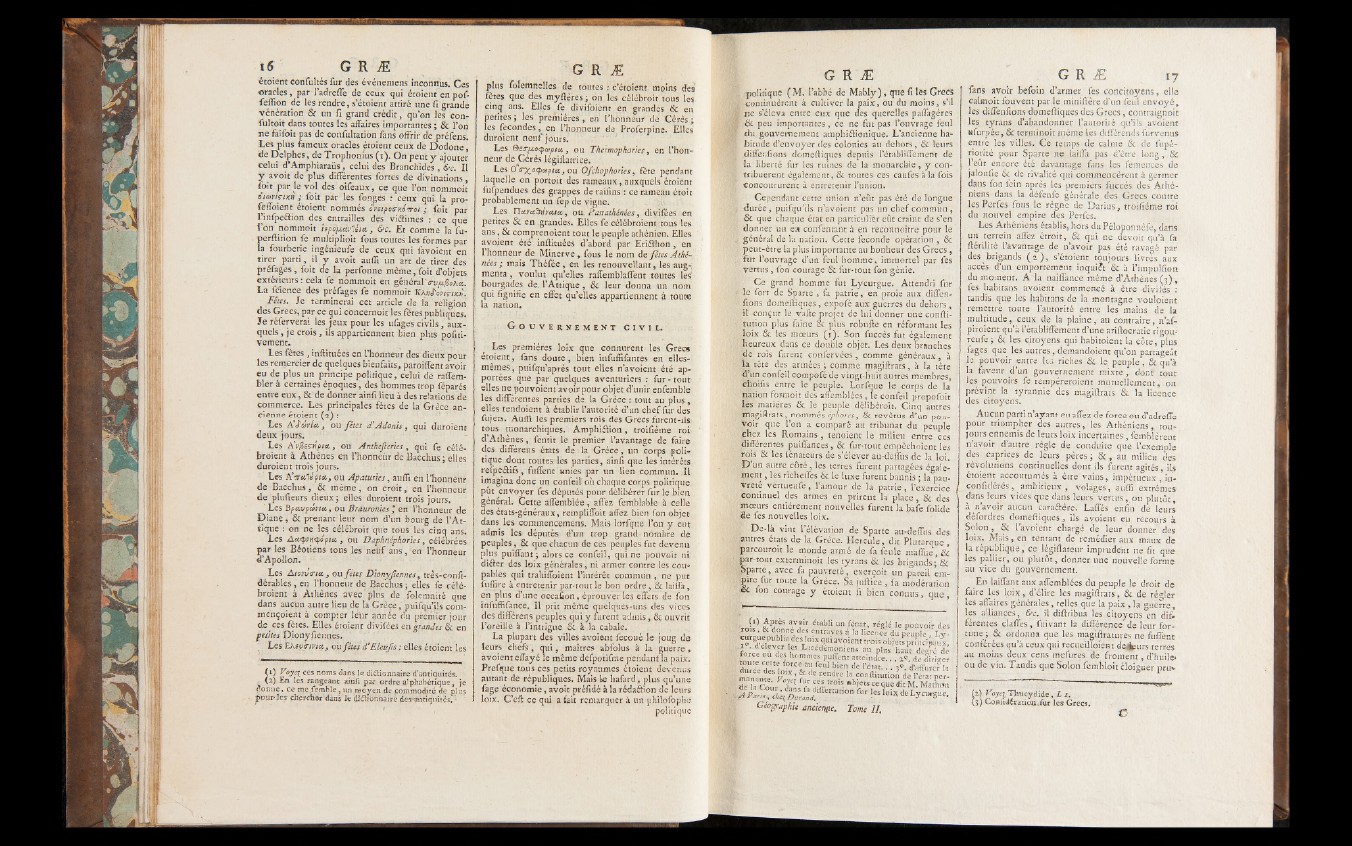
étoient confultés fur des événemens inconnus. Ces
oracles, parTadrefle de ceux qui étoient en pof-
fefiion de les rendre, s’étoient attiré une fi grande
vénération 8c un fi grand crédit, qu’on les con-
fultoit dans toutes les affaires importantes ; & l’on
ne fàifoit pas de confultatiôn fans offrir de préfens.
Les plus fameux oracles étoient ceux de Dodone,
de Delphes, de Trophonius (i) . On peut y ajouter
celui d’Amphiaraüs, celui des Branchides, &c. Il
y avoit de plus différentes fortes de divinations,
foit par le vol des oifeaux, ce que fon nommoit
oicùviçikv ,• foit par les fongés : ceux qui la pro-
feffoient étoient nommés oveiporKoiroi j, foit par
l ’infpeâion des entrailles des viâimes : ce que
von nommoit hpo'fjtctvlsta. , &c. Et comme la fu-
perftition fe multiplioit fous toutes les formes par
la fourberie ingénieufe de ceux qui favoient en
tirer parti, il y ayoit aufii un art de tirer des
préfages, foit de la perfonne même, foit d’objets
extérieurs : cela fe nommoit en généralVu^ oa^.
La fcience des préfages fe nommoit IfA»«Tor/r/xft.
Fèces. Je terminerai cet article de la religion
des Grecs, par ce qui concernoit les fêtes publiques.
Je réferverai les jeux pour les ufages civils, auxquels
, je crois , ils appartiennent bien plus pofiti-
vement.
Les fêtes , inftituéès en l’honneur des dieux pour
les remercier de quelques bienfaits, paroiffent avoir
eu de plus un principe politique, celui dè raffem-
bler à certaines époques, des hommes trop fépârés
entre eux, & de donner ainfi lieu à des relations de
commerce. Les principales fêtes de la Grèce, ancienne
étoient ( i ) :
Les A aviez. , ou fêtes d’Adonis, qui duroient
deux jours.
Les A'v0sçiîpiet, ou A ntheferles, qui fe célé-
broient à Athènes en l’honneur de Bacchus ; elles
duroient trois jours.
Les AV«t7«/>/st, ou Apaturîes, aufii en l ’honneur
de Bacchus , & même, on croit, en l’honneur
de plufieurs dieux; elles.duroient trois jours.
Les Bpc&vpavtct, ou Bràuronïes * en l’honneur de
Dianç, & prenant leur nom d’iiri bourg de P A ttaque
: on ne les célébroit que tous les cinq ans.
Les Aci<pvii<popici, Ou Daphnéphorles, célébrées
par les Béotiens tous les netif ans, en l’honneur
d’Apollon.
Les Aiovvtrict, , ou fêtes Dionyfennes, très-confi-
dèrables, en l’honneur de Bacchus ; elles fe célé-
broient à Athènes avec'plus de fojemnité que
dans aucun autre lieu de la Grèçe, puifqu’ils com-
ménçoierit à compter leur année du premier jour
de ces fêtes. Elles étqienf divifées en grandes 8c en
petites p ion y fieunes..
Les Bhsy <rtvicç, ou fêtes d’Eleufis ; elles étoient les
(0 Foye\ ces noms dans le diftionnaire d’antiquités. '
(a) En les rangeant ainfi par ordre alphabétique, je
donne, ce me.femble, un moyen de pommodité de plu?
£0111x1 es chercher dans le dldlionnaire des‘aùtiqiutêsV‘-
plus foleitinelies de toutes : c’étoient. moins de*
fêtes que des myfières ; on les célébroit tous les
cinq ans. Elles fe divifoiènt en grandes ,& en
petites; les premières, ' eri i ’iiônnéur de Cérès;
les fécondés, en l’honneur de Proferpine. Elles
duroient neuf jours.
Les <dso‘(/.o<pa>pt& , ou Thermophones, en l’honneur
de Cérès légiflatrice.
Les O o'^oepaptet,, ou Ofchophories, fête pendant
laquelle on portoit des rameaux, auxquels étoient
fufpendues des grappes de raifins : ce rameün étoit
probablement un fep de vigne.
Les [TccvctSijvcctcc, ou. Panathénées, divifées en
petites 8c en grandes. Elles fe célèbroient tous les
ans, & comprenoient tout le peuple athénien. Elles
a voient été inftituéès d’abord par Eriéthon, en
l’honneur de Minerve, fous le nom de fêtes Athénées
; mais Thé fé e , en les renouvellant, les aug-;
menta, voulut qu’elles raffemblaffent toutes les'
; bourgades de. l’Attique, & leur donna un nom
: qui fignifie en effet qu’elles appartiennent à toute
, la nation.
G O U V E R N EM E N T C I V I L .
! 3 Les premières loix que connurent les Grec«
étoient , fans doute., bien infuffifantes en elles-
mêmes, puifqu’après tout elles n’avoient été apportées
que par quelques aventuriers : fur-tout
elles ne pouvoient avoir pour objet d’unir enfemble
les différentes parties de la Grèce : tout au plus,
, elles tendoient à établir l’autorité d’un chef fur des
fujets. Aufli les premiers rois des Grecs furent-ils
tous monarchiques. Amphiélion, troifième roi
d’Athènes, fentit le premier l’avantage de faire
des différens états de la Grèce, un corps politique
dont toutes lès parties, ainfi que les intérêts
refpeâifs, fuffent Hnies par un lien commun. Il
imagina donc lin confeil où chaque corps politique
pût envoyer fes députés pour délibérer fur le bien
général. Cette affemblée, aflèz femblable à celle
des états-généraux, rempliffoit affez bien foh objet
dans les commencemens. Mais lorfque l’on y eut
admis les députés d’un trop, grand nombre de
peuples, & que chacun de ces peuples fut devenu
plus puiffant; alors ce confeil, qui ne pouvoir ni
diéler des loix générales, ni armer contre les cou*
pables qui trahiftbient l’intérêt commun , ne put
fuffire à entretenir par-tout le bon ordre, & laiffa,
en plus d’une occafion, éprouver les effets de Ton
infuffifance. Il prit même quelques-uns des vices
des différens peuples qui y furent admis , 8c ouvrit
l’oreille à l’intrigue & à la cabale.
La plupart des villes avoient fecoué le joug de
leurs chefs, q u i, maîtres abfolus à la guerre ,
avoient eflayé le même defpotifme pendant la paix.
Prefque tous ces petits royaumes étoient devenus
autant de républiques. Mais le hafard, plus qu’une
fage économie, avoit préfidé à la rédaftion de leurs
loix. C ’çft ce qui a fait remarquer à un philofophe
politique
politique (M. l’abbé de Mably), que fi lès Grecs
® continuèrent à cultiver la paix, ou du moins, s’il
I l ne s’éleva entre eux que des querelles paffagères
w '■ -& peu importantes, ce ne fut pas l’ouvrage feul
Il du gouvernement amphi&ionique. L’ancienne hall
bitude d’envoyer des colonies au dehors, 8c leurs
». diffenfions domeftiques depuis l’établiffement de
jf la liberté fur les ruines de la monarchie, y con-
tribuérent également, 8c toutes ces caufes à la fois
concoururent à entretenir l’union.
Cependant cette union n’eût pas été de longue
; j durée, puifqifils n’avoient pas un chef commun,
I 8c que chaque état en particulîèr eût craint de s’en
donner un en confentànt à en reconnoître pour le
* général de la nation. Cette fécondé opération , &
peut-être la plus importante au bonheur des Grecs ,
fut l’ouvrage d’un feul homme, immortel par fes
. vertus, fon courage & fur-tout fon génie,
j. Ce grand homme fut Lycurgue. Attendri fur
< le fort de Sparte , fa patrie, en proie aux diffen-
• fions domeftiques, expofé aux guerres du dehors ,
il conçut le vafte projet de lui donner une confti-
tution plus faine oc plus robufte en réformant les
loix 8c les moeurs ( i ) . Son fuccès fut également
heureux dans ce double objet. Les deux branches
de rois furent confervées, comme généraux, à
la tête des armées ; comme magiftrats, à la tête
d’un confeil compofé de vingt-huit autres membres,
choifis entre le peuple. Lorfque le corps de la
nation formoit des auèmblées, le confeil propofoit
les matières & le peuple délibéroit. Cinq autres
magiftrats , nommés éphores, & revêtus d’un pouvoir
que l’on a comparé au tribunat du peuple
chez les Romains , tenoient le milieu entre ces
différentes puiffànces, & fur-tout empêchoient les
rois & les lénateurs de s’élever au-deffus de la loi.
D ’un autre côté, les terres furent partagées également
, les richeffes 6c le luxe furent bannis ; la pauvreté
vértueufe, l’amour de la patrie, l’exercice /
continuel des armes en prirent la place, & des
moeurs entièrement nouvelles furent la bafe folide
fie fes nouvelles loix.
De-là vint l’élévation de Sparte au-deftùs des
autres états de- la Grèce. Hercule, dit Plutaroue,
parcouroit le monde armé de fa feule ma fine1, &
par-tout exterminoit les tyrans 8c les brigands ; 8c
.Sparte, avec fa pauvreté, exercoit un pareil empire
fur toute la Grèce. Sa juftice, fa modération
©c Ion courage y étoient fi bien connus, que,
Voiî a-V?ir etab?i un fén3t, réglé le pouvoir des
rois, & donne des entraves a la licence du peuple , LvÎSrgHV,
2^ll^deV 0l^q.uiavoient trois objets princïputrx,
'fr,‘ rdel^ r \es Lacedemoniens au plus haut degré de
force ou des hommes puffenr atteindre.. . de d tiaet
toute cette fotce.au feul bien de l'état.. . , * d'affurerïa
mTneme“ ° 'X ’ ? de rendl? k »nffitution de l'I'àt perde'
-H Co,',/ ï q flrr “ ° ,s. ®bJets que dit M. Mathon
fur !es loix deLy ^ s - - .
Géographie anciertpe. Tomé II.
fans avoir befoin d’armer fes concitoyens, elle
calmoit fouvent par le miniftere d’un feul envoyé,
les diffenfions domeftiques des Grecs, contraignoit
les tyrans d’abandonner l’autorité qu’ils avoient
ufurpée, 8c terminoit même lès différends fur venus
entre les villes. Ce temps de calme 8c de fupé-
riorité pour Sparte ne laifia pas d’être long, &
l’eût encore été .davantage fans les femences de
jaloufie 8c de rivalité- qui commencèrent à germer
dans fon lein après les premiers fuccès des Athéniens
dans la défenfe générale des Grecs contre
les Perfes fous le règhe de Darius, troifième roi
du nouvel empire des Perfes.
Les Athéniens établis, hors du Péloponnèfe, dans
un terrein affez étroit, 8c qui ne devoit qu’à fa
ftérilité l’avantage de n’avoir pas été ravagé par
des brigands ( 2 ) , s’étoient toujours livrés aux
accès d’un emportement inquiet 8c à l’impulfioti
du moment. A la naiftance même d’Athènes (3)',
fes habitans avoient commencé à être -divifés :
tandis/que les habitans de la montagne vouloient
remettre toute l’autorité entre les mains de la
multitude, ceux de la plaine, au contraire, n’af-
piroient qu’à l’établiffement d’une ariftocratie rigou-
renfe; 8c les citoyens qui habitoient la côte, plus
fages que les autres, demandoient qu’on partageât
le pouvoir entre les riches 8c le. peuple, 8c qu’à
la faveur d’un gouvernement mixte, dont tout
les pouvoirs fe tempéreroienc mutuellement, 011
prévînt la tyrannie des magiftrats 8c la licence
des citoyens.
Aucun parti n’ayant eu affez de force ou d’adreffe
pour triompher des autres, les Athéniens, toujours
ennemis de leurs loix incertaines , fémblèrent
n’avoir d’autre , règle de conduite que l’exemple
des caprices de leurs pères; 8c, au milieu des
révolutions continuelles dont ils furent agités, ils
étoient accoutumés à être vains, impétueux, in-
confidérés, ambitieux , volages, aufii extrêmes
dans leurs vices que dans leurs vertus, ou plutôt,
à n’avoir aucun cara&ère. Laffés enfin de leurs
défordres domeftiques, ils avoient eu recours à
Solon, 8c Tavoient chargé de leur donner des
loix. Mais, en tentant de remédier aux maux de
la républiquece légiflateur imprudent ne fit que
les pallier, ou plutôt, donner une nouvelle forme
au vice du gouvernement.
En laiffant aux affemblées du peuple le droit de
faire les lo ix , d’élire les magiftrats, 8c de régler
les affaires générales, telles que la paix , la guerre,
les alliances, &c. il diftribua les citoyens en dii>
féremes claffes, fuivant la différence de leur fortune
; 8c ordonna que les magiftratures ne fuffent
conférées qu’à ceux qui recueilloîent de^urs terres
au moins deux cens mefures de froment, d’huile*
ou de vin. Tandis que Solon fembloit éloigner prurf
) Voye\ Thucydide, L 1.
[3) Coafidératiou.fur les Grecs.
c