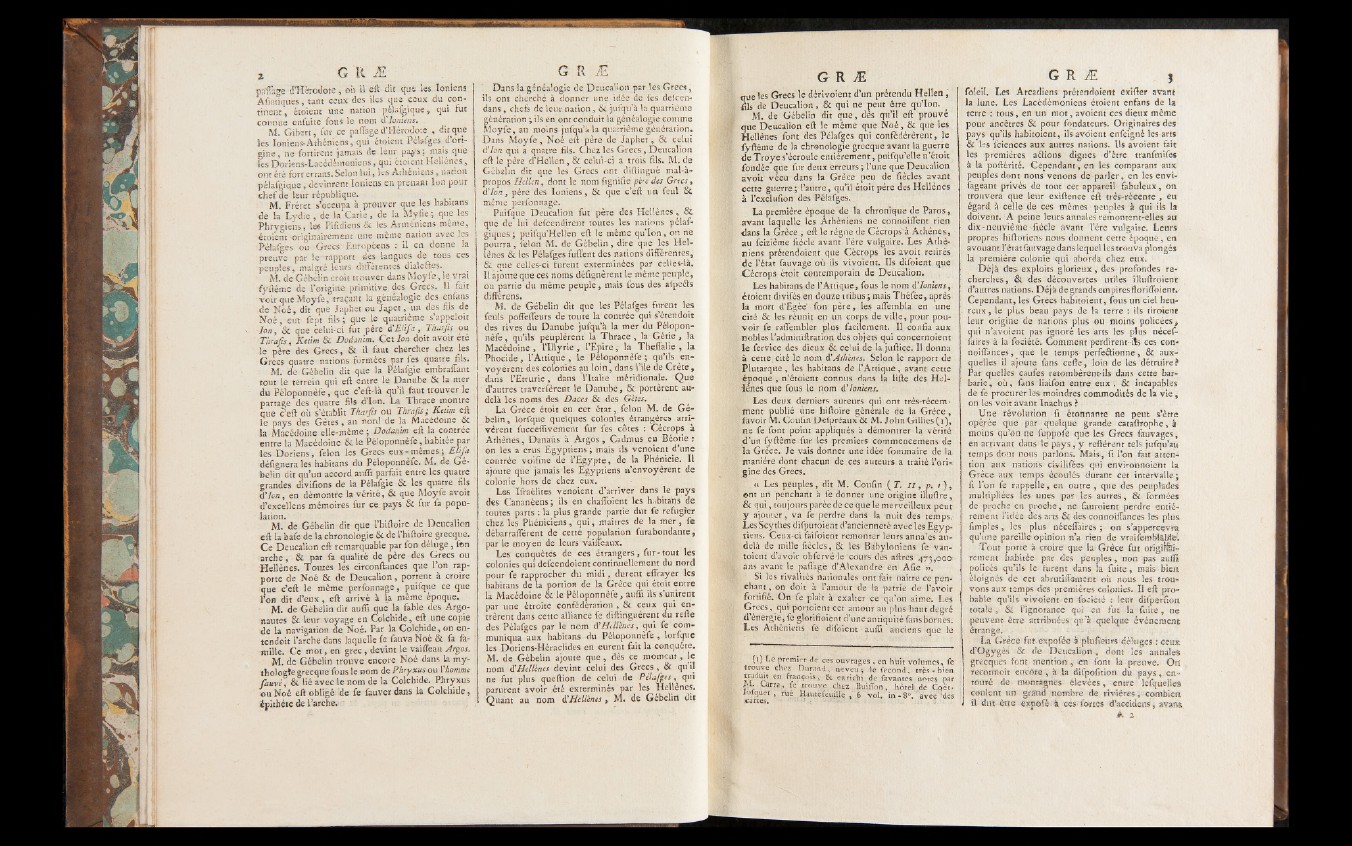
pafTage H é r o d o te , où il eft dit que les Ioniens.
Afia tiques, tant ceux des îles que ceux du continent
„ étoient une nation pélagique , qui fut
connue enfuite fous le nom d Ioniens.
M. Gibert, fur ce paffage d’Hérodote , dit que
les Ioniens-Athéniens, qui étoient Pélafges d’origine,
ne fortirem jamais de leur pays; mais que
les Doriens-Lacédémoniens , qui etoient Hellenes,
ont été fort errans. Selon lui, les Athéniens, nation
pélafgique, devinrent Ioniens en prenant Ion pour
chef de leur république.
M. Fréret s’occupa à prouver que les habitans
de la L y d ie , de la Carie, de la Myfie ; que les
Phrygiens, les Pifidiens & les Arméniens même,
étoient'Originairement une même nation avec les
Pélafges ou Grecs' Européens : il en donne la
preuve pàr le rapport des langues de tous ces
petiotes , malgré leurs différentes dialeêles.
M. de Gébelin croit trouver dans Moyfe, lé vrai
fyftême de l’origine primitive des Grecs. Il fait
voir que Moy fe, traçant la généalogie des enfans
de No é, dit que Japhet ou Jgpet, un des fils de
N o é , eut fept fils; que le quatrième s’appeloit
Ion, 8c que celui-ci fut père d'EUfa, Tharjîs ou
Thrafis, Ketim & Dodanim. Cet Ion doit avoir été
le père des Grecs, 8c il faut chercher chez les
Grecs quatre nations formées par fes quatre fils.
M. de Gébelin dit que la Pélafgie embraffant
tout le terrein qui eft entre le Danube 8c la mer
du Péloponnèfe, que c’eft-là qu’il faut trouver le
partage des quatre fils d’ion. La Thrace montre
que c’eft où s’établit Tharjis ou Thrajîs, Ketim. eft
le pays des Gètes, au nord de la Macedoine 8c
la Macédoine elle-même ; Dodanim eft la contrée
entre la Macédoine 8c le Péloponnèfe, habitée par
les Doriens, félon les Grecs eux-mêmes ; Elifa
défignera les habitans du Péloponnèfe. M. de Ge-
belin dit qu’un accord anfïi parfait entre les quatre
grandes divifions de la Pélafgie 8c les quatre fils
filon , en démontre la vérité, 8c que Moyfe avoit
d’excellens mémoires fur ce_ pays 8c fur fa population.
M. de Gébelin dit que l’hiftoire de Deucahon
eft la bafe de la chronologie 8c de l’hiftoire grecque.
Ce Deucalion eft remarquable par fon déluge , ft>n
arche, 8c par fa qualité de père des Grecs ou
Hellènes. Toutes les circonftances que l’on rapporte
de Noé 8c de Deucalion, portent à croire
que c’eft le même perfonnage, puifque ce que
l ’on dit d’eu x , eft arrivé à la même époque.
M. de Gébelin dit aufli que la fable des Argonautes
8c leur voyage en Colçhide, eft une copie
de la navigation de Noé. Par la Colçhide, on èn-
tendoit l’arche dans laquelle fe fauva Noé 8c fa famille.
Ce mot, en grec, devint le vaifïeau Argos.
M. de Gébelin trouve encore Noé dans la mythologie
grecque fous le nom de Phryxus ou l’homme
fauve, 8c lié avec le nom de la Colçhide. Phryxus
ou Noé eft obligé de fe fauver dans la Colçhide,
épithète de l’arche.
Dans la généalogie de Deucalion par les Grecs,
ils ont cherché à donner une idée de fes defcen-
dans , chefs de leur-nation, 8c jufqu’à la quatrième
génération ; ils en ont conduit la généalogie comme
Moyfe, au moins jufqu’à la quatrième génération.
Dans M o y fe , Noé eft père de Japhet, 8c celui
à'Ion qui a quatre fils. Chez les Grecs , Deucalion
eft le père d’Hellen, 8c celui-ci a trois fils. M. de
Gébelin dit que les Grecs ont diftingué mal-à-
propos Hellen, dont le nom fignifie père des Grecs,
d'iony père des Ioniens, 8c que c’eft un feul 8c
même perfonnage.
Puifque Deucalion fut père des Hellènes, 8c
que de lui defcendjrem toutes les nations pélaf-
giques ; puifqu’Hellen eft le même qu’Ion, on ne
pourra, félon M. de Gébelin, dire que les Hellènes
8c les Pélafges fiifient des nations différentes,'
8c que celles-ci furent exterminées par celies-là.
Il ajoute que ces noms défignèrent le même peuple,
ou partie du même peuple, mais fous des afpe&s
diftèrens.
M. de Gébelin dit que les Pélafges furent les
feuls poffeffeurs de toute la contrée qui s’étendoit
des rives du Danube jufqu’à la mer du Péloponnèfe
, qu’ils peuplèrent la Thrace, la Gétie , la
Macédoine , l’Ulyrie , l’Epire, la Theffalie , la
Phocide, TAttique , le Péloponnèfe ; qu’ils envoyèrent
des colonies au loin, dans l’île de Crète,
dans l’Errurie, dans l’Italie méridionale. Que
d’autres traverfèreut le Danube, 8c portèrent au-
delà les noms des Daces 8c des Gètes.
La Grèce étoit en cet état, félon M. de Gébelin,
lorfque quelques colonies étrangères arrivèrent
fuccelfivemeni fur fes côtes : Cécrops à
Athènes, Danaüs à Argos , Cadmus ea Béotie :
on les a crus Egyptiens ; mais ils venoient d’une
contrée voifine de l’Egypte, de la Phénicie. Il
ajoute que jamais les Egyptiens «’envoyèrent de
colonie hors de chez eux.
Les Ifraèlites venoient d’arriver dans le pays
des Cananéens; ils en chaffoient les habitans de
toutes parts : la plus grande partie dut fe refugîer
chez les Phéniciens, qui, maîtres de la mer, fe
débarraflerent de cette population furabondante,
par le moyen de leurs vaifleaux.
Les conquêtës de ces étrangers, fur-tout les
colonies qui defcendoient continuellement du nord
pour fe rapprocher du midi, durent effrayer les
habitans de la portion de la Grèce qui étoit entre
la Macédoine 8c le Péloponnèfe, aufli ils s’unirent
par une étroite confédération , 8c ceux qui entrèrent
dans cette alliance fe diftinguèrent du refte
des Pélafges par le nom d1 Hellènes, qui fe communiqua
aux habitans du Péloponnèfe , lorfque
les Doriens-Héraclides en eurent fait la conquête.
M. de Gébelin ajoute que, dès ce moment, le
nom $ Hellènes devint celui des Grecs , 8c qu’il
ne fut plus queftion de celui de Pélafges qui
parurent avoir été exterminés par les Hellènes.
Quant au nom fi Hellènes, M. de Gébelin dit
que les Grecs le dérivoient d’un prétendu Hellen
fils de Deucalion, 8c qui ne peut être qu’Ion.
M. de Gébelin dit que, dès qu’il eft prouvé
que Deucalion eft le même que No é, 8c que les
Hellènes font des Pélafges qui confédérèrent, le
fyftême de la chronologie grecque avant la guerre
de T roye s’écroule entièrement, puifqu’eUe n’étoit
fondée que fur deux erreurs ; l’une que Deucalion
avoit vécu dans la Grèce peu de fiècles avant
cette guerre ; l’autre, qu’il étoit père des Hellènes
à l’exclufion des Pélafges.
La première époque de la chronique de Paros,
avant laquelle les Athéniens ne cônnoiffent rien
dans la Grèce , eft le règne de Cécrops'à Athènes ,
au feizième fiècie avant l’ère vulgaire. Les Athéniens
prétendoient que Cécrops les avoit retirés
de.l’état fauvage où-.ils vivoient. Ils difoient que
-Cécrops étoit contemporain de Deucalion.
Les habitans de l’Attique, fous le nom d' Ioniens 9
étoient divifés en douze tribus ; mais Théfée, après
la mort d’Egée' fon père,Tes affembla en une
cité 8c les réunit en un corps de ville,, pour pouvoir
fe raffembler plus facilement. Il confia aux
nobles l’adminiftration des objets qui concernoient
le fer vice des dieux 8c ce'ui de la juftiçe. Il donna
à cette cité le nom d'Athènes. Selon le rapport de
Plutarque, les habitans de l’Attique, ayant cette
époque , n’étoient connus dans la lifte des Hellènes
que fous le nom d1 Ioniens,
Les deux derniers auteurs qui ont très-récemment
publié une hiftoire générale de la Grèce,
favoir M. Coufin Defpréanx 8c M. John Gillies (i) ,
ne fe font point appliqués à démontrer la vérité
d’un fyftême fur les premiers commencemens de
la Grèce. Je vais donner une idée fommaire de la-
manière dont chacun de ces auteurs a traité l'origine
des Grecs.
« Les peuples, dît Coufin (T . n , p. i ) ,
ont un penchant à fe donner une origine illuflre,
8c qui, toujours parée de ce que le merveilleux peut
y ajouter, va fe perdre dans la nuit des temps.
Les Scythes difputoient d’ancienneté avec les Egyptiens.
Ceux-ci faifoient remonter leurs anna’és au-
delà de mille fiècles, 8c les Babyloniens fe van-
toient d’avoir obfervé le'cours des aftres 473,000-
âns avant le paffage d’Alexandre en Afie ».
; Si les rivalités nationales Ont fait naître ce penchant,
on doit à l’amour de la patrie de l’avoir
fortifié. On fe plaît à exalter ce qu’on aime. Les
Grecs, qui portoient cet amour au plus haut degré
d énergie, fe glorifioiènt d’une antiquité fans bornes.
Les Athéniens fe difoient - aufli anciens que le
(1) Lè premier de ces ouvrages , en huit volumes, fe
trouve chez Durand, neveu ÿ 4e fécond, très - bien
H301en ^îa:h.Ç°is, &. enrichi de favantes n^res par
M. Carra , fo trouve chez Buiffon, hôtel-de Cqët *
lolquet , rue, HautefêuiUe , 6 vol. in - 8°. avecqdès
.cartes. c • ppH® ■
foleil. Les Arcadiens prétendoient exifter avant
la lune. Les Lacédémoniens étoient enfans de la
terre : tous, en un mot, avoient ces dieux môme
pour ancêtres 8c pour fondateurs. Originaires des
pays qu’ils habitoient, ils avoient enfeigné les arts
8c les fciences aux autres nations. Us avoient fait
les premières adions dignes d’être tranfmifes
à la poftérité. Cependant , en les comparant aux
peuples dont nous venons de parler, en les envi-
fageant privés de tout cet appareil fabuleux, on
trouvera que leur exiftence eft très-récente, eu
égard à celle de ces mêmes peuples à qui ils la
doivent. A peine leurs annales remontent-elles au
dix-neuvième fiécle avant l’ère vulgaire. Leurs
propres hiftoriens nous donnent eette époque, en
avouant l’état fauvage dans lequel les trouva plongés
la première colonie qui aborda chez eux.
Déjà des exploits glorieux, des profondes recherches,
8c des découvertes utiles illuftroient
d’autres nations. Déjà de grands empires floriflbientv
Cependant, les Grecs habitoient, fous lin ciel heureux,
le plus beau pays de la terre : ils tiroient
leur origine de nations plus ou moins policées j
qui n’avoient pas ignoré les arts les plus nécef*
faires à la fociété. Comment perdirent-ils ces con-
noiflances, que le temps perfectionne, 8c auxquelles
il ajoute fans celle, loin de les détruire?
Par quelles caufes retombèrent-ils dans cette barbarie,
o ù , fans liaifon entre eux , 8c incapables
de fe procurer les moindres commodités de la vie ,
on les voit avant Inachus ?
Une révolution fi étonnante ne peut s’être
opérée que par quelque grande cataftrophe, à
moins qu’on ne fuppofe que les Grecs fauvages,
en arrivant dans le pays, y relièrent tels jufqu’au
temps dont nous parlons. Mais-, fi l’on fait attention
aux nations civilifées qui énvironnoient la
Grèce aux temps écoulés durant cet intervalle;
fi Ton fe rappelle, en outre , que des peuplades
multipliées les unes par les autres, 8c formées
de proche en proche, ne fauroient perdre entièrement
l’idée des arts 8c des connoiffances les plus
Amples, les plus néceffaires ; on s’appercevra.
qu’une pareille opinion n’a rien de vraifembtelfte.
Tour porte à croire que la-Grèce fut origiiÉi“
rement habitée par des peuples , non pas aùfti.
policés qu’ils le furent dans la fuite, mais biens,
\ éloignés de cet abrutîffsment où nous les trouvons
aux temps des premières colonies. Il eft probable
qu’ils vivoiefit en fociété î leur difperfion
totale, 8c l’ignorance qui en fut la fuite, ne
peuvent être attribuées, qu’à quelque événement
étrange.
La Grèce fut expofêe à plufieurs déluges : ceux
d’Ogygès 8c de Deucalion, dont lès annales
grecques font mention , en font la preuve. Od
reconnoît encore , à la difpofition du pays, entouré
de montagnes élevées, entre lefquelles
coulent un grand nombre de rivières, combien
il dut être expofé à cés-fortes d’accidens, avans
A z