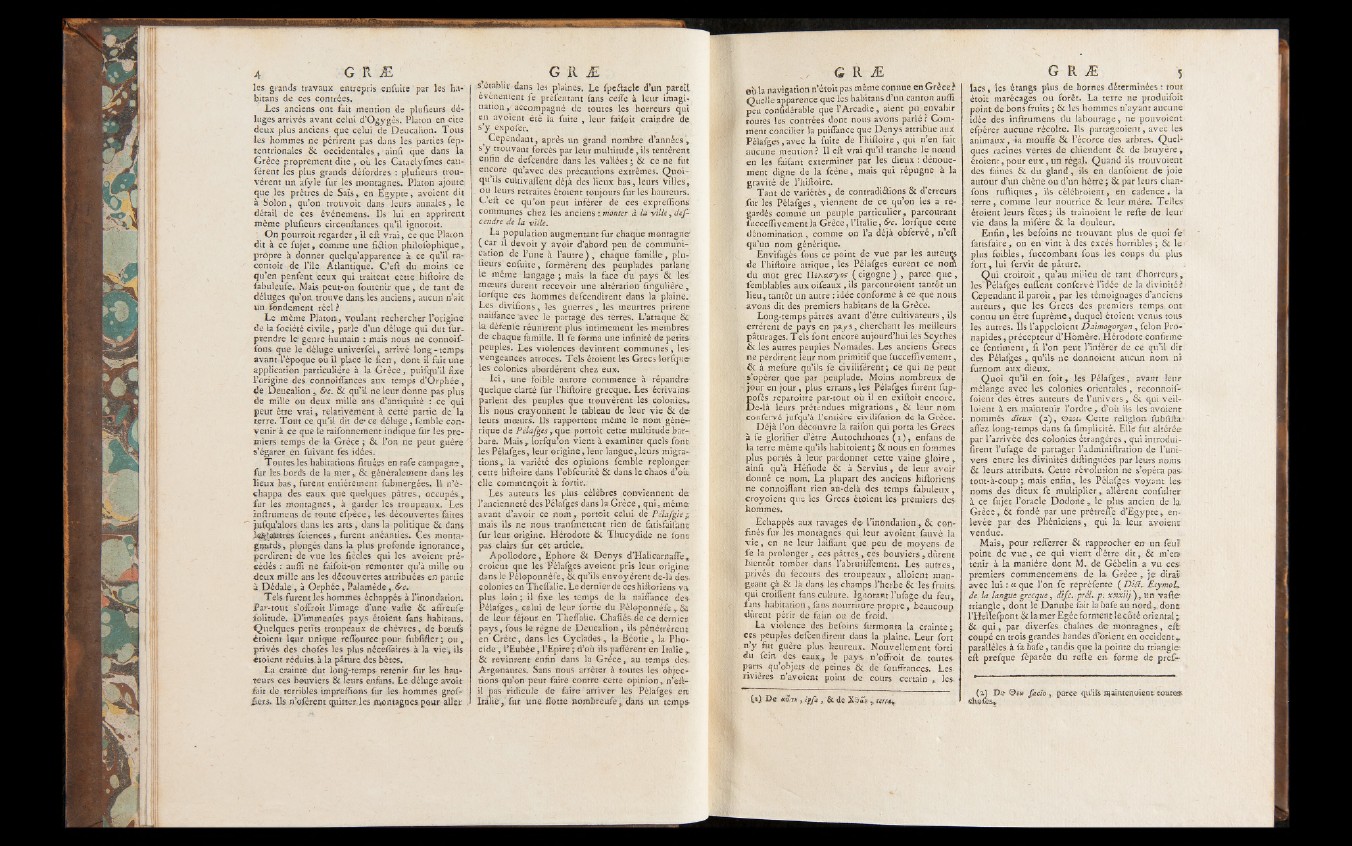
les grands travaux entrepris enfuite ' par les ha-'
bitans de ces contrées.
Les anciens ont fait mention de plufieur-s déluges
arrivés avant celui d’Ogygès. Platon en cite
deux plus anciens que celui de Deucalion. Tous
les hommes ne périrent pas dans les parties fep-
tentrionales & occidentales, jj ainfi que dans la
Grèce proprement dite, où les Cataclysmes cau-
fèrent les plus grands défordres : pluneurs trouvèrent
un afyle fur les montagnes. Platon ajoute
que les prêtres de Sais, en Egypte, avoient dit
à Solon, qu’on troüvoit dans leurs annales, le
détail de ces événemens. Ils lui en apprirent
même plufieurs circonftances. qu’il ignoroit.
On pourroit regarder, il ell vrai, ce que Platon
dit à ce fujet, comme une fi&ion philofbphique,
propre à donner quelqu’apparence à ce qu’il ra-
contoit de l’île Atlantique. C ’eft du moins ce
qu’en penfent ceux qui traitent cette. hiftoire de
fabulçufe. Mais peut-on fbutenir que, de tant de
déluges qu’on, trouve dans les anciens , aucun n’ait
lin fondement réel?
Le même Platon, voulant rechercher l’origine
de la fociété civile, parle d’un déluge qui dut fur-
psendre le* genre humain : mais nous ne connoif-
fons que le déluge univerfel, arrivé long-temps
avant l’époque ©ù il placé le fien, dont il fait une
application particulière à la Grèce, puifqu’il fixe
l ’origine des connoiffances aux temps d’ôrphée ,
de D e u c a lio n &c* & qu’ il ne leur donne pas plus
de mille ou deux mille ans d’antiquité : ce qui
peut être vrai, relativement à cette partie, de la
terre. Tout ce qu’il dit de* ce déluge, femble con-
yenirà ce que le raifonnement indique fur les premiers
temps de la Grèce ; & Pon ne peut guère
s’égarer en fuivant fes idées.
Toutesles habitations fi tuées en raie campagne,
fur les bords de la mer,. & généralement dans les
lieux bas, furent entièrement fubmergées., 11 n’échappa
des eaux que quelques pâtres., occupés,
fur les montagnes, à garder les troupeaux. Les.
inftrumens de toute efpèce , les. découvertes faites
jufqu’alors dans les arts, dans la politique & dans
fciences., furent anéanties.. Ces montagnards,
piongés dans la plus profonde ignorance,
perdirent de vue les fiècles qui les avoient précédés
: auffi ne faifoit-on remonter qu’à mille ou
deux mille ans les decouvertes attribuées en partie
à Dédale, à Orphée, Palamède,. &c.
Tels furent les hommes échappés à Tinondàtion.
Par-tout s’ofîroit l’image d’une vafte & affreufe
iolirude. D ’immenfes pays étoient fans habitans.
Quelques petits troupeaux de chèvres, de boeufs
étoient leur unique reffource pour fubfifter » ou ,,
privés des chofes les plus nécefiàires. à la vie^ ils
étoient réduits, à la pâture des bêtes.
La crainte dut long-temps retenir fur lès hauteurs
ces bouviers & leurs enfans. Le déluge avoir
fait de terribles impreffions fur les hommes grof-
£ers> Ils n’ofèrem quitter-les montagnes pour aller.
s établir dans les plaines. Le fpe&acle d’un pareil
événement fe préfentant fans cefle à leur imagination
, accompagné de toutes les horreurs qui
en avoient été la fuite , leur faifoit craindre de
s’y expo fer.
-, Cependant, après un grand nombre d’années*,
s y trouvant forcés par leur multitude, ils tentèrent
enfin de defeendre dans les vallées j & ce ne fut
encore qu’avec des précautions extrêmes. Quoiqu’ils
cultivaient déjà des lieux bas, leurs Villes,
ou leurs retraites étoient toujours fur les hauteurs.
C ’eft ce qu’on peut inférer de ces expreflions
communes chez les anciens t monter à la ville, defeendre
de la ville.
La population augmentant fur chaque montagne-
(car il devoit y avoir d’abord peu de communication
de Tune à l’autre ) , chaque famille, plusieurs
enfuite, formèrent des peuplades parlant
le même langage ; mais la face du pays & les
moeurs durent recevoir une altération fingulière ,
lorfque ce s hommes defeendirent dans la plaine.
Les divifions, les guerres , les meurtres prirent
nailian.ee "avec le partage des terres. L’attaque &
la défenfe réunirent plus intimement les membres
de chaque famille. Il fe forma une infinité de petits
peuples. Les violences devinrent communes, les-
vengeances atroces. Tels étoient les Grecs lorfque
les colonies abordèrent chez eux.
Ic i, une foible aurore commence à répandre
quelque clarté fur Thiftoire grecque. Les écrivains
parlent des peuples que trouvèrent les colonies*.
Ils nous crayonnent le tableau de leur vie & de
leurs moeurs. Ils rapportent même le nom géné--
rique de Pélafges , que por.toit cette multitude barbare.
Mais r lorfqu’on vient à examiner quels font
les Pélafges, leur origine, leur langue ».leurs migrations
,. la variété des opinions femble replonger
cette hiftoire dans Tobfcurité & dans le chaos d’oùï
elle commençoit à; fortir...
Les auteurs les plus célèbres conviennent de-
l’ancienneté des Pélafges dans la.Grèce, qui, même
avant d’avoir ce nom , portoit celui de Pélafgie ;
mais ils ne nous tranfmettent rien de fàtisfaifanG.
fur leur origine. Hérodote & Thucydide ne font
pas clairs fur cet article..
Apollodore, Ephore & Denys d’Haîicarnaffe *
croient que les Pélafges avoient pris leur, origine
dans le Péloponnèfe, & qu’ils envoyèrent de-là des>
colonies en Theffalie. Le dernier de ces hiftoriens va
plus loin » il fixe les temps de la naiflance des
Pélafges, celui de leur fortie du Péloponnèfe , Sa
de leur féjour- en Thefialie. Ghaflés de ce. dernier
pays., fous le règne de Deucalion., ils pénétrèrent
en Crète-, dans, les Cyclâdes , la Béotie, la Plio-
cide , l’ Eubée , 1’Epire \ d’où ils paffèrent en Italie *
& revinrent- enfin dans la Grèce, au temps des:
Argonautes. Sans nous arrêter à toutes les objections
qu’on peut faire contre cette opinion.» n’èft-
il pas ridicule de faire arriver les Pélafges en:
Italie f fur. une Botte nombreufedans un temps
©ù la navigation n’étoit pas même connue en Grèce?
Quelle apparence que les habitans d un canton aufti
peu.cprifidérable que l’Arcadie, aient pu envahir
toutes les contrées dont nous avons parlé? Comment
concilier la puiftance que Denys attribue aux
Pélafges, avec la fuite de Thiftoire, qui n’en fait
aucune mention? Il eft vrai qu’il tranche le noeud
en les faifant exterminer par les dieux : dénouement
digne de la fcène, mais qui répugne a la
gravité de Thiftoire.
Tant de variétés, de contradi&ions & d’erreurs
fur les Pélafges, viennent de ce qu’on les a regardés
comme un peuple particulier, parcourant
fucceflivement la G rè c e , Tltalie, lorfque cette
dénomination, comme on Ta déjà obfervé, ii’eft
qu’un nom générique.
Envifagés fous ce point de vue par les aureu«
de Thiftoire attique, les Pélafges eurent ce nom
du mot grec Tlehouryoc ( cigogne ) , parce q ue ,
fèmblables aux oifeaux , ils parcouroient tantôt un
lieu, tantôt un autre : idée conforme à ce que nous
avons dit des premiers habitans de la Grèce.
Long-temps pâtres avant d’être cultivateurs, ils
errèrent de pays en pays, cherchant les meilleurs
pâturages. Tels font encore aujourd’hui les Scythes
& les autres peuples Nomades. Les anciens Grecs
ne perdirent leur nom primitif que fucceflivement, 8c à mefure qu’ils fe civilifèrent; ce qui ne peut
s’opérer que par peuplade. Moins nombreux de
jour en jour, plus errans, les Pélafges furent fup-
pofés reparoître par-tout où il en exiftoit encore.
De-là leurs prétendues migrations, & leur nom
confervé jufqu’à l’emière civilifation de la Grèce.
Déjà Ton découvre la raifon qui porta les Grecs
à fe glorifier d’être Autochthones ( i ) , enfans de
la terre même qu’ils habitoient ; & nous en fommes
plus portés à leur pardonner cette vaine gloire ,
ainfi qu’à Héfiode & à Servius, de leur avoir
donné ce nom. La plupart des anciens hiftoriens
ne connoiffant rien aù-delà des temps fabuleux,
croyoient que les Grecs étoient les premiers des
hommes.
Echappés aux ravages dç/ l’inondation, & confinés
fur les montagnes qui leur avoient fauve la
v ie , en ne leur laifTant que peu de moyens- de
fe la prolonger, ces pâtres , ces bouviers, durent
bientôt tomber dans Tabrutiftement. Les autres,
privés du fecours des troupeaux, alloient mangeant
çà & là dans les champs l’herbe & les fruits,
qui croiffent fans culture. Ignorant l’ufage du feu-,
fans habitation, fatis nourriture propre, beaucoup
durent périr de faim ou de froid.
La violence des befoins furmonta la crainte;,
ces peuples defeendirent dans la plaine. Leur fort
n’y fut guère plus heureux. Nouvellement forti
du fein des eaux;,, le pays n ’©ftroit de. routes
parts qu’objets de peines & de fouffrances. Les-
rivières n’avoient point de cours certain les -
lacs, les étangs plus de bornes déterminées : tout
étoit marécages ou forêt. La terre ne produifoit
point de bons fruits ; & les hommes n’ayant aucune
idée des inftrumens du labourage, ne pouvoient
efpérer aucune récolte. Ils part.ageoient, avec les
animaux, ia moufle & l’écorce des arbres. Quelques
racines Vertes de chiendent & de bruyère,
étoient, pour eu x , un régal. Quand ils trouvoient
des faines & du gland, ils en danfoient de joie
autour d’un chêne ou d’un hêtre ; & par leurs chan-
fons ruftiques, ils célébroient, en cadence , la
terre, comme leur nourrice & leur mère. Telles
étoient leurs fêtes; ils traînoient le refte de leur
vie dans la mifère & la douleur.
Enfin, les befoins ne trouvant plus de quoi fe
fâtisfaire, on en vint à des excès horribles ; & le
plus foibles, fuccombant fous les. coups du plus
fo r t, lui fervit de pâture.
Qui croiroit, qu’au mi'ieu de tant d’horreurs,
les Pélafges eulfent confervé l’idée de la divinité?
Cependant il parok, par les témoignages d’anciens
auteurs, que les Grecs des premiers temps, ont
connu un être fuprême, duquel étoient venus tous
les autres. Ils l’appeloient Daimogorgon, félon Pro-
napidès, précepteur d’Homère..Hérodote confirme-
ce fentiment, fi Ton peut l’inférer de ce qu’il dit
des Pélafges , qu’ils ne donnoient aucun nom ni
fur_nom aux dieux.
Quoi qu’il en foit, les Pélafges, avant leur
mélange avec les colonies orientales , reconnoif-
fôient des êtres auteurs de T univers ,. & qui veil-
loient à en maintenir Tordre , d’où ils les avoient
nommés dieux (2 ), ©zou Cette religion, fubfiftæ
aftez long-temps dans fa fimplrcité. Elle fut altérée
par l’arrivée des colonies étrangères, qui introdui-
firent Tufage de partager l’adminiftration de l’univers
entre les divinités diftinguées par leurs noms
& leurs attributs. Cette révolution ne s’opéra pas-
tout-à-coup y mais enfin.» les Pélafges voyant les
noms des dieux fe multiplier, allèrent confulrer
à ce fujet l’oracle Dodone , le plus ancien de la
Grèce, & fondé par une prêtrefle d’E gypte, enlevée
par des Phéniciens, qui la leur avoient
vendue.
Mais, pour refferrer & rapprocher err un fèuï
point de v u e , ce qui vient d’être dit, & m’ere
tenir à la manière dont M. de Gébelin. a vu- ces
premiers commencemens de la Grèce » je dirai
avec lu i: « que l’on fè repréfente (D u E tym o L
de la langue grecque, dife. prél,..p: xxxiij-)., un vafte-
triangle ; dont le Danube fait labafe au nord,.don6
l’Hellefpont & la mer Egée forment lecoté oriental ;
& q u i, par diverfes chaînes de- montagnes, eft
coupé en-trois grandes bandes d’orient en occident»
parallèles à fa bafe, tandis que la pointe du triangle?
eft prefque féparée du refte en forme de pre£~ 2
(2) De ©tu fado y parce qu’ils irçaintenoient touresR
(1) De av.th , igfa , de X^av. » terra* shùles*